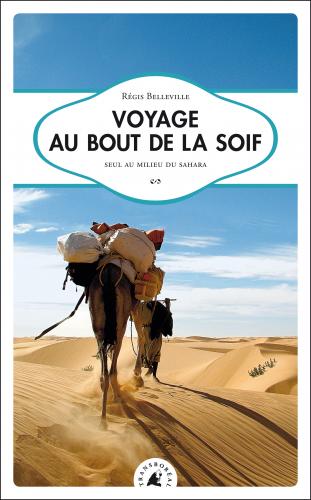
Les mineurs de Taoudenni :
« Scrupuleusement conservé dans un petit sac de tissu, le sel qui fait partie de mon alimentation dans ma “mission de survie” vient probablement de Taoudenni si l’on en juge par la transparence des morceaux de gemme. Cette cristallisation est caractéristique et unique. Nul besoin d’être minéralogiste pour identifier son origine avec certitude quand on l’a vu une fois dans sa vie. Depuis le fond des temps, cette denrée est recherchée par les populations dans tout l’Ouest saharien. Cette précieuse marchandise pouvait, à l’époque des grands empires noirs du Moyen Âge, s’échanger à poids égal contre de l’or. Aujourd’hui, les camions remplacent peu à peu le transport caravanier traditionnel des azalaï et, à partir de Tombouctou, des quantités plus importantes rayonnent dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest. Le seul gisement de Mauritanie est celui de la sebkha d’Idjil, mais il n’est plus guère exploité que pour en extraire un mélange salin contaminé par de l’argile, surtout donné aux animaux. L’inconvénient majeur du sel gemme est qu’il est dépourvu d’iode, ce qui peut induire de graves hypothyroïdies : cette carence, qui perturbe le développement cérébral, est la principale cause de retard mental et de lésions cérébrales chez les nomades. C’est pour cette raison qu’en méharée je complète toujours ma réserve par une boîte cartonnée de sel marin classique à grains fins. Mais son utilisation est moins adaptée à la rudesse du désert, où il n’est par rare de retrouver l’emballage percé ou éventré et son contenu répandu ou mélangé à du sable.
Le labeur est inhumain sur le site de Taoudenni, mais les hommes aux mains et aux pieds crevassés et brûlés par les sédiments salés qui s’y emploient à extraire le sel n’ont pas d’autre moyen de subsistance. Le travail d’excavation se fait au pic et à la sueur : les mineurs creusent le sol croûté par l’évaporation, progressant des couches superficielles de moins bonne qualité vers les couches profondes qui contiennent la fleur de sel. En général, ils atteignent l’“or blanc” à partir de 4 mètres de profondeur, puis s’enfoncent latéralement par un astucieux système de piliers qui évite l’effondrement des boyaux. À voir la beauté des strates versicolores que mettent au jour les coups de pioche, on en oublierait presque les terribles conditions de travail de ces damnés de la terre : du rouge brique au blanc pur, c’est un millefeuille de roches qui se découvre, une généalogie du sous-sol saharien que révèlent les cavités taillées en carré, étrange gruyère mitant le désert de flaques de gemmes étincelantes. À la saison froide, les plaques de sel seront transportées par caravanes entières jusqu’à Tombouctou. Au plus fort de ce commerce, ce sont des centaines de têtes par semaine qui font les allers et retours en un mois.
Les ouvriers me proposent un peu d’eau pour me désaltérer, que j’accepte volontiers. La chaleur est insupportable ; elle accroît la brutalité des conditions de cette antichambre de l’enfer. L’eau est franchement saumâtre, une des pires que j’ai eu l’occasion de boire dans le Sahara. On m’explique que beaucoup d’hommes tombent malades, souffrant de déshydratation aiguë. Cette eau impropre à la consommation, qui provient de l’unique puits de Taoudenni, leur cause en permanence des diarrhées par son taux élevé en sels minéraux. Mais il s’agit du seul point d’eau à 160 kilomètres à la ronde. Les chameliers de l’azalaï, eux, effectuent leurs réserves d’eau à Bir Ounane avant d’arriver à Taoudenni. Ici, les mineurs achètent leur nourriture à crédit auprès des boutiques de Tombouctou, selon un système de tickets. En revenant de la mine après la saison des azalaï, ils paient leurs dettes avec une partie des plaques de sel qu’ils ont extraites. Le dernier véhicule qui est passé dans le secteur était un camion de contrebande qui filait plein nord vers Teghazza, à 180 kilomètres d’ici, avant de bifurquer vers le Maroc ou l’Algérie ; il y a dix jours de cela. Le chauffeur leur a distribué des médicaments et du riz. Personne depuis ! Alors les mineurs me demandent si nous pouvons compléter leurs réserves d’eau grâce à notre véhicule. »
Dans la peau du chamelier (p. 21-22)
Désert vivant (p. 51-53)
Extrait court
« Scrupuleusement conservé dans un petit sac de tissu, le sel qui fait partie de mon alimentation dans ma “mission de survie” vient probablement de Taoudenni si l’on en juge par la transparence des morceaux de gemme. Cette cristallisation est caractéristique et unique. Nul besoin d’être minéralogiste pour identifier son origine avec certitude quand on l’a vu une fois dans sa vie. Depuis le fond des temps, cette denrée est recherchée par les populations dans tout l’Ouest saharien. Cette précieuse marchandise pouvait, à l’époque des grands empires noirs du Moyen Âge, s’échanger à poids égal contre de l’or. Aujourd’hui, les camions remplacent peu à peu le transport caravanier traditionnel des azalaï et, à partir de Tombouctou, des quantités plus importantes rayonnent dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest. Le seul gisement de Mauritanie est celui de la sebkha d’Idjil, mais il n’est plus guère exploité que pour en extraire un mélange salin contaminé par de l’argile, surtout donné aux animaux. L’inconvénient majeur du sel gemme est qu’il est dépourvu d’iode, ce qui peut induire de graves hypothyroïdies : cette carence, qui perturbe le développement cérébral, est la principale cause de retard mental et de lésions cérébrales chez les nomades. C’est pour cette raison qu’en méharée je complète toujours ma réserve par une boîte cartonnée de sel marin classique à grains fins. Mais son utilisation est moins adaptée à la rudesse du désert, où il n’est par rare de retrouver l’emballage percé ou éventré et son contenu répandu ou mélangé à du sable.
Le labeur est inhumain sur le site de Taoudenni, mais les hommes aux mains et aux pieds crevassés et brûlés par les sédiments salés qui s’y emploient à extraire le sel n’ont pas d’autre moyen de subsistance. Le travail d’excavation se fait au pic et à la sueur : les mineurs creusent le sol croûté par l’évaporation, progressant des couches superficielles de moins bonne qualité vers les couches profondes qui contiennent la fleur de sel. En général, ils atteignent l’“or blanc” à partir de 4 mètres de profondeur, puis s’enfoncent latéralement par un astucieux système de piliers qui évite l’effondrement des boyaux. À voir la beauté des strates versicolores que mettent au jour les coups de pioche, on en oublierait presque les terribles conditions de travail de ces damnés de la terre : du rouge brique au blanc pur, c’est un millefeuille de roches qui se découvre, une généalogie du sous-sol saharien que révèlent les cavités taillées en carré, étrange gruyère mitant le désert de flaques de gemmes étincelantes. À la saison froide, les plaques de sel seront transportées par caravanes entières jusqu’à Tombouctou. Au plus fort de ce commerce, ce sont des centaines de têtes par semaine qui font les allers et retours en un mois.
Les ouvriers me proposent un peu d’eau pour me désaltérer, que j’accepte volontiers. La chaleur est insupportable ; elle accroît la brutalité des conditions de cette antichambre de l’enfer. L’eau est franchement saumâtre, une des pires que j’ai eu l’occasion de boire dans le Sahara. On m’explique que beaucoup d’hommes tombent malades, souffrant de déshydratation aiguë. Cette eau impropre à la consommation, qui provient de l’unique puits de Taoudenni, leur cause en permanence des diarrhées par son taux élevé en sels minéraux. Mais il s’agit du seul point d’eau à 160 kilomètres à la ronde. Les chameliers de l’azalaï, eux, effectuent leurs réserves d’eau à Bir Ounane avant d’arriver à Taoudenni. Ici, les mineurs achètent leur nourriture à crédit auprès des boutiques de Tombouctou, selon un système de tickets. En revenant de la mine après la saison des azalaï, ils paient leurs dettes avec une partie des plaques de sel qu’ils ont extraites. Le dernier véhicule qui est passé dans le secteur était un camion de contrebande qui filait plein nord vers Teghazza, à 180 kilomètres d’ici, avant de bifurquer vers le Maroc ou l’Algérie ; il y a dix jours de cela. Le chauffeur leur a distribué des médicaments et du riz. Personne depuis ! Alors les mineurs me demandent si nous pouvons compléter leurs réserves d’eau grâce à notre véhicule. »
(p. 174-175)
Dans la peau du chamelier (p. 21-22)
Désert vivant (p. 51-53)
Extrait court


