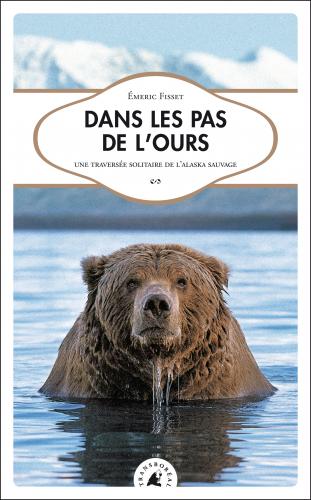
L’Indienne aux yeux pers :
« Lundi 5 novembre. Malgré une douleur persistante au genou droit, je gagne la poste : c’est une nouvelle déconvenue au sujet de mon mandat. Tandis qu’à 16 heures le soir tombe sur Grayling, je bavarde dans la grand-rue avec un villageois. Une passante parvient à notre hauteur. De taille moyenne, elle est vêtue d’une salopette tachée de cambouis. Un bandeau de laine couvre ses oreilles et dissimule en partie ses cheveux de jais, qui encadrent un doux visage. Mon interlocuteur la hèle :
“Debbie, c’est Émeric, le Français qui traverse l’Alaska !
— Hé ! Debbie ! Vous êtes de la famille Deacon ?”
Les yeux noisette de Debbie Deacon brillent de curiosité : ils paraissent refléter les vives couleurs de son chandail.
“Comment le savez-vous ?
— On m’a parlé de vous en amont !
— Et à moi de vous, mais ici !” réplique Debbie, qui paraît aimer les énigmes.
D’emblée, je suis fasciné par ce visage, où tout sourire est empreint d’amertume, par ce regard tellement différent et proche à la fois dans la vivacité de son éclat. La bise est telle sur la rue centrale que Debbie m’invite à la suivre. En claudiquant, je l’accompagne donc jusqu’au magasin qu’elle s’apprête à rouvrir. Accoudée sur son genou, un pied sur le tabouret du comptoir, Debbie m’observe. Elle m’a offert une de ces boîtes de boisson gazéifiée qui colorent les étagères derrière moi. D’une tasse qui paraît être un élément du comptoir, elle avale un café corsé, et fume. Son naturel et sa féminité me ravissent. Surpris toutefois par sa tenue de travail, je lance un : “Pourquoi diable êtes-vous ainsi fagotée ?” Celle qui me rappelle l’héroïne de Flashdance – l’un de mes films préférés – n’est pas soudeuse mais bâtisseuse. Parcourant du regard le local encombré de cartons juste livrés, de vêtements d’occasion et de marchandises en vrac sur les rayons, je demande :
“Est-ce votre magasin ?
— Non, Ten Little Indians appartient à mes parents qui habitent en face.
— Pourquoi ce nom ?
— Nous sommes dix enfants : j’ai sept sœurs et deux frères. Mais je gère le magasin familial depuis mon retour au village.”
Long silence, où je note le nez fin, légèrement busqué, et les pommettes saillantes de Debbie. Sur son front, une mèche blanche rehausse délicieusement sa chevelure bouclée, brune en fait et moutonnant jusque sur l’encolure !
“Mais qui donc vous a parlé de moi ?
— Quelqu’un en amont. À vous de deviner qui ! est la réponse que j’esquisse pour prolonger notre entretien.
— À Kaltag ?”
Je hoche négativement la tête tandis qu’une adolescente aux joues rosies entre, enrobée d’air glacial. La chaudière se remet aussitôt en marche, assourdissant les présentations. De nouveau seul avec Debbie, je livre le nom de Steven Conatser en omettant de dire qu’il a vanté sa beauté mais souligné son caractère farouche :
“C’est à Kaltag qu’on m’a parlé des talents artisanaux de votre sœur Shirley, et de vous à Eagle Island.
— C’est donc ce blanc-bec de Steven !”
La belle Indienne cultiverait-elle des préjugés à l’égard des Blancs ? Ou de certains seulement? puisqu’elle se propose de réparer mon zoom photographique.
Je retrouve Debbie le lendemain soir, peu avant la fermeture de son magasin. Auprès de Ted et de Phyllis qui ont la gentillesse de m’héberger, j’ai glané d’autres informations à son sujet. Seule, elle a bâti une étonnante maison à l’écart, près de Grayling Creek. Je demande à la visiter. Sous les denses flocons de neige, nous traversons le village à bord de la vieille Chevrolet Blazer qui sert à transborder des marchandises. Il est temps de parquer ce véhicule pour l’hiver, tant la neige le fait peiner. À l’ombrage des bouleaux, les phares dévoilent une maison de bois, dont je mesure peu à peu l’importance. Avec son toit à deux inclinaisons et deux courts pans latéraux, l’édifice dépasse 6 mètres de haut. Un échafaudage borde son côté gauche, contre lequel nous nous garons. Sitôt que nous longeons le perron de bois, une lumière s’allume automatiquement. Je remarque l’étrange forme de la fenêtre, au-dessus de la saillie vitrée du rez-de-chaussée. On dirait une goutte ! Alors que Debbie affiche la combinaison du cadenas de la porte, je demande à quoi correspond cette forme. “Ce n’est pas une goutte d’eau, mais une larme !” Je n’insiste pas.
La lumière révèle un intérieur encombré. La surface de plus de 50 mètres carrés, sur 5 mètres de hauteur, est une pièce organisée en autant d’espaces : entrée, salon, étage, cuisine/salle à manger, atelier/coin de toilette. Sur la réserve à bois intérieure, nous prélevons des bûches pour relancer le feu du poêle. Il peut avaler les deux tiers d’un stère. À droite de la porte, un canapé délimite le salon qui comprend en outre la banquette que constitue la saillie de la baie vitrée, une étagère de livres sur le pourtour, un coin téléviseur-magnétoscope et un coffre. “Désolée, ce n’est pas bien rangé, mais les travaux sont en cours !” Une volée de marches permet en effet d’accéder à la mezzanine, où des planches mal ajustées recouvrent la partie atelier et la cuisine. Dans cette dernière, un vieux réchaud à bois, un four à micro-ondes, des jerrycans d’eau et un vaisselier, enfin une longue table encombrée de livres et de papiers. Une porte donne sur l’arrière de la maison et la rivière. Un poêle d’appoint, Toyostove au fioul, borde l’atelier-établi-penderie, où un miroir et des cuvettes servent à la toilette parmi des outils et des clous. Les commodités sont à l’extérieur, au bout de la piste qui borde la niche d’un des chiens. Deux autres, caniche et chiot, traînent sous l’espace encombré de matériaux entre le sol gelé et le plancher de la maison. Les murs sont de troncs d’un seul tenant, épais de 20 centimètres et équarris. Ils sont bien ajustés, quoique de la laine de verre soit glissée sur toute leur longueur pour éviter que l’air ne filtre. De tôle brune au-dehors, le toit est de frisette au-dedans : 40 centimètres de fibre isolante séparent ces deux matériaux. Le tuyau du poêle de fonte suit la pente abrupte du toit, pour sortir à hauteur du faîte, plus plan. La décoration des murs de bois teint est simple : ici quelques assiettes, là un lé de tissu madras, ailleurs des pots à épices. Le jour issu de la mansarde en forme de larme peut être occulté par une ombrelle, qu’on abaisse ou relève à l’aide d’une ficelle. Je m’extasie de tout :
“Vous avez construit cela seule ?
— Les troncs ont été apportés du fleuve par mes frères, qui les avaient sciés et remorqués depuis l’amont ; tout le reste est selon mon idée et à la force de mes bras !”
Debbie confirme ainsi ce que la rumeur m’a appris.
Qu’a-t-elle voulu prouver, la femme indienne aux yeux pers ? Savourant un thé à l’hibiscus, nous conversons :
“Debbie, quand êtes-vous rentrée au village ?
— Il y a juste trois ans !”
Elle en a 34 maintenant.
“Et où habitiez-vous à votre retour ?
— Chez mes parents. C’est pour m’extraire du cocon familial que j’ai bâti cette maison.
— Pourquoi ne pas avoir sollicité d’aide ?
— Quand j’ai commencé le gros œuvre, tous les hommes s’employaient à draguer le fleuve pour retrouver les cadavres de deux des nôtres, morts noyés. À la fin des recherches trois semaines plus tard, le village était abattu, et j’avais pris goût au travail solitaire. L’aide à une femme célibataire risquait d’être intéressée : ceci devait rester mon seul fief.”
Debbie a mis un an à construire ce havre, que ses parents n’ont même pas visité. Par son labeur solitaire, elle a infligé un camouflet à tous les hommes de Grayling. Ce toit de 6 mètres de hauteur dans les bois est un affront aux basses maisons des villageois. Debbie est douée, ambitieuse et secrète. Intelligente et curieuse de tout aussi. Des périodiques scientifiques, tels Archeology, la revue ethnologique du Smithsonian ou Omni (le Science & Vie américain), des magazines de bricolage et le World Press Review, revue de la presse mondiale, sont étalés sur la table basse du séjour. Sur celle de la cuisine, les livres de mathématiques avoisinent des ouvrages de poésie. J’admire cette curiosité et cette ouverture au monde du fin fond de la taïga.
Debbie s’affaire à démonter mon objectif photographique. Elle comprend vite la cause de la panne : “Une couronne de rotation est cassée en trois morceaux : il n’y a qu’à recoller, en espérant que ça tienne !” Avec de la superglu, nous tentons une réparation. De nombreux essais restent vains. Ce travail commun m’incite toutefois à voler un baiser à mon hôtesse, scellant sur ses lèvres un imprévisible et total abandon. La chaste, la farouche, la rebelle se livre à moi, étranger, nomade, et Blanc de surcroît. Depuis le suicide de son ami Sean à Fairbanks – ce qui a motivé son retour au village et explique la forme des lucarnes –, Debbie est restée en marge de la compagnie des siens et des hommes. Elle se réveille à l’amour. Pour moi, blessé au genou, traqué par la saison, Debbie devient abri, recours, oubli. Nos enlacements exorcisent-ils la crainte et la mainmise de l’hiver ? Debbie m’ouvre-t-elle sa porte et ses bras par pitié, au vu de ma solitude et de mon handicap ? Est-ce l’originalité de mon périple qui la séduit, comme je suis séduit par sa personnalité ? Dans les jours qui suivent, nous ne nous quittons guère. Je la retrouve chez elle au matin, au magasin le soir, et je rentre dans la nuit chez Ted et Phyllis. Les chiens n’aboient plus à mon départ, quand Debbie, enveloppée d’une couverture, me presse une dernière fois contre son corps dont l’épaisseur de mes vêtements dérobe la brûlante sensation. Le sous-bois devient complice de mes retours tardifs. Les flocons de neige effacent ma trace jusqu’à la maison voisine, celle de Lilian, où je rejoins la piste damée. »
Dans la splendeur de la chaîne de Brooks (p. 83-87)
L’Aniakchak (p. 352-355)
Extrait court
« Lundi 5 novembre. Malgré une douleur persistante au genou droit, je gagne la poste : c’est une nouvelle déconvenue au sujet de mon mandat. Tandis qu’à 16 heures le soir tombe sur Grayling, je bavarde dans la grand-rue avec un villageois. Une passante parvient à notre hauteur. De taille moyenne, elle est vêtue d’une salopette tachée de cambouis. Un bandeau de laine couvre ses oreilles et dissimule en partie ses cheveux de jais, qui encadrent un doux visage. Mon interlocuteur la hèle :
“Debbie, c’est Émeric, le Français qui traverse l’Alaska !
— Hé ! Debbie ! Vous êtes de la famille Deacon ?”
Les yeux noisette de Debbie Deacon brillent de curiosité : ils paraissent refléter les vives couleurs de son chandail.
“Comment le savez-vous ?
— On m’a parlé de vous en amont !
— Et à moi de vous, mais ici !” réplique Debbie, qui paraît aimer les énigmes.
D’emblée, je suis fasciné par ce visage, où tout sourire est empreint d’amertume, par ce regard tellement différent et proche à la fois dans la vivacité de son éclat. La bise est telle sur la rue centrale que Debbie m’invite à la suivre. En claudiquant, je l’accompagne donc jusqu’au magasin qu’elle s’apprête à rouvrir. Accoudée sur son genou, un pied sur le tabouret du comptoir, Debbie m’observe. Elle m’a offert une de ces boîtes de boisson gazéifiée qui colorent les étagères derrière moi. D’une tasse qui paraît être un élément du comptoir, elle avale un café corsé, et fume. Son naturel et sa féminité me ravissent. Surpris toutefois par sa tenue de travail, je lance un : “Pourquoi diable êtes-vous ainsi fagotée ?” Celle qui me rappelle l’héroïne de Flashdance – l’un de mes films préférés – n’est pas soudeuse mais bâtisseuse. Parcourant du regard le local encombré de cartons juste livrés, de vêtements d’occasion et de marchandises en vrac sur les rayons, je demande :
“Est-ce votre magasin ?
— Non, Ten Little Indians appartient à mes parents qui habitent en face.
— Pourquoi ce nom ?
— Nous sommes dix enfants : j’ai sept sœurs et deux frères. Mais je gère le magasin familial depuis mon retour au village.”
Long silence, où je note le nez fin, légèrement busqué, et les pommettes saillantes de Debbie. Sur son front, une mèche blanche rehausse délicieusement sa chevelure bouclée, brune en fait et moutonnant jusque sur l’encolure !
“Mais qui donc vous a parlé de moi ?
— Quelqu’un en amont. À vous de deviner qui ! est la réponse que j’esquisse pour prolonger notre entretien.
— À Kaltag ?”
Je hoche négativement la tête tandis qu’une adolescente aux joues rosies entre, enrobée d’air glacial. La chaudière se remet aussitôt en marche, assourdissant les présentations. De nouveau seul avec Debbie, je livre le nom de Steven Conatser en omettant de dire qu’il a vanté sa beauté mais souligné son caractère farouche :
“C’est à Kaltag qu’on m’a parlé des talents artisanaux de votre sœur Shirley, et de vous à Eagle Island.
— C’est donc ce blanc-bec de Steven !”
La belle Indienne cultiverait-elle des préjugés à l’égard des Blancs ? Ou de certains seulement? puisqu’elle se propose de réparer mon zoom photographique.
Je retrouve Debbie le lendemain soir, peu avant la fermeture de son magasin. Auprès de Ted et de Phyllis qui ont la gentillesse de m’héberger, j’ai glané d’autres informations à son sujet. Seule, elle a bâti une étonnante maison à l’écart, près de Grayling Creek. Je demande à la visiter. Sous les denses flocons de neige, nous traversons le village à bord de la vieille Chevrolet Blazer qui sert à transborder des marchandises. Il est temps de parquer ce véhicule pour l’hiver, tant la neige le fait peiner. À l’ombrage des bouleaux, les phares dévoilent une maison de bois, dont je mesure peu à peu l’importance. Avec son toit à deux inclinaisons et deux courts pans latéraux, l’édifice dépasse 6 mètres de haut. Un échafaudage borde son côté gauche, contre lequel nous nous garons. Sitôt que nous longeons le perron de bois, une lumière s’allume automatiquement. Je remarque l’étrange forme de la fenêtre, au-dessus de la saillie vitrée du rez-de-chaussée. On dirait une goutte ! Alors que Debbie affiche la combinaison du cadenas de la porte, je demande à quoi correspond cette forme. “Ce n’est pas une goutte d’eau, mais une larme !” Je n’insiste pas.
La lumière révèle un intérieur encombré. La surface de plus de 50 mètres carrés, sur 5 mètres de hauteur, est une pièce organisée en autant d’espaces : entrée, salon, étage, cuisine/salle à manger, atelier/coin de toilette. Sur la réserve à bois intérieure, nous prélevons des bûches pour relancer le feu du poêle. Il peut avaler les deux tiers d’un stère. À droite de la porte, un canapé délimite le salon qui comprend en outre la banquette que constitue la saillie de la baie vitrée, une étagère de livres sur le pourtour, un coin téléviseur-magnétoscope et un coffre. “Désolée, ce n’est pas bien rangé, mais les travaux sont en cours !” Une volée de marches permet en effet d’accéder à la mezzanine, où des planches mal ajustées recouvrent la partie atelier et la cuisine. Dans cette dernière, un vieux réchaud à bois, un four à micro-ondes, des jerrycans d’eau et un vaisselier, enfin une longue table encombrée de livres et de papiers. Une porte donne sur l’arrière de la maison et la rivière. Un poêle d’appoint, Toyostove au fioul, borde l’atelier-établi-penderie, où un miroir et des cuvettes servent à la toilette parmi des outils et des clous. Les commodités sont à l’extérieur, au bout de la piste qui borde la niche d’un des chiens. Deux autres, caniche et chiot, traînent sous l’espace encombré de matériaux entre le sol gelé et le plancher de la maison. Les murs sont de troncs d’un seul tenant, épais de 20 centimètres et équarris. Ils sont bien ajustés, quoique de la laine de verre soit glissée sur toute leur longueur pour éviter que l’air ne filtre. De tôle brune au-dehors, le toit est de frisette au-dedans : 40 centimètres de fibre isolante séparent ces deux matériaux. Le tuyau du poêle de fonte suit la pente abrupte du toit, pour sortir à hauteur du faîte, plus plan. La décoration des murs de bois teint est simple : ici quelques assiettes, là un lé de tissu madras, ailleurs des pots à épices. Le jour issu de la mansarde en forme de larme peut être occulté par une ombrelle, qu’on abaisse ou relève à l’aide d’une ficelle. Je m’extasie de tout :
“Vous avez construit cela seule ?
— Les troncs ont été apportés du fleuve par mes frères, qui les avaient sciés et remorqués depuis l’amont ; tout le reste est selon mon idée et à la force de mes bras !”
Debbie confirme ainsi ce que la rumeur m’a appris.
Qu’a-t-elle voulu prouver, la femme indienne aux yeux pers ? Savourant un thé à l’hibiscus, nous conversons :
“Debbie, quand êtes-vous rentrée au village ?
— Il y a juste trois ans !”
Elle en a 34 maintenant.
“Et où habitiez-vous à votre retour ?
— Chez mes parents. C’est pour m’extraire du cocon familial que j’ai bâti cette maison.
— Pourquoi ne pas avoir sollicité d’aide ?
— Quand j’ai commencé le gros œuvre, tous les hommes s’employaient à draguer le fleuve pour retrouver les cadavres de deux des nôtres, morts noyés. À la fin des recherches trois semaines plus tard, le village était abattu, et j’avais pris goût au travail solitaire. L’aide à une femme célibataire risquait d’être intéressée : ceci devait rester mon seul fief.”
Debbie a mis un an à construire ce havre, que ses parents n’ont même pas visité. Par son labeur solitaire, elle a infligé un camouflet à tous les hommes de Grayling. Ce toit de 6 mètres de hauteur dans les bois est un affront aux basses maisons des villageois. Debbie est douée, ambitieuse et secrète. Intelligente et curieuse de tout aussi. Des périodiques scientifiques, tels Archeology, la revue ethnologique du Smithsonian ou Omni (le Science & Vie américain), des magazines de bricolage et le World Press Review, revue de la presse mondiale, sont étalés sur la table basse du séjour. Sur celle de la cuisine, les livres de mathématiques avoisinent des ouvrages de poésie. J’admire cette curiosité et cette ouverture au monde du fin fond de la taïga.
Debbie s’affaire à démonter mon objectif photographique. Elle comprend vite la cause de la panne : “Une couronne de rotation est cassée en trois morceaux : il n’y a qu’à recoller, en espérant que ça tienne !” Avec de la superglu, nous tentons une réparation. De nombreux essais restent vains. Ce travail commun m’incite toutefois à voler un baiser à mon hôtesse, scellant sur ses lèvres un imprévisible et total abandon. La chaste, la farouche, la rebelle se livre à moi, étranger, nomade, et Blanc de surcroît. Depuis le suicide de son ami Sean à Fairbanks – ce qui a motivé son retour au village et explique la forme des lucarnes –, Debbie est restée en marge de la compagnie des siens et des hommes. Elle se réveille à l’amour. Pour moi, blessé au genou, traqué par la saison, Debbie devient abri, recours, oubli. Nos enlacements exorcisent-ils la crainte et la mainmise de l’hiver ? Debbie m’ouvre-t-elle sa porte et ses bras par pitié, au vu de ma solitude et de mon handicap ? Est-ce l’originalité de mon périple qui la séduit, comme je suis séduit par sa personnalité ? Dans les jours qui suivent, nous ne nous quittons guère. Je la retrouve chez elle au matin, au magasin le soir, et je rentre dans la nuit chez Ted et Phyllis. Les chiens n’aboient plus à mon départ, quand Debbie, enveloppée d’une couverture, me presse une dernière fois contre son corps dont l’épaisseur de mes vêtements dérobe la brûlante sensation. Le sous-bois devient complice de mes retours tardifs. Les flocons de neige effacent ma trace jusqu’à la maison voisine, celle de Lilian, où je rejoins la piste damée. »
(p. 181-186)
Dans la splendeur de la chaîne de Brooks (p. 83-87)
L’Aniakchak (p. 352-355)
Extrait court


