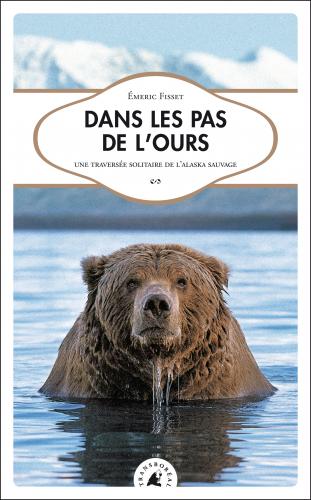
Dans la splendeur de la chaîne de Brooks :
« Incomparable splendeur de la haute vallée de cet Alatna qui, via la Koyukuk, grossira les eaux du fleuve Yukon ! Les versants brun et rouge, d’abord austères et étroits, font peu à peu place à la forêt, saisissante symphonie d’aiguilles, de feuilles et de lichens : or, verts, marron, orangés, mais aussi pourpres et blancs. Aux hautes pentes dénudées, aux arêtes brunes, aux pics enneigés répondent les couverts opaques. Ils alternent avec des escarpements et des lacs, des replis marécageux et des eaux vives. La carte signale aussi des sources chaudes et des glaciers.
Je me trouve au début de la taïga, à mi-pente de la rive gauche de l’Alatna. Devant moi, rougeoyants, les aulnes croissent en langues boisées et m’arrivent aux épaules. Derrière eux, brillant de toutes leurs feuilles jaunissantes, les bouleaux. Ils occupent le bas de la vallée et, sur ce versant exposé au sud, viennent piqueter d’or la forêt d’épicéas. Sur l’autre versant, ces derniers ourlent de vert le cours d’eau, avant que les mottes fuchsia de la toundra alpine ne les remplacent dès que le terrain s’élève. Là où la terre est moins ravinée pointe l’épinette noire. Sur le versant plus encombré où je me tiens, l’épicéa s’étage jusqu’à la ligne des premières collines. En montagne chez nous, c’est à l’ombre que croissent les forêts de conifères les plus denses ; ici, c’est le contraire. L’Alatna, dont je domine le lit changeant, sinue en épousant le talweg. Avec ses berges frangées de saules buissonnants, le torrent brille de tous les galets blancs sur ses lits de hautes eaux, et des reflets argentés de ses bras ruisselant de part et d’autre d’îlots. Entre la toundra maritime et l’oppressante forêt boréale aperçue à Fairbanks, je goûte la sérénité de ce décor sur lequel seuls quelques névés et nuages jettent un soupçon d’effroi. C’est le court été indien?
Luttant contre la pente et la forêt, je mets une journée à couvrir 12 kilomètres. J’avance lentement, le regard fixé au sol sur les souches et les troncs qui semblent entraver exprès ma marche, quand un hurlement me fait tourner brusquement la tête. Au-dessus de moi, à 20 mètres, un loup ! Gris-blanc, pelé, babines retroussées et mouillées : je le prends d’abord pour un chien errant. Il gronde, l’échine terriblement hérissée. Je projette du gaz de la bombe que je porte en permanence au côté. Le nuage orange d’extraits de Capsicum paraît inefficace, sauf à mon endroit? Je dévale la pente, les yeux rivés sur la bête campée sur ses pattes antérieures, toujours menaçante. L’agressivité du loup envers l’homme est un mythe, sauf lors des hivers de famine (ou dans les films). Alors, est-ce une mère protégeant ses petits, un sujet blessé ou malade, voire enragé ?
Deux cents mètres plus loin, je me remets de ces émotions. Le cri d’alerte d’un écureuil, régulier et strident, anime les abords du torrent, tandis qu’un lièvre bondit. Des aigles et un faucon pèlerin m’invitent à marquer une pause pour observer leur vol altier. C’est l’occasion de me débarrasser de toutes les aiguilles qui me grattent le cou et le bas du dos. Assis, je grignote des biscuits. Une femelle caribou et son petit paissent parmi les mousses de la piste et abordent avec confiance mon promontoire. Ailleurs, posté dans les bosquets du torrent, je laisse la dernière harde de caribous entrevue guéer le cours d’eau : les trente bêtes s’ébrouent dans une gerbe de gouttelettes étincelantes puis se bousculent pour gravir la berge. Rassurées, elles franchissent alors en ordre dispersé la pente rocailleuse : simples lignes de dos et de ramures oscillant dans le rougeoiement des arbustes. Je m’étonne de l’aptitude de l’orignal à traverser les fourrés denses. Malgré son air toujours perplexe et sa haute parure de tête – jusqu’à 40 kilos chez les vieux mâles –, il semble se jouer des taillis mieux que le randonneur. Je souris à la naïveté de la gelinotte qui se croit cachée derrière des ramilles. J’observe les oies et les canards migrants. Sur une mare moins enchâssée par les résineux que d’autres, je surprends même des cygnes trompette. Blancs mais au plumage sali, le long bec noir jusqu’à l’œil, ils ne soulignent pas leur envol de la sonnerie de buccin qui leur vaut la désignation de Cygnus buccinator. Ils m’ont toutefois donné l’impression d’être plus grands que des cygnes de toundra – ou C. columbianus –, moins rares à cette latitude. Je manque les mouflons de Dall, pourtant estimés à trente mille dans la chaîne de Brooks, mais en découvre un trophée qui s’efface sur la berge du torrent. Les cornes annelées et puissantes s’enroulent sur le sol pour pointer encore vers les cimes que l’animal a hantées, avant de succomber aux loups de la vallée.
Les grizzlis, au sujet desquels on m’a tant mis en garde, deviennent une présence certes occasionnelle, mais toujours attendue. Semblable au pied nu d’un humain, la trace des pattes postérieures de l’ours marque toutes les berges de l’Alatna, particulièrement au débouché du torrent issu de l’Arrigetch. Ce terme évoque en eskimo les doigts tendus d’une main, à l’image de ces cinq pics de quelque 2 000 mètres d’altitude, comprenant le troisième sommet de l’ouest des Brooks. Face à Arrigetch Creek donc, je surprends un baribal – Ursus americanus – qui s’ébroue après sa traversée du torrent à la nage. De son pas lent et chaloupé, il s’approche, indifférent à toute présence, avant de s’étonner de la mienne, un peu tremblante derrière des branches sur le lit de hautes eaux. L’animal me contourne pour disparaître dans le sous-bois qui lui est familier.
Pendant dix jours, je marche sur les traces des animaux, rencontrant les mêmes obstacles qu’eux : chablis ou escarpement, et connaissant peut-être les mêmes craintes. Féerie animale, profusion végétale exténuante. Nature intacte, rendue plus humaine par mes chants et célébrée par les poèmes que j’y déclame. Accroché à un branchage du lit de Pegeeluk Creek, j’ai découvert un bout de doublure blanche, mais la proche empreinte de pas – probablement d’un ourson – n’a rien à voir avec elle. Si je n’avais pas rencontré les chasseurs en amont, qu’aurais-je pu lui associer ? Et n’aurais-je pas été tenté de voir dans cette empreinte celle d’un pied humain ? Cet indice de présence m’a rassuré au sein de la forêt plus dense et encombrée.
Qu’elle est donc épaisse, cette forêt ! Je rate au soir les vestiges de la cahute indiquée par Jeff. Au confluent du torrent Unakserak et de l’Alatna, j’en cherche désespérément une autre le lendemain. Outre le souci du gibier, toute cabane de trappe requiert une protection contre les vents dominants, dans le sous-bois puisque les questions de luminosité ne s’y posent guère l’hiver. Je parcours la rive en tout sens : rien. Une seule certitude : l’après-midi avance. Je vais être contraint de planter ma tente à quelques centaines de mètres de l’abri ! J’enrage mais, ayant progressé depuis le matin sur cette idée, je suis bien incapable de poursuivre mon chemin. Finalement, au-dessus d’un bras sec à cette saison, j’aperçois quatre troncs qui paraissent étayer encore la berge. L’abri laisse pointer sa couverture d’herbes folles. Porte arrachée, toit crevé : l’intérieur de la cabane est rongé par les intempéries et envahi de lambeaux d’écorce, de feuilles et d’écales de noix laissées par les écureuils. Sous un marteau, je déchiffre un bout de papier parcheminé :
“Mars 1984, Unakserak. Cette cabane est utilisée chaque hiver selon les termes d’un permis délivré par le Service des parcs nationaux. Les pièges m’appartiennent et ne sont pas abandonnés. Jim Schwarber, Kutuk, via Bettles. 27 juillet 1990. Passage du ranger Stockhouse.”
Avec des brindilles, je balaie le sol de ses résidus organiques. Au-dessus du châlit dont je secoue les planches, certaines lattes du toit sont à remettre en place. Je rassemble les débris de la porte. Au dos d’un battant, une inscription du Service des parcs nationaux m’apprend qu’une autorisation est nécessaire pour utiliser l’abri. Et à retirer à Fairbanks, s’il vous plaît ! Je m’installe sans hésiter dans cette cahute, mon premier refuge depuis celui de James Kignak Sr au sud d’Atqasuk. J’ai déniché des bottes en toile de canevas blanc ; je les enfile, revêts ma fourrure polaire et attends la nuit en lisant The Alaska Almanac, mon seul livre. L’air frais et humide tombe sur le bois qu’un pic épeiche cesse de marteler. Demain, si je cavale tout le jour, j’aurai une vraie cabane, celle de Bernd, le pilote de l’hydravion? »
L’Indienne aux yeux pers (p. 181-186)
L’Aniakchak (p. 352-355)
Extrait court
« Incomparable splendeur de la haute vallée de cet Alatna qui, via la Koyukuk, grossira les eaux du fleuve Yukon ! Les versants brun et rouge, d’abord austères et étroits, font peu à peu place à la forêt, saisissante symphonie d’aiguilles, de feuilles et de lichens : or, verts, marron, orangés, mais aussi pourpres et blancs. Aux hautes pentes dénudées, aux arêtes brunes, aux pics enneigés répondent les couverts opaques. Ils alternent avec des escarpements et des lacs, des replis marécageux et des eaux vives. La carte signale aussi des sources chaudes et des glaciers.
Je me trouve au début de la taïga, à mi-pente de la rive gauche de l’Alatna. Devant moi, rougeoyants, les aulnes croissent en langues boisées et m’arrivent aux épaules. Derrière eux, brillant de toutes leurs feuilles jaunissantes, les bouleaux. Ils occupent le bas de la vallée et, sur ce versant exposé au sud, viennent piqueter d’or la forêt d’épicéas. Sur l’autre versant, ces derniers ourlent de vert le cours d’eau, avant que les mottes fuchsia de la toundra alpine ne les remplacent dès que le terrain s’élève. Là où la terre est moins ravinée pointe l’épinette noire. Sur le versant plus encombré où je me tiens, l’épicéa s’étage jusqu’à la ligne des premières collines. En montagne chez nous, c’est à l’ombre que croissent les forêts de conifères les plus denses ; ici, c’est le contraire. L’Alatna, dont je domine le lit changeant, sinue en épousant le talweg. Avec ses berges frangées de saules buissonnants, le torrent brille de tous les galets blancs sur ses lits de hautes eaux, et des reflets argentés de ses bras ruisselant de part et d’autre d’îlots. Entre la toundra maritime et l’oppressante forêt boréale aperçue à Fairbanks, je goûte la sérénité de ce décor sur lequel seuls quelques névés et nuages jettent un soupçon d’effroi. C’est le court été indien?
Luttant contre la pente et la forêt, je mets une journée à couvrir 12 kilomètres. J’avance lentement, le regard fixé au sol sur les souches et les troncs qui semblent entraver exprès ma marche, quand un hurlement me fait tourner brusquement la tête. Au-dessus de moi, à 20 mètres, un loup ! Gris-blanc, pelé, babines retroussées et mouillées : je le prends d’abord pour un chien errant. Il gronde, l’échine terriblement hérissée. Je projette du gaz de la bombe que je porte en permanence au côté. Le nuage orange d’extraits de Capsicum paraît inefficace, sauf à mon endroit? Je dévale la pente, les yeux rivés sur la bête campée sur ses pattes antérieures, toujours menaçante. L’agressivité du loup envers l’homme est un mythe, sauf lors des hivers de famine (ou dans les films). Alors, est-ce une mère protégeant ses petits, un sujet blessé ou malade, voire enragé ?
Deux cents mètres plus loin, je me remets de ces émotions. Le cri d’alerte d’un écureuil, régulier et strident, anime les abords du torrent, tandis qu’un lièvre bondit. Des aigles et un faucon pèlerin m’invitent à marquer une pause pour observer leur vol altier. C’est l’occasion de me débarrasser de toutes les aiguilles qui me grattent le cou et le bas du dos. Assis, je grignote des biscuits. Une femelle caribou et son petit paissent parmi les mousses de la piste et abordent avec confiance mon promontoire. Ailleurs, posté dans les bosquets du torrent, je laisse la dernière harde de caribous entrevue guéer le cours d’eau : les trente bêtes s’ébrouent dans une gerbe de gouttelettes étincelantes puis se bousculent pour gravir la berge. Rassurées, elles franchissent alors en ordre dispersé la pente rocailleuse : simples lignes de dos et de ramures oscillant dans le rougeoiement des arbustes. Je m’étonne de l’aptitude de l’orignal à traverser les fourrés denses. Malgré son air toujours perplexe et sa haute parure de tête – jusqu’à 40 kilos chez les vieux mâles –, il semble se jouer des taillis mieux que le randonneur. Je souris à la naïveté de la gelinotte qui se croit cachée derrière des ramilles. J’observe les oies et les canards migrants. Sur une mare moins enchâssée par les résineux que d’autres, je surprends même des cygnes trompette. Blancs mais au plumage sali, le long bec noir jusqu’à l’œil, ils ne soulignent pas leur envol de la sonnerie de buccin qui leur vaut la désignation de Cygnus buccinator. Ils m’ont toutefois donné l’impression d’être plus grands que des cygnes de toundra – ou C. columbianus –, moins rares à cette latitude. Je manque les mouflons de Dall, pourtant estimés à trente mille dans la chaîne de Brooks, mais en découvre un trophée qui s’efface sur la berge du torrent. Les cornes annelées et puissantes s’enroulent sur le sol pour pointer encore vers les cimes que l’animal a hantées, avant de succomber aux loups de la vallée.
Les grizzlis, au sujet desquels on m’a tant mis en garde, deviennent une présence certes occasionnelle, mais toujours attendue. Semblable au pied nu d’un humain, la trace des pattes postérieures de l’ours marque toutes les berges de l’Alatna, particulièrement au débouché du torrent issu de l’Arrigetch. Ce terme évoque en eskimo les doigts tendus d’une main, à l’image de ces cinq pics de quelque 2 000 mètres d’altitude, comprenant le troisième sommet de l’ouest des Brooks. Face à Arrigetch Creek donc, je surprends un baribal – Ursus americanus – qui s’ébroue après sa traversée du torrent à la nage. De son pas lent et chaloupé, il s’approche, indifférent à toute présence, avant de s’étonner de la mienne, un peu tremblante derrière des branches sur le lit de hautes eaux. L’animal me contourne pour disparaître dans le sous-bois qui lui est familier.
Pendant dix jours, je marche sur les traces des animaux, rencontrant les mêmes obstacles qu’eux : chablis ou escarpement, et connaissant peut-être les mêmes craintes. Féerie animale, profusion végétale exténuante. Nature intacte, rendue plus humaine par mes chants et célébrée par les poèmes que j’y déclame. Accroché à un branchage du lit de Pegeeluk Creek, j’ai découvert un bout de doublure blanche, mais la proche empreinte de pas – probablement d’un ourson – n’a rien à voir avec elle. Si je n’avais pas rencontré les chasseurs en amont, qu’aurais-je pu lui associer ? Et n’aurais-je pas été tenté de voir dans cette empreinte celle d’un pied humain ? Cet indice de présence m’a rassuré au sein de la forêt plus dense et encombrée.
Qu’elle est donc épaisse, cette forêt ! Je rate au soir les vestiges de la cahute indiquée par Jeff. Au confluent du torrent Unakserak et de l’Alatna, j’en cherche désespérément une autre le lendemain. Outre le souci du gibier, toute cabane de trappe requiert une protection contre les vents dominants, dans le sous-bois puisque les questions de luminosité ne s’y posent guère l’hiver. Je parcours la rive en tout sens : rien. Une seule certitude : l’après-midi avance. Je vais être contraint de planter ma tente à quelques centaines de mètres de l’abri ! J’enrage mais, ayant progressé depuis le matin sur cette idée, je suis bien incapable de poursuivre mon chemin. Finalement, au-dessus d’un bras sec à cette saison, j’aperçois quatre troncs qui paraissent étayer encore la berge. L’abri laisse pointer sa couverture d’herbes folles. Porte arrachée, toit crevé : l’intérieur de la cabane est rongé par les intempéries et envahi de lambeaux d’écorce, de feuilles et d’écales de noix laissées par les écureuils. Sous un marteau, je déchiffre un bout de papier parcheminé :
“Mars 1984, Unakserak. Cette cabane est utilisée chaque hiver selon les termes d’un permis délivré par le Service des parcs nationaux. Les pièges m’appartiennent et ne sont pas abandonnés. Jim Schwarber, Kutuk, via Bettles. 27 juillet 1990. Passage du ranger Stockhouse.”
Avec des brindilles, je balaie le sol de ses résidus organiques. Au-dessus du châlit dont je secoue les planches, certaines lattes du toit sont à remettre en place. Je rassemble les débris de la porte. Au dos d’un battant, une inscription du Service des parcs nationaux m’apprend qu’une autorisation est nécessaire pour utiliser l’abri. Et à retirer à Fairbanks, s’il vous plaît ! Je m’installe sans hésiter dans cette cahute, mon premier refuge depuis celui de James Kignak Sr au sud d’Atqasuk. J’ai déniché des bottes en toile de canevas blanc ; je les enfile, revêts ma fourrure polaire et attends la nuit en lisant The Alaska Almanac, mon seul livre. L’air frais et humide tombe sur le bois qu’un pic épeiche cesse de marteler. Demain, si je cavale tout le jour, j’aurai une vraie cabane, celle de Bernd, le pilote de l’hydravion? »
(p. 83-87)
L’Indienne aux yeux pers (p. 181-186)
L’Aniakchak (p. 352-355)
Extrait court


