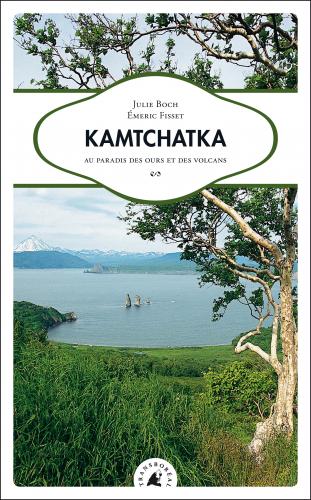
En pays évène :
« Une tente conique est plantée, îlot de vie humaine, au milieu de l’austère paysage de montagne, près d’un ruisseau qui coule entre des arbres jaunissants. On nous a vus. Une toute petite fille court se réfugier sous la yourte. Un instant plus tard, deux hommes apparaissent, nous souhaitent la bienvenue et nous invitent à entrer sous l’abri de leur maison de toile. Elle ne doit pas différer beaucoup de celles dont Barthélemy de Lesseps disait il y a plus de deux cents ans que leur architecture paraissait “remonter aux premiers âges du monde”. L’ouverture en est orientée vers l’est, c’est-à-dire vers la vie.
Neuf personnes se serrent autour d’un feu qui brûle à même le sol, exhalant un filet de fumée claire qui s’échappe par un trou du toit : Vadim, un homme de 50 ans qui en paraît 70, Piotr Illitch et Anastasia, un couple de quadragénaires, Gricha et Andreï, deux adolescents, Iloana, 3 ans, enfin Ilya et deux Sergueï, tous trois la trentaine. Les liens qui unissent cette famille élargie sont difficiles à saisir de prime abord. S’il nous apparaît vite que Gricha et Iloana sont les enfants de Piotr et de l’unique femme du campement, nous avons du mal à comprendre quelle est la place qu’occupe Andreï, dont le visage fermé respire une profonde tristesse, et les trois jeunes célibataires dans cette microsociété d’altitude. Les visages plats, les pommettes hautes, les yeux intensément mystérieux de nos hôtes évènes sont une belle déclinaison du type ouralo-altaïque.
Au fond de la yourte, une chambrette est cachée par un rideau. On nous fait asseoir à la place d’honneur, sur des branches de cèdre et des peaux de renne. Des lanières de viande durcie pendent à sécher. Près de l’entrée, de gros quartiers saignants sont étendus sur des piquets croisés. Il n’y a ni mobilier ni ustensiles. La pauvreté, nue. Pourtant, on nous offre avec empressement un bol de renne bouilli, du thé et un pain léger et brûlant, qu’Anastasia pétrit devant nous et cuit dans un moule en fonte. Un poste de radio crachote dans un coin. On passe le Deuxième nocturne de Chopin. Et cette musique de salon, si raffinée, si foncièrement européenne, se trouve miraculeusement accordée à la yourte plantée sur une montagne sauvage d’Extrême-Orient.
Gricha et Iloana, vive fillette aux yeux brillants dont la timidité cède peu à peu à la curiosité qu’éveille notre présence, nous emmènent voir le troupeau qui paît au bord du lac. Il y a là plus de mille têtes, dont les robes brunes, blanches et baies dessinent un tableau bucolique dans le décor de pierre et d’eau. Les rennes se confondent si bien avec le paysage alentour, dont ils ont pris les couleurs, que nous ne les avions pas vus depuis la crête. Des velours sanglants traînent dans les branches de pin où les bêtes les accrochent. Le bruit lancinant du broutement de l’herbe se mêle au cliquetis des bois qui s’entrechoquent. Du côté du campement, le sol n’est plus qu’une arène piétinée, sans un brin d’herbe. Depuis une semaine que les éleveurs sont là, les rennes ont dévoré toute la végétation alentour. Bientôt, il faudra se déplacer d’une dizaine de kilomètres, vers un autre lieu de pâture. Piotr et Andreï, en treillis, sac de cuir en bandoulière, bâton en main, carabine en travers du corps, surveillent le troupeau à la jumelle. La nuit, l’enfant doit veiller près des bêtes. De petits chevaux vigoureux s’abreuvent aux lacets d’argent qui alimentent le lac. Assis en tailleur devant la yourte, Vadim taille un manche de poignard dans un morceau de ramure. Dans cette “civilisation du renne”, tout est utilisé de l’animal : viande, peau, bois, tendons. Il y a moins d’un siècle encore, les autochtones refusaient de vendre un renne vivant, quel que fût le prix qu’on leur en proposait. C’est dire l’importance symbolique que revêt l’animal.
Nous offrons les plus précieuses de nos provisions : fromage, lait concentré, chocolat. Faut-il avouer que nous eûmes une hésitation mesquine au moment de nous séparer du pot de confiture donné par les géologues, que nous n’avions même pas ouvert ? Mais que vaudrait le potlatch s’il ne concernait un bien d’échange fondamental ? Aussi apportons-nous le délice de myrtilles, que nos hôtes engloutissent sous nos yeux sans nous en proposer. C’est dans l’ordre des choses. Nous avons fait irruption dans leur vie sans y être invités, ils nous ont reçus et nous ont gratifiés du pittoresque que nous étions venus chercher. Malgré tout, cet ordre des choses nous fait peine : nous souffrons, pour la première fois depuis le début de notre voyage, de ne pas être débiteurs. Il y a ordinairement plus de plaisir à donner qu’à devoir et pourtant, voilà plusieurs semaines que nous acceptons avec joie d’être les obligés de ceux qui nous nourrissent. Là, soudain, face à ces plus pauvres que nous, le rapport s’inverse, et nous sentons durement notre richesse.
Nous demandons l’autorisation de planter notre tente près de la yourte. Tout le monde vient nous voir faire, curieux d’observer l’équipement de ces Français dont les guêtres et les sacs à dos ont déjà été appréciés en connaisseurs. Un cercle silencieux se forme autour de nous. Nerveux, nous plantons les piquets en ayant soin de ménager un passant déchiré sur le devant, sommairement recousu à la cabane d’Ouzon. Mais un garçon, croyant bien faire, s’avise de tendre la toile molle, tire sur le passant et l’arrache. Du coup, inattentifs, nous cassons net l’arceau de titane que nous étions en train d’enfiler dans le toit. Nous jurons contre notre maladresse. Autour de nous, le silence, gêné, s’épaissit, et chacun repart sans un mot sous la yourte pour nous éviter l’humiliation. Nous sommes vexés, stupides, avec notre beau matériel en ruine ; ils doivent bien rire, à côté, sous leur installation de bouleau et de toile de coton ! Après avoir recollé vaille que vaille l’arceau brisé avec du ruban adhésif, nous passons une nuit glaciale dans notre tente bancale.
C’est le jour de la coupe des bois et de la castration des rennes. Elles sont nécessaires pour empêcher les mâles en rut de se battre entre eux. Le troupeau est rassemblé sur le plateau, et se met à tourner spontanément en cercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, “à rebours du soleil”, disent les Évènes. Le spectacle est hypnotique. La forêt de bois oscille au son mat des sabots qui frappent la terre nue. Avec dextérité, les éleveurs attrapent les bêtes, par une patte ou par la ramure, d’un lancer de leur lasso de cuir. Les rennes ne sont pas des vaches : ils bondissent et se cabrent si fort qu’il faut trois hommes arc-boutés pour tenir le lasso et remonter jusqu’à la tête. Alors, l’un d’eux tient les bois et fait plier l’échine, obligeant l’animal à se coucher sur le dos. Un coup de poing sur le museau l’aide au besoin à se rendre à raison. Un homme saute sur la panse, et, en un instant, un troisième scie les andouillers tandis qu’un quatrième sectionne les bourses au couteau. Les globes translucides roulent sur la toundra. La mère de famille, cigarette au bec, court d’un groupe à l’autre, la scie à senestre, qu’elle tend à l’officiant au moment propice, et dans la dextre un sac où ballottent les testicules ramassés sur le champ de bataille. Nous craignons pour le dîner du soir? Mais ces trophées, Dieu merci, seront donnés aux chiens.
Iloana, en mal de compagnons de jeu, nous sollicite sans cesse. Quelle aubaine que ces deux étrangers complaisants qui acceptent de faire le cheval, le renne et l’ours, de se mettre à quatre pattes, de brouter, de se laisser monter, de ruer, de jouer à cache-cache, à colin-maillard, à tous ces jeux universels et simples qui ne demandent ni piles ni console et ne tombent jamais en panne ! Elle nous épuise davantage qu’une journée de marche. De temps à autre, elle appelle le chien ou attrape un énorme chat blanc, Gocha, d’une absolue placidité, qui se laisse pendre entre ses bras et accepte sans broncher d’être manœuvré dans tous les sens. Sous la tente, Anastasia essaie de contacter Esso avec un émetteur à manivelle. Dans le clair-obscur du feu mourant, tandis qu’elle mouline avec ardeur, elle ressemble à une résistante des temps héroïques, ou à quelque espionne de film noir qui chuchote des informations secrètes à son lointain commanditaire. Mais la fréquence ne passe pas ; il y a trop de nuages. Rien ne vaut finalement le bon vieux système du pinghil, ce phénomène de transmission orale que les ethnologues appellent “radio-renne”?
Qu’ont gagné les Évènes à la soviétisation de la péninsule ? Le système communiste leur a apporté l’éducation, la possibilité de faire autre chose que leurs parents et des soupes en sachet. Mais ils ont perdu leur langue, dont la transmission a été mise à mal par le système d’internat obligatoire imposé à partir de 1957 aux enfants autochtones, et ont troqué leurs beaux habits de peaux contre les hardes internationales et les vêtements militaires. Leur dénuement s’est transformé en misère. Premières victimes de la déroute de l’économie soviétique, ils tentent aujourd’hui de revenir aux activités de leurs ancêtres et de transmettre leur savoir-faire à leurs enfants, mais peu parviennent à vivre de l’élevage, comme nous l’explique Sergueï :
“Combien de familles vivent du renne dans la région ?
— Seize.
— Comment faites-vous pour les enfants ? L’école ?
— Un hélicoptère vient les chercher à la fin de l’été. Ils sont en pension à Esso, chez des amis ou de la famille, pendant que nous nomadisons en montagne.
— Toute l’année ?
— Oh non ! Il fait bien trop froid ici l’hiver ! Jusqu’à -40 °C. Nous passons les mois les plus durs au village, puis nous repartons dans les pâturages.
— Une vie rude.
— Une vie libre.” »
Dans la queue du typhon (p. 76-79)
Neige et cendres (p. 182-184)
Extrait court
« Une tente conique est plantée, îlot de vie humaine, au milieu de l’austère paysage de montagne, près d’un ruisseau qui coule entre des arbres jaunissants. On nous a vus. Une toute petite fille court se réfugier sous la yourte. Un instant plus tard, deux hommes apparaissent, nous souhaitent la bienvenue et nous invitent à entrer sous l’abri de leur maison de toile. Elle ne doit pas différer beaucoup de celles dont Barthélemy de Lesseps disait il y a plus de deux cents ans que leur architecture paraissait “remonter aux premiers âges du monde”. L’ouverture en est orientée vers l’est, c’est-à-dire vers la vie.
Neuf personnes se serrent autour d’un feu qui brûle à même le sol, exhalant un filet de fumée claire qui s’échappe par un trou du toit : Vadim, un homme de 50 ans qui en paraît 70, Piotr Illitch et Anastasia, un couple de quadragénaires, Gricha et Andreï, deux adolescents, Iloana, 3 ans, enfin Ilya et deux Sergueï, tous trois la trentaine. Les liens qui unissent cette famille élargie sont difficiles à saisir de prime abord. S’il nous apparaît vite que Gricha et Iloana sont les enfants de Piotr et de l’unique femme du campement, nous avons du mal à comprendre quelle est la place qu’occupe Andreï, dont le visage fermé respire une profonde tristesse, et les trois jeunes célibataires dans cette microsociété d’altitude. Les visages plats, les pommettes hautes, les yeux intensément mystérieux de nos hôtes évènes sont une belle déclinaison du type ouralo-altaïque.
Au fond de la yourte, une chambrette est cachée par un rideau. On nous fait asseoir à la place d’honneur, sur des branches de cèdre et des peaux de renne. Des lanières de viande durcie pendent à sécher. Près de l’entrée, de gros quartiers saignants sont étendus sur des piquets croisés. Il n’y a ni mobilier ni ustensiles. La pauvreté, nue. Pourtant, on nous offre avec empressement un bol de renne bouilli, du thé et un pain léger et brûlant, qu’Anastasia pétrit devant nous et cuit dans un moule en fonte. Un poste de radio crachote dans un coin. On passe le Deuxième nocturne de Chopin. Et cette musique de salon, si raffinée, si foncièrement européenne, se trouve miraculeusement accordée à la yourte plantée sur une montagne sauvage d’Extrême-Orient.
Gricha et Iloana, vive fillette aux yeux brillants dont la timidité cède peu à peu à la curiosité qu’éveille notre présence, nous emmènent voir le troupeau qui paît au bord du lac. Il y a là plus de mille têtes, dont les robes brunes, blanches et baies dessinent un tableau bucolique dans le décor de pierre et d’eau. Les rennes se confondent si bien avec le paysage alentour, dont ils ont pris les couleurs, que nous ne les avions pas vus depuis la crête. Des velours sanglants traînent dans les branches de pin où les bêtes les accrochent. Le bruit lancinant du broutement de l’herbe se mêle au cliquetis des bois qui s’entrechoquent. Du côté du campement, le sol n’est plus qu’une arène piétinée, sans un brin d’herbe. Depuis une semaine que les éleveurs sont là, les rennes ont dévoré toute la végétation alentour. Bientôt, il faudra se déplacer d’une dizaine de kilomètres, vers un autre lieu de pâture. Piotr et Andreï, en treillis, sac de cuir en bandoulière, bâton en main, carabine en travers du corps, surveillent le troupeau à la jumelle. La nuit, l’enfant doit veiller près des bêtes. De petits chevaux vigoureux s’abreuvent aux lacets d’argent qui alimentent le lac. Assis en tailleur devant la yourte, Vadim taille un manche de poignard dans un morceau de ramure. Dans cette “civilisation du renne”, tout est utilisé de l’animal : viande, peau, bois, tendons. Il y a moins d’un siècle encore, les autochtones refusaient de vendre un renne vivant, quel que fût le prix qu’on leur en proposait. C’est dire l’importance symbolique que revêt l’animal.
Nous offrons les plus précieuses de nos provisions : fromage, lait concentré, chocolat. Faut-il avouer que nous eûmes une hésitation mesquine au moment de nous séparer du pot de confiture donné par les géologues, que nous n’avions même pas ouvert ? Mais que vaudrait le potlatch s’il ne concernait un bien d’échange fondamental ? Aussi apportons-nous le délice de myrtilles, que nos hôtes engloutissent sous nos yeux sans nous en proposer. C’est dans l’ordre des choses. Nous avons fait irruption dans leur vie sans y être invités, ils nous ont reçus et nous ont gratifiés du pittoresque que nous étions venus chercher. Malgré tout, cet ordre des choses nous fait peine : nous souffrons, pour la première fois depuis le début de notre voyage, de ne pas être débiteurs. Il y a ordinairement plus de plaisir à donner qu’à devoir et pourtant, voilà plusieurs semaines que nous acceptons avec joie d’être les obligés de ceux qui nous nourrissent. Là, soudain, face à ces plus pauvres que nous, le rapport s’inverse, et nous sentons durement notre richesse.
Nous demandons l’autorisation de planter notre tente près de la yourte. Tout le monde vient nous voir faire, curieux d’observer l’équipement de ces Français dont les guêtres et les sacs à dos ont déjà été appréciés en connaisseurs. Un cercle silencieux se forme autour de nous. Nerveux, nous plantons les piquets en ayant soin de ménager un passant déchiré sur le devant, sommairement recousu à la cabane d’Ouzon. Mais un garçon, croyant bien faire, s’avise de tendre la toile molle, tire sur le passant et l’arrache. Du coup, inattentifs, nous cassons net l’arceau de titane que nous étions en train d’enfiler dans le toit. Nous jurons contre notre maladresse. Autour de nous, le silence, gêné, s’épaissit, et chacun repart sans un mot sous la yourte pour nous éviter l’humiliation. Nous sommes vexés, stupides, avec notre beau matériel en ruine ; ils doivent bien rire, à côté, sous leur installation de bouleau et de toile de coton ! Après avoir recollé vaille que vaille l’arceau brisé avec du ruban adhésif, nous passons une nuit glaciale dans notre tente bancale.
C’est le jour de la coupe des bois et de la castration des rennes. Elles sont nécessaires pour empêcher les mâles en rut de se battre entre eux. Le troupeau est rassemblé sur le plateau, et se met à tourner spontanément en cercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, “à rebours du soleil”, disent les Évènes. Le spectacle est hypnotique. La forêt de bois oscille au son mat des sabots qui frappent la terre nue. Avec dextérité, les éleveurs attrapent les bêtes, par une patte ou par la ramure, d’un lancer de leur lasso de cuir. Les rennes ne sont pas des vaches : ils bondissent et se cabrent si fort qu’il faut trois hommes arc-boutés pour tenir le lasso et remonter jusqu’à la tête. Alors, l’un d’eux tient les bois et fait plier l’échine, obligeant l’animal à se coucher sur le dos. Un coup de poing sur le museau l’aide au besoin à se rendre à raison. Un homme saute sur la panse, et, en un instant, un troisième scie les andouillers tandis qu’un quatrième sectionne les bourses au couteau. Les globes translucides roulent sur la toundra. La mère de famille, cigarette au bec, court d’un groupe à l’autre, la scie à senestre, qu’elle tend à l’officiant au moment propice, et dans la dextre un sac où ballottent les testicules ramassés sur le champ de bataille. Nous craignons pour le dîner du soir? Mais ces trophées, Dieu merci, seront donnés aux chiens.
Iloana, en mal de compagnons de jeu, nous sollicite sans cesse. Quelle aubaine que ces deux étrangers complaisants qui acceptent de faire le cheval, le renne et l’ours, de se mettre à quatre pattes, de brouter, de se laisser monter, de ruer, de jouer à cache-cache, à colin-maillard, à tous ces jeux universels et simples qui ne demandent ni piles ni console et ne tombent jamais en panne ! Elle nous épuise davantage qu’une journée de marche. De temps à autre, elle appelle le chien ou attrape un énorme chat blanc, Gocha, d’une absolue placidité, qui se laisse pendre entre ses bras et accepte sans broncher d’être manœuvré dans tous les sens. Sous la tente, Anastasia essaie de contacter Esso avec un émetteur à manivelle. Dans le clair-obscur du feu mourant, tandis qu’elle mouline avec ardeur, elle ressemble à une résistante des temps héroïques, ou à quelque espionne de film noir qui chuchote des informations secrètes à son lointain commanditaire. Mais la fréquence ne passe pas ; il y a trop de nuages. Rien ne vaut finalement le bon vieux système du pinghil, ce phénomène de transmission orale que les ethnologues appellent “radio-renne”?
Qu’ont gagné les Évènes à la soviétisation de la péninsule ? Le système communiste leur a apporté l’éducation, la possibilité de faire autre chose que leurs parents et des soupes en sachet. Mais ils ont perdu leur langue, dont la transmission a été mise à mal par le système d’internat obligatoire imposé à partir de 1957 aux enfants autochtones, et ont troqué leurs beaux habits de peaux contre les hardes internationales et les vêtements militaires. Leur dénuement s’est transformé en misère. Premières victimes de la déroute de l’économie soviétique, ils tentent aujourd’hui de revenir aux activités de leurs ancêtres et de transmettre leur savoir-faire à leurs enfants, mais peu parviennent à vivre de l’élevage, comme nous l’explique Sergueï :
“Combien de familles vivent du renne dans la région ?
— Seize.
— Comment faites-vous pour les enfants ? L’école ?
— Un hélicoptère vient les chercher à la fin de l’été. Ils sont en pension à Esso, chez des amis ou de la famille, pendant que nous nomadisons en montagne.
— Toute l’année ?
— Oh non ! Il fait bien trop froid ici l’hiver ! Jusqu’à -40 °C. Nous passons les mois les plus durs au village, puis nous repartons dans les pâturages.
— Une vie rude.
— Une vie libre.” »
(p. 247-251)
Dans la queue du typhon (p. 76-79)
Neige et cendres (p. 182-184)
Extrait court


