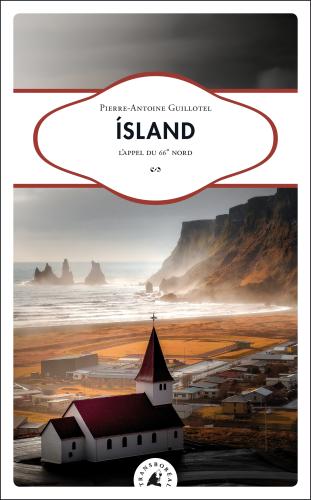
Vatnajökull : le géant de glace :
« Au sud-ouest du Vatnaj√∂kull, sur la plaine rase et nue, le mercure descend à -12 ¬įC. C’est un froid sec et p√©n√©trant. Je dresse la tente en amont de la rivi√®re G√≠gjukv√≠sl. Le sable est noir, plus dur que le perg√©lisol sib√©rien. Y planter quoi que ce soit est vain. Je dois amarrer la toile à quelques galets. La G√≠gjukv√≠sl a l’aspect d’un large torrent tress√© au lit encombr√© de pierres polies. Ses eaux grises, charg√©es de s√©diments, doivent √™tre filtr√©es si l’on veut la boire. L’argile graveleuse – je l’ai appris à mes d√©pens – ne fond gu√®re sur la langue?
La nuit fige tout. La nourriture se transforme en pierre. “Croque-moi, tu y perdras une dent”, dit-elle au r√©veil. Je ne tiens pas à arborer, comme nombre d’explorateurs, un sourire g√Ęt√© par un morceau de viande s√©ch√©e devenu trop dur. En France, le froid invite à se r√©fugier ; ici, il me pousse à veiller tard et à ouvrir grand les yeux. C’est le froid qui conduit et fait danser les aurores bor√©ales – il √©lectrise la nuit. Le ciel s’enchante de couleurs venues d’ailleurs. Drap√©s de vert, de pourpre, pleins de mouvance et d’illusions, ondulent avec gr√Ęce autour du p√īle. En terre d’Ellesmere, on pr√©tend que les loups chantent lorsqu’ils apparaissent.
Au matin du 18 novembre, je marche à l’ombre du glacier d’un pas lourd et lent. Reniflant l’air nettoy√© par le froid, je per√ßois une odeur de terre gel√©e, de cro√Ľte br√Ľl√©e et de tuf. Les premiers contreforts du Vatnaj√∂kull se dressent devant moi.
Un mur immense, une forteresse imprenable : 2 000 m√®tres verticaux. De glace bleue, de s√©racs suspendus, d’ar√™tes qui tailladent la surface comme autant d’√©perons noirs point√©s vers le sommet. Cette face √©voque pour moi le versant Diamir du Nanga Parbat. L’image est brutale : une vision à la Soutine, froide, torse. Le tableau de l’hiver, plein de rigueur et de chaos. Du chaos surgissent quantit√© de d√©tails qui fa√ßonnent l’√©motion d’√™tre là, face au spectacle de la nature.
“On a retourn√© la table g√©ographique”, song√©-je.
Dans le d√©sert du Skei√įar√°rsandur, l’horizon plat √©gare dans des distances trompeuses. Ici, tout se cabre, s’effondre, jaillit sans pr√©venir. Les glaces suivent un destin, une loi puissante et inexorable qu’aucune malice ne peut distraire. Le sublime c√ītoie le terrifiant. À midi, le soleil frappe et tout un pan s’√©croule. Deux s√©racs chutent vers 15 heures, un autre vers 16 heures. Les √©chos de leur chute emplissent le ciel. Apr√®s le fracas, les rebonds et l’explosion entre deux ar√™tes, tout redevient calme comme au premier jour. Une fum√©e blanche recouvre cette pluie d’horreurs.
Cinq heures plus tard, je remonte l’ar√™te rocheuse de Krist√≠nartindar en direction du nord-est. Le soleil s’enlise, un champ d’√©toiles s’√©l√®ve au-dessus des glaces, les centaines de crevasses en contrebas se mettent à briller. Mine de pierres pr√©cieuses. Le ciel plein de galaxies et colonis√© par un millier de diamants semble avoir d√©pos√© ses tr√©sors sur terre.
Je bivouaque en altitude, à l’abri du vent, sur une dalle rocheuse. Je reste là deux jours, à scruter le glacier, à d√©visager les nuages qui p√©r√©grinent au-dessus du d√īme, à chercher l’√©lixir de longue vie dans les plaies des crevasses. Les yeux ne suffisent plus ; ils laissent au cœur le soin d’embrasser le paysage. Je cherche en vain à d√©peindre ce que le mot Islande signifie : un lieu de paix o√Ļ effeuiller le temps et se donner au monde. Sur cette dalle, j’existe sans entrave, tel le gardien de phare qui veille sur l’oc√©an. Je m’assoupis dix fois par jour, je r√™ve dix fois. Ce promontoire devient un de ces “lieux paradisiaques” d√©crits par Christian Bobin dans La Nuit du cœur : un lieu o√Ļ le corps trouve le repos, et l’√Ęme, l’aventure.
Le repos ne dure pas. Un nouveau blizzard venu du nord m’oblige à redescendre. Je renoue avec la caillasse du pi√©mont, le sable carbonis√© puis le goudron ren√©gat. Toute l’√ģle est plac√©e en alerte, la route no 1 est coup√©e, les pierres roulent – m√©lodie devenue famili√®re. J’arrive à Hof, un ancien village de fermiers b√Ęti au pied du volcan √–r√¶faj√∂kull, le “glacier d√©sol√©”. L’√©glise au toit couvert de gazon et le cimeti√®re sem√© d’herbes folles me prot√®gent du vent. Dans le village (cinquante √Ęmes, à peine), des lumi√®res chaudes tremblent derri√®re les vitres des maisons. Chacun se pr√©pare : on sort les bougies, les chaussettes en laine et les lourdes couvertures ; autour des tables, de vieilles histoires traversent le temps. Les anciens parlent de la premi√®re √©ruption du volcan, en 1362, et de la d√©bandade qui s’est ensuivie : “Les gens ont fui comme des rats à l’√©poque.” On raconte aussi la premi√®re ascension de l’Eyjafj√∂ll en 1794 par Sveinn P√°lsson et celle du plus haut sommet d’Islande – l’impronon√ßable Hvannadalshnj√ļkur (2 110 m√®tres) – en 1891 par la cord√©e Howell, Jonsson et Thorlaksson. On attend que les plombs sautent comme la semaine pr√©c√©dente et celle d’avant, que les bourrasques folles arrachent ce qu’on a omis d’amarrer, que le pays se calme. »
Une terre de glace en feu (p. 116-118)
Su√įurland, se sauver (p. 153-155)
Extrait court
« Au sud-ouest du Vatnaj√∂kull, sur la plaine rase et nue, le mercure descend à -12 ¬įC. C’est un froid sec et p√©n√©trant. Je dresse la tente en amont de la rivi√®re G√≠gjukv√≠sl. Le sable est noir, plus dur que le perg√©lisol sib√©rien. Y planter quoi que ce soit est vain. Je dois amarrer la toile à quelques galets. La G√≠gjukv√≠sl a l’aspect d’un large torrent tress√© au lit encombr√© de pierres polies. Ses eaux grises, charg√©es de s√©diments, doivent √™tre filtr√©es si l’on veut la boire. L’argile graveleuse – je l’ai appris à mes d√©pens – ne fond gu√®re sur la langue?
La nuit fige tout. La nourriture se transforme en pierre. “Croque-moi, tu y perdras une dent”, dit-elle au r√©veil. Je ne tiens pas à arborer, comme nombre d’explorateurs, un sourire g√Ęt√© par un morceau de viande s√©ch√©e devenu trop dur. En France, le froid invite à se r√©fugier ; ici, il me pousse à veiller tard et à ouvrir grand les yeux. C’est le froid qui conduit et fait danser les aurores bor√©ales – il √©lectrise la nuit. Le ciel s’enchante de couleurs venues d’ailleurs. Drap√©s de vert, de pourpre, pleins de mouvance et d’illusions, ondulent avec gr√Ęce autour du p√īle. En terre d’Ellesmere, on pr√©tend que les loups chantent lorsqu’ils apparaissent.
Au matin du 18 novembre, je marche à l’ombre du glacier d’un pas lourd et lent. Reniflant l’air nettoy√© par le froid, je per√ßois une odeur de terre gel√©e, de cro√Ľte br√Ľl√©e et de tuf. Les premiers contreforts du Vatnaj√∂kull se dressent devant moi.
Un mur immense, une forteresse imprenable : 2 000 m√®tres verticaux. De glace bleue, de s√©racs suspendus, d’ar√™tes qui tailladent la surface comme autant d’√©perons noirs point√©s vers le sommet. Cette face √©voque pour moi le versant Diamir du Nanga Parbat. L’image est brutale : une vision à la Soutine, froide, torse. Le tableau de l’hiver, plein de rigueur et de chaos. Du chaos surgissent quantit√© de d√©tails qui fa√ßonnent l’√©motion d’√™tre là, face au spectacle de la nature.
“On a retourn√© la table g√©ographique”, song√©-je.
Dans le d√©sert du Skei√įar√°rsandur, l’horizon plat √©gare dans des distances trompeuses. Ici, tout se cabre, s’effondre, jaillit sans pr√©venir. Les glaces suivent un destin, une loi puissante et inexorable qu’aucune malice ne peut distraire. Le sublime c√ītoie le terrifiant. À midi, le soleil frappe et tout un pan s’√©croule. Deux s√©racs chutent vers 15 heures, un autre vers 16 heures. Les √©chos de leur chute emplissent le ciel. Apr√®s le fracas, les rebonds et l’explosion entre deux ar√™tes, tout redevient calme comme au premier jour. Une fum√©e blanche recouvre cette pluie d’horreurs.
Cinq heures plus tard, je remonte l’ar√™te rocheuse de Krist√≠nartindar en direction du nord-est. Le soleil s’enlise, un champ d’√©toiles s’√©l√®ve au-dessus des glaces, les centaines de crevasses en contrebas se mettent à briller. Mine de pierres pr√©cieuses. Le ciel plein de galaxies et colonis√© par un millier de diamants semble avoir d√©pos√© ses tr√©sors sur terre.
Je bivouaque en altitude, à l’abri du vent, sur une dalle rocheuse. Je reste là deux jours, à scruter le glacier, à d√©visager les nuages qui p√©r√©grinent au-dessus du d√īme, à chercher l’√©lixir de longue vie dans les plaies des crevasses. Les yeux ne suffisent plus ; ils laissent au cœur le soin d’embrasser le paysage. Je cherche en vain à d√©peindre ce que le mot Islande signifie : un lieu de paix o√Ļ effeuiller le temps et se donner au monde. Sur cette dalle, j’existe sans entrave, tel le gardien de phare qui veille sur l’oc√©an. Je m’assoupis dix fois par jour, je r√™ve dix fois. Ce promontoire devient un de ces “lieux paradisiaques” d√©crits par Christian Bobin dans La Nuit du cœur : un lieu o√Ļ le corps trouve le repos, et l’√Ęme, l’aventure.
Le repos ne dure pas. Un nouveau blizzard venu du nord m’oblige à redescendre. Je renoue avec la caillasse du pi√©mont, le sable carbonis√© puis le goudron ren√©gat. Toute l’√ģle est plac√©e en alerte, la route no 1 est coup√©e, les pierres roulent – m√©lodie devenue famili√®re. J’arrive à Hof, un ancien village de fermiers b√Ęti au pied du volcan √–r√¶faj√∂kull, le “glacier d√©sol√©”. L’√©glise au toit couvert de gazon et le cimeti√®re sem√© d’herbes folles me prot√®gent du vent. Dans le village (cinquante √Ęmes, à peine), des lumi√®res chaudes tremblent derri√®re les vitres des maisons. Chacun se pr√©pare : on sort les bougies, les chaussettes en laine et les lourdes couvertures ; autour des tables, de vieilles histoires traversent le temps. Les anciens parlent de la premi√®re √©ruption du volcan, en 1362, et de la d√©bandade qui s’est ensuivie : “Les gens ont fui comme des rats à l’√©poque.” On raconte aussi la premi√®re ascension de l’Eyjafj√∂ll en 1794 par Sveinn P√°lsson et celle du plus haut sommet d’Islande – l’impronon√ßable Hvannadalshnj√ļkur (2 110 m√®tres) – en 1891 par la cord√©e Howell, Jonsson et Thorlaksson. On attend que les plombs sautent comme la semaine pr√©c√©dente et celle d’avant, que les bourrasques folles arrachent ce qu’on a omis d’amarrer, que le pays se calme. »
(p. 207-209)
Une terre de glace en feu (p. 116-118)
Su√įurland, se sauver (p. 153-155)
Extrait court


