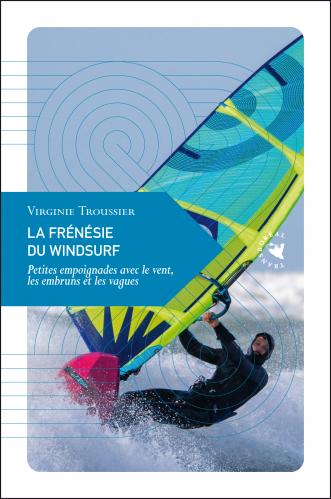
À l’origine du windsurf :
« Il va de soi que je bénirai toujours les hommes à l’origine de cet engin. Si l’on se réfère aux archives historiques, plusieurs inventeurs se sont disputé sa paternité. En 1960, Peter Chilvers, un jeune Anglais adepte du dériveur, développe un concept pour s’amuser, avec un safran manœuvrable qu’il n’utilise finalement pas, préférant le vent pour choisir son cap. Sa trouvaille tombe aux oubliettes. En 1964, l’Américain Newman Darby, qui pratique la plaisance sur un lac de Pennsylvanie, crée sa propre planche à voile en associant une voile carrée et un mât sur un gros flotteur de 3 mètres de long et 90 centimètres de large, une sorte de porte rectangulaire. Il lance la “sailboard” sur le marché. La planche est produite à plus d’exemplaires qu’elle n’est vendue. Le concept est abandonné un an après. C’est en 1968 que Jim Drake et Hoyle Schweitzer, deux Californiens, approfondissent l’idée d’un gréement mobile et fabriquent un premier pied de mât, un joint universel s’inspirant d’un cardan d’automobile, qui permet d’orienter le mât dans tous les sens pour pouvoir se diriger. Ils développent aussi le wishbone, la partie que le planchiste tient avec les mains, qui tire son nom de l’os qui a inspiré son design, la furcula, le bréchet, ou “l’os de vœux”, en forme de V, que l’on trouve sur les poulets. Une dérive rétractable est installée sous la planche pour remonter plus facilement au vent. Et afin de relever la voile tombée dans l’eau, les inventeurs ajoutent un bout appelé “tire-veille”. La Windsurfer est née, réalisation aboutie sur laquelle Jim et Hoyle tirent leurs premiers bords. Le brevet est déposé le 27 mars 1968 et accepté en 1970. Le windsurf (inspiré donc du nom de cette célèbre planche) s’exporte en Europe, au Royaume-Uni et en Allemagne uniquement, faute de moyens suffisants. En 1972, l’engin est inconnu en France ; Le Figaro de mars 1971 publie un article intitulé “Connaissez-vous le surf à voile ?”. Le journaliste évoque un bateau, un barreur, un haubanage, comme le rapportent Erwan Crouan et Olivier de Puineuf dans leur livre Gwalarn, Kite et windsurf en Bretagne. C’est un Breton, Patrick Carn, qui importera le windsurf en France, en 1973, dans son pays. C’est là que l’activité se développe le plus rapidement, grâce aux industries nautiques qui reproduisent la Windsurfer. L’arrivée de la “planche à voile” sur nos côtes réveille des consciences. On parlait d’un “engin de plage” ou d’un “voilier transportable” qui se suffisait à lui-même. Un peu de vent, des barres de toit sur la voiture, une simple cale de mise à l’eau et l’aventure devenait enfin accessible, s’affranchissant des structures existantes, des clubs ou des fédérations. Le windsurfer est libre et nomade : la pratique ne nécessite aucune infrastructure, aucun aménagement, aucune autorisation, et n’a aucun impact négatif sur l’environnement. Elle développe simplement une forte conscience du milieu, une relation à l’océan plus intuitive. Avec ces premières planches, on navigue en “déplacement”, sur des embarcations aux gros volumes qui flottent et poussent un important volume d’eau, ce qui rend la progression plutôt lente. »
En Méditerranée (p. 14-16)
Forces éoliennes (p. 60-62)
Extrait court
« Il va de soi que je bénirai toujours les hommes à l’origine de cet engin. Si l’on se réfère aux archives historiques, plusieurs inventeurs se sont disputé sa paternité. En 1960, Peter Chilvers, un jeune Anglais adepte du dériveur, développe un concept pour s’amuser, avec un safran manœuvrable qu’il n’utilise finalement pas, préférant le vent pour choisir son cap. Sa trouvaille tombe aux oubliettes. En 1964, l’Américain Newman Darby, qui pratique la plaisance sur un lac de Pennsylvanie, crée sa propre planche à voile en associant une voile carrée et un mât sur un gros flotteur de 3 mètres de long et 90 centimètres de large, une sorte de porte rectangulaire. Il lance la “sailboard” sur le marché. La planche est produite à plus d’exemplaires qu’elle n’est vendue. Le concept est abandonné un an après. C’est en 1968 que Jim Drake et Hoyle Schweitzer, deux Californiens, approfondissent l’idée d’un gréement mobile et fabriquent un premier pied de mât, un joint universel s’inspirant d’un cardan d’automobile, qui permet d’orienter le mât dans tous les sens pour pouvoir se diriger. Ils développent aussi le wishbone, la partie que le planchiste tient avec les mains, qui tire son nom de l’os qui a inspiré son design, la furcula, le bréchet, ou “l’os de vœux”, en forme de V, que l’on trouve sur les poulets. Une dérive rétractable est installée sous la planche pour remonter plus facilement au vent. Et afin de relever la voile tombée dans l’eau, les inventeurs ajoutent un bout appelé “tire-veille”. La Windsurfer est née, réalisation aboutie sur laquelle Jim et Hoyle tirent leurs premiers bords. Le brevet est déposé le 27 mars 1968 et accepté en 1970. Le windsurf (inspiré donc du nom de cette célèbre planche) s’exporte en Europe, au Royaume-Uni et en Allemagne uniquement, faute de moyens suffisants. En 1972, l’engin est inconnu en France ; Le Figaro de mars 1971 publie un article intitulé “Connaissez-vous le surf à voile ?”. Le journaliste évoque un bateau, un barreur, un haubanage, comme le rapportent Erwan Crouan et Olivier de Puineuf dans leur livre Gwalarn, Kite et windsurf en Bretagne. C’est un Breton, Patrick Carn, qui importera le windsurf en France, en 1973, dans son pays. C’est là que l’activité se développe le plus rapidement, grâce aux industries nautiques qui reproduisent la Windsurfer. L’arrivée de la “planche à voile” sur nos côtes réveille des consciences. On parlait d’un “engin de plage” ou d’un “voilier transportable” qui se suffisait à lui-même. Un peu de vent, des barres de toit sur la voiture, une simple cale de mise à l’eau et l’aventure devenait enfin accessible, s’affranchissant des structures existantes, des clubs ou des fédérations. Le windsurfer est libre et nomade : la pratique ne nécessite aucune infrastructure, aucun aménagement, aucune autorisation, et n’a aucun impact négatif sur l’environnement. Elle développe simplement une forte conscience du milieu, une relation à l’océan plus intuitive. Avec ces premières planches, on navigue en “déplacement”, sur des embarcations aux gros volumes qui flottent et poussent un important volume d’eau, ce qui rend la progression plutôt lente. »
(p. 35-37)
En Méditerranée (p. 14-16)
Forces éoliennes (p. 60-62)
Extrait court


