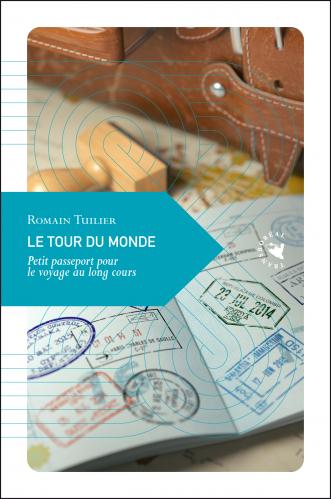
Ennui et réjouissance du voyage :
« Ce paradis m’a rappelé l’existence de l’ennemi le plus terrible du voyageur : l’ennui. Si l’on cherche honnêtement en soi-même, c’est lui qu’on trouve à l’origine du voyage. Nous n’en pouvons plus de tourner en rond dans notre monde jamais pleinement satisfaisant, alors nous partons. Enfin nous allons voir quelque chose de différent, de perpétuellement stimulant. Rien ne nous laissera en repos, et chaque jour apportera son lot de nouveautés. De merveilles en galères, le périple ne nous accordera aucun répit. Le tourdumondiste part avec la certitude qu’à aucun moment ne retombera l’excitation du départ, que partout où il ira, l’attrait de la nouveauté ne faiblira jamais. Le tour du monde devrait tout nous apporter, et pourtant il arrive qu’on s’en lasse.
Ces départs et arrivées permanents, ces guesthouses et hôtels, tous finissent par se ressembler. Nos camarades routards défilent dans une monotonie d’apparence et de discours. Une fois qu’on a vu le palais d’Été de l’empereur de Chine ou le Machu Picchu, que reste-t-il ? Il arrive parfois que le voyageur s’arrête en pleine contemplation. Il relève la tête, observe ses semblables qui s’agitent autour de lui ; il voit les murs vénérables ou le grandiose panorama qui s’étale devant lui, et se dit : “À quoi bon ? Qu’est-ce que je fais là ?”
Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, enduré mille et mille inconforts pour un instant de contemplation, pour cette chose fugitive qu’il imaginait nécessairement extraordinaire, l’intérêt disparaît inexplicablement. La frénésie du départ le reprend alors. Il doit absolument bouger, aller ailleurs, plus loin, n’importe où. Mais une fois dans le bus ou le train qui l’arrache à cet ennui, c’est à nouveau la lassitude d’un voyage qui n’en finit pas. Il faudrait être déjà arrivé.
Fugitif qui ne trouve que lui-même où qu’il aille, le voyageur est confronté momentanément au vide de son entreprise. Aucune visite ni même rencontre ne pourra combler son attente. Peut-être y a-t-il derrière ce malaise la contrepartie de l’égoïsme que suppose une telle aventure. Comment décider ce qui dans une pratique telle que le tour du monde relève de la joie authentique et ce qui n’est que recherche d’un plaisir sans finalité ?
Pourtant, le voyage réjouit deux fois. Lorsqu’on le fait, puis lorsqu’on se le remémore, tout pétri d’une expérience et d’une connaissance qui font de nous quelqu’un d’un peu plus conscient du monde. Au-delà de l’assouvissement d’un désir, le tour du monde apporte un savoir brut de ce que sont ici ou là les hommes. Il nous fait comprendre que jamais notre jugement ne pourra être définitif, et que notre contrôle sur le monde est infime. Il faut juste le laisser aller. Et si finalement il nous apprend que nous ne comprenons pas grand-chose, c’est déjà beaucoup. À la fierté d’avoir beaucoup vu se superpose l’humilité de ne pouvoir tout embrasser. »
Observer humblement (p. 54-56)
Rencontres inattendues (p. 61-63)
Extrait court
« Ce paradis m’a rappelé l’existence de l’ennemi le plus terrible du voyageur : l’ennui. Si l’on cherche honnêtement en soi-même, c’est lui qu’on trouve à l’origine du voyage. Nous n’en pouvons plus de tourner en rond dans notre monde jamais pleinement satisfaisant, alors nous partons. Enfin nous allons voir quelque chose de différent, de perpétuellement stimulant. Rien ne nous laissera en repos, et chaque jour apportera son lot de nouveautés. De merveilles en galères, le périple ne nous accordera aucun répit. Le tourdumondiste part avec la certitude qu’à aucun moment ne retombera l’excitation du départ, que partout où il ira, l’attrait de la nouveauté ne faiblira jamais. Le tour du monde devrait tout nous apporter, et pourtant il arrive qu’on s’en lasse.
Ces départs et arrivées permanents, ces guesthouses et hôtels, tous finissent par se ressembler. Nos camarades routards défilent dans une monotonie d’apparence et de discours. Une fois qu’on a vu le palais d’Été de l’empereur de Chine ou le Machu Picchu, que reste-t-il ? Il arrive parfois que le voyageur s’arrête en pleine contemplation. Il relève la tête, observe ses semblables qui s’agitent autour de lui ; il voit les murs vénérables ou le grandiose panorama qui s’étale devant lui, et se dit : “À quoi bon ? Qu’est-ce que je fais là ?”
Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, enduré mille et mille inconforts pour un instant de contemplation, pour cette chose fugitive qu’il imaginait nécessairement extraordinaire, l’intérêt disparaît inexplicablement. La frénésie du départ le reprend alors. Il doit absolument bouger, aller ailleurs, plus loin, n’importe où. Mais une fois dans le bus ou le train qui l’arrache à cet ennui, c’est à nouveau la lassitude d’un voyage qui n’en finit pas. Il faudrait être déjà arrivé.
Fugitif qui ne trouve que lui-même où qu’il aille, le voyageur est confronté momentanément au vide de son entreprise. Aucune visite ni même rencontre ne pourra combler son attente. Peut-être y a-t-il derrière ce malaise la contrepartie de l’égoïsme que suppose une telle aventure. Comment décider ce qui dans une pratique telle que le tour du monde relève de la joie authentique et ce qui n’est que recherche d’un plaisir sans finalité ?
Pourtant, le voyage réjouit deux fois. Lorsqu’on le fait, puis lorsqu’on se le remémore, tout pétri d’une expérience et d’une connaissance qui font de nous quelqu’un d’un peu plus conscient du monde. Au-delà de l’assouvissement d’un désir, le tour du monde apporte un savoir brut de ce que sont ici ou là les hommes. Il nous fait comprendre que jamais notre jugement ne pourra être définitif, et que notre contrôle sur le monde est infime. Il faut juste le laisser aller. Et si finalement il nous apprend que nous ne comprenons pas grand-chose, c’est déjà beaucoup. À la fierté d’avoir beaucoup vu se superpose l’humilité de ne pouvoir tout embrasser. »
(p. 83-86)
Observer humblement (p. 54-56)
Rencontres inattendues (p. 61-63)
Extrait court


