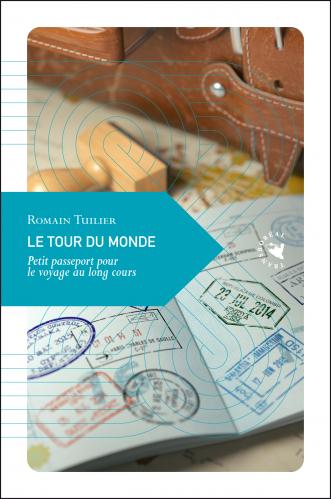
Rencontres inattendues :
« Le routard vit ce confort que procure la frugalité volontaire de celui qui n’a pas de responsabilité. Le tour du monde ne peut s’envisager que de guesthouses en hôtels rustiques. Les grands hôtels, les endroits trop propres en sont bannis. Le voyageur cherche une authenticité qui rappelle vaguement la pauvreté. Tout lui est égal pourvu que les nécessités de base ne lui soient pas un fardeau. C’est la liberté du vagabond alliée à l’émerveillement du touriste. Après un certain temps sur la route, le voyage devient une fin en soi. Il est enfin possible de lâcher prise, de comprendre que voir tel ou tel endroit n’a aucune importance, que tout ce qui compte est de se laisser emporter par le moment, sans aucune autre obligation que de reprendre le chemin quand il nous plaira.
Celui qui m’a indiqué cet “hôtel pour fumeurs”, selon ses propres mots, est un Français aux yeux fous qui vend des colifichets et des billets de train. Dans son magasin d’une dizaine de mètres carrés, il trône nonchalamment derrière un petit bureau, entouré d’antiquités de pacotille, de bijoux en toc et d’accessoires pour fumeurs de haschich. Au détour de la conversation, il me confie que l’Inde l’a sauvé. Atteint d’un cancer du foie, condamné par les médecins occidentaux, il est allé chercher le salut dans l’Himalaya auprès des yogis et des sadhus. “L’Inde m’a guéri”, constate-t-il avec l’évidence du miraculé. Il ne l’a plus quittée depuis. Il touche du bois, dit-il en caressant alors son bureau tandis que son regard se perd au loin.
Le monde est fait aussi de ces galériens, ces paumés, ces losers qu’il faut un jour rencontrer pour mesurer toute l’étendue de l’aventure humaine. Dans les interstices du monde se glissent tous ceux qui rament, qui sont trimbalés par la vie, emportés par le courant de l’existence. C’est peut-être ces rencontres imprévues et pathétiques qui m’ont le plus marqué. À mon corps défendant j’y ai trouvé, bien plus que dans n’importe quel monument, la raison de mon voyage.
Loin de Delhi, la nuit de Los Angeles est faite de longues avenues sombres sur lesquelles on croise de temps à autre quelques voitures égarées. Dans une station-service, la pendule indique 3 heures du matin. Le pauvre hère condamné à tenir boutique jusqu’au jour relève la tête lorsqu’il détecte mon accent français.
Il est marseillais, petit, râblé, avec le teint buriné et des cheveux noirs qui dépassent d’une casquette crasseuse. Il raconte sa vie par bribes avec l’accent de la Belle de Mai. Il est arrivé ici il y a longtemps, avec une fille qui lui a fait faire n’importe quoi, à tel point qu’il ne se souvenait plus d’où il venait ni de qui il était. Trop de fêtes et d’excès. Il veut absolument m’aider, m’indique un hôtel, là-bas, à Venice Beach. “Mais attention, Venice, c’est très dangereux !” Il ne faut pas que je me trompe, sinon je finirai dans South Central où “il n’y a que des Noirs, des morts tout le temps. Pire que l’Irak !” Il me souhaite bonne chance. Il a plus de 50 ans, il est fatigué. Sa vie est derrière lui, passée, brûlée. Pour lui, le rêve américain, c’est un job de nuit dans une station-service.
Dans ces rencontres inattendues, la vie des gens, pour pathétique qu’elle soit, me semble infiniment plus palpable et compréhensible que l’énigme persistante à laquelle j’ai été confronté face aux peuples de l’Asie. Je ne lisais plus cette impénétrable résignation dans les regards. J’y voyais toute la détresse, la rage, la détermination, la cruauté aussi, parfois, de mes semblables comme dans un miroir. Il m’avait fallu parcourir la moitié de la terre pour rencontrer enfin des gens dont je saisissais l’âme, peut-être parce qu’ils tentaient à tout prix de garder la tête hors de l’eau alors qu’ils étaient censés faire partie du monde riche.
Face à ces vies bancales, je me mettais à douter des normes et des standards. Que pouvait bien signifier une existence ordinaire ? En si peu de temps, j’avais côtoyé les opulents expatriés anglais de Shanghai aussi bien que les mendiants de l’Inde et les laissés pour compte de l’Amérique. Partout la masse humaine qui peuple la planète vit dans un monde dont la difficulté me frappe. Je ne me croyais pas si naïf, persuadé d’être préparé à tout, mais rien ne vaut la confrontation directe. »
Observer humblement (p. 54-56)
Ennui et réjouissance du voyage (p. 83-86)
Extrait court
« Le routard vit ce confort que procure la frugalité volontaire de celui qui n’a pas de responsabilité. Le tour du monde ne peut s’envisager que de guesthouses en hôtels rustiques. Les grands hôtels, les endroits trop propres en sont bannis. Le voyageur cherche une authenticité qui rappelle vaguement la pauvreté. Tout lui est égal pourvu que les nécessités de base ne lui soient pas un fardeau. C’est la liberté du vagabond alliée à l’émerveillement du touriste. Après un certain temps sur la route, le voyage devient une fin en soi. Il est enfin possible de lâcher prise, de comprendre que voir tel ou tel endroit n’a aucune importance, que tout ce qui compte est de se laisser emporter par le moment, sans aucune autre obligation que de reprendre le chemin quand il nous plaira.
Celui qui m’a indiqué cet “hôtel pour fumeurs”, selon ses propres mots, est un Français aux yeux fous qui vend des colifichets et des billets de train. Dans son magasin d’une dizaine de mètres carrés, il trône nonchalamment derrière un petit bureau, entouré d’antiquités de pacotille, de bijoux en toc et d’accessoires pour fumeurs de haschich. Au détour de la conversation, il me confie que l’Inde l’a sauvé. Atteint d’un cancer du foie, condamné par les médecins occidentaux, il est allé chercher le salut dans l’Himalaya auprès des yogis et des sadhus. “L’Inde m’a guéri”, constate-t-il avec l’évidence du miraculé. Il ne l’a plus quittée depuis. Il touche du bois, dit-il en caressant alors son bureau tandis que son regard se perd au loin.
Le monde est fait aussi de ces galériens, ces paumés, ces losers qu’il faut un jour rencontrer pour mesurer toute l’étendue de l’aventure humaine. Dans les interstices du monde se glissent tous ceux qui rament, qui sont trimbalés par la vie, emportés par le courant de l’existence. C’est peut-être ces rencontres imprévues et pathétiques qui m’ont le plus marqué. À mon corps défendant j’y ai trouvé, bien plus que dans n’importe quel monument, la raison de mon voyage.
Loin de Delhi, la nuit de Los Angeles est faite de longues avenues sombres sur lesquelles on croise de temps à autre quelques voitures égarées. Dans une station-service, la pendule indique 3 heures du matin. Le pauvre hère condamné à tenir boutique jusqu’au jour relève la tête lorsqu’il détecte mon accent français.
Il est marseillais, petit, râblé, avec le teint buriné et des cheveux noirs qui dépassent d’une casquette crasseuse. Il raconte sa vie par bribes avec l’accent de la Belle de Mai. Il est arrivé ici il y a longtemps, avec une fille qui lui a fait faire n’importe quoi, à tel point qu’il ne se souvenait plus d’où il venait ni de qui il était. Trop de fêtes et d’excès. Il veut absolument m’aider, m’indique un hôtel, là-bas, à Venice Beach. “Mais attention, Venice, c’est très dangereux !” Il ne faut pas que je me trompe, sinon je finirai dans South Central où “il n’y a que des Noirs, des morts tout le temps. Pire que l’Irak !” Il me souhaite bonne chance. Il a plus de 50 ans, il est fatigué. Sa vie est derrière lui, passée, brûlée. Pour lui, le rêve américain, c’est un job de nuit dans une station-service.
Dans ces rencontres inattendues, la vie des gens, pour pathétique qu’elle soit, me semble infiniment plus palpable et compréhensible que l’énigme persistante à laquelle j’ai été confronté face aux peuples de l’Asie. Je ne lisais plus cette impénétrable résignation dans les regards. J’y voyais toute la détresse, la rage, la détermination, la cruauté aussi, parfois, de mes semblables comme dans un miroir. Il m’avait fallu parcourir la moitié de la terre pour rencontrer enfin des gens dont je saisissais l’âme, peut-être parce qu’ils tentaient à tout prix de garder la tête hors de l’eau alors qu’ils étaient censés faire partie du monde riche.
Face à ces vies bancales, je me mettais à douter des normes et des standards. Que pouvait bien signifier une existence ordinaire ? En si peu de temps, j’avais côtoyé les opulents expatriés anglais de Shanghai aussi bien que les mendiants de l’Inde et les laissés pour compte de l’Amérique. Partout la masse humaine qui peuple la planète vit dans un monde dont la difficulté me frappe. Je ne me croyais pas si naïf, persuadé d’être préparé à tout, mais rien ne vaut la confrontation directe. »
(p. 61-63)
Observer humblement (p. 54-56)
Ennui et réjouissance du voyage (p. 83-86)
Extrait court


