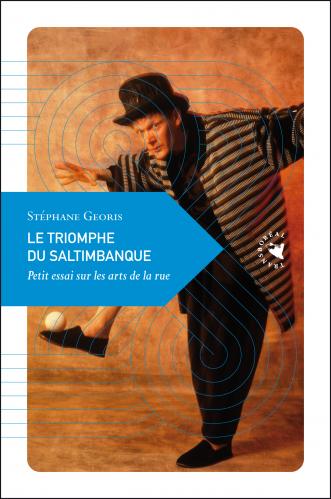
Gagner le public, encore et toujours :
« Au XIXe siècle, tout avait déjà été inventé de l’art du saltimbanque. Je suis, ainsi que mes confrères, détenteur d’une tradition qu’il me faut réinventer tous les jours, enfant d’une lignée formidable d’hommes-troncs, d’avaleurs de sabres et de voyageurs de bords de trottoir. Le présent n’est pas entièrement nouveau. Dommage ? Non, merveilleux. C’est peut-être là le propre de ce métier : reprendre le costume à paillettes d’un incertain grand-père, le recoudre de neuf, le transformer, l’adapter et le porter fièrement avec respect sur une rue large. La rue est un spectacle, la route le voyage, l’avenue un luxe et l’autoroute un leurre. Restons donc à la rue, et puis prenons la route.
Si on a l’habitude d’appeler, sur une scène, le rideau ouvert au public le “quatrième mur”, notre théâtre à nous n’en possède pas. Ni de troisième, ni de deuxième ou de premier. Sans doute quatre fenêtres, dix fenêtres, deux cents fenêtres, dix millions de fenêtres. Rien que des fenêtres. Grandes ouvertes. Et pas de toit, pas d’abri pour se protéger. Pas de placard pour se cacher, pas de fauteuils pour s’endormir, pas de grands lits pour jouer, pas de maison pour s’arrêter. Toujours tourner, toujours voyager. Pas de portes pour s’enfermer : c’est le théâtre du pas-de-porte !
Dans une salle, sitôt acquis, le public a le temps de réfléchir. Dans la rue, il est forcé de vivre. Il est bien entendu qu’au départ, il faut conquérir son public. Celui de la rue s’en va quand il veut, tandis que celui de la salle est coincé dans le théâtre. Dans la rue, parmi les bruits, l’agitation qui dévore tout, à commencer par l’attention des spectateurs, l’espace énorme, le ciel devant, derrière, au-dessus, le sol qui n’en finit pas de s’échapper à chaque carrefour, le spectateur absorbé par un spectacle doit l’être par les yeux, le rire, la gorge, le ventre, les sourcils qui s’étonnent, les oreilles qui sélectionnent ce qu’il faut entendre ou écouter : le voilà forcé de vivre ce qui se passe devant lui, ce que l’acteur taille à la hache en découpant le monde devant ses yeux pour le garder devant cette fournaise d’énergie qu’il faudra nourrir à chaque instant, quitte à répéter, refaire, redire dix fois la même chose avec un mot, un geste, une autre phrase, un autre moyen. Le spectateur non-acquis au départ doit volontairement tomber dans le piège et y laisser mourir sa vie d’avant, qui pourtant l’entoure de toutes parts, pour vivre cette autre vie un moment.
Tandis que, dans la salle où le même spectateur décide de se rendre (la différence est déjà là), de payer son entrée et de prendre place dans l’obscurité, le voici acteur de ce choix. Il ne s’agit en rien de changer le fil de sa vie, mais de l’en distraire. Il va falloir maintenant que le comédien satisfasse cet appétit, cette exigence, cette attente. Et si je répète deux fois la même idée en jouant mon spectacle sous le feu des projecteurs, chaque observateur l’aura vu, entendu ou remarqué. Chaque geste de trop va gêner, puisque son attention n’est prise que par ce qui bouge au milieu du noir. Il n’a réellement qu’une seule chose à faire : observer. De loin. Depuis un abri obscur où le comédien ne peut pas le voir. Un observatoire en gradins avec fauteuils et accoudoirs. Ici, le spectateur est hors du jeu et peut prendre tout le recul qu’il veut pour regarder, analyser, réfléchir sur chaque geste posé devant lui. Il n’est pas devant une télévision, puisqu’il faut le silence et le respect dû à quelqu’un dans la même boîte, la même cage, la même pièce que lui, mais il n’en est pas loin.
En somme, le spectateur de la rue, qui se noie dans le monde, attrape l’artiste, ou se laisse attraper comme une bouée de sauvetage, alors que dans un théâtre, le spectateur vient simplement s’asseoir au bord de la mer, et regarde l’artiste se noyer tout seul? »
Théâtre poétique, théâtre politique (p. 32-35)
Échanges sur un trottoir (p. 82-85)
Extrait court
« Au XIXe siècle, tout avait déjà été inventé de l’art du saltimbanque. Je suis, ainsi que mes confrères, détenteur d’une tradition qu’il me faut réinventer tous les jours, enfant d’une lignée formidable d’hommes-troncs, d’avaleurs de sabres et de voyageurs de bords de trottoir. Le présent n’est pas entièrement nouveau. Dommage ? Non, merveilleux. C’est peut-être là le propre de ce métier : reprendre le costume à paillettes d’un incertain grand-père, le recoudre de neuf, le transformer, l’adapter et le porter fièrement avec respect sur une rue large. La rue est un spectacle, la route le voyage, l’avenue un luxe et l’autoroute un leurre. Restons donc à la rue, et puis prenons la route.
Si on a l’habitude d’appeler, sur une scène, le rideau ouvert au public le “quatrième mur”, notre théâtre à nous n’en possède pas. Ni de troisième, ni de deuxième ou de premier. Sans doute quatre fenêtres, dix fenêtres, deux cents fenêtres, dix millions de fenêtres. Rien que des fenêtres. Grandes ouvertes. Et pas de toit, pas d’abri pour se protéger. Pas de placard pour se cacher, pas de fauteuils pour s’endormir, pas de grands lits pour jouer, pas de maison pour s’arrêter. Toujours tourner, toujours voyager. Pas de portes pour s’enfermer : c’est le théâtre du pas-de-porte !
Dans une salle, sitôt acquis, le public a le temps de réfléchir. Dans la rue, il est forcé de vivre. Il est bien entendu qu’au départ, il faut conquérir son public. Celui de la rue s’en va quand il veut, tandis que celui de la salle est coincé dans le théâtre. Dans la rue, parmi les bruits, l’agitation qui dévore tout, à commencer par l’attention des spectateurs, l’espace énorme, le ciel devant, derrière, au-dessus, le sol qui n’en finit pas de s’échapper à chaque carrefour, le spectateur absorbé par un spectacle doit l’être par les yeux, le rire, la gorge, le ventre, les sourcils qui s’étonnent, les oreilles qui sélectionnent ce qu’il faut entendre ou écouter : le voilà forcé de vivre ce qui se passe devant lui, ce que l’acteur taille à la hache en découpant le monde devant ses yeux pour le garder devant cette fournaise d’énergie qu’il faudra nourrir à chaque instant, quitte à répéter, refaire, redire dix fois la même chose avec un mot, un geste, une autre phrase, un autre moyen. Le spectateur non-acquis au départ doit volontairement tomber dans le piège et y laisser mourir sa vie d’avant, qui pourtant l’entoure de toutes parts, pour vivre cette autre vie un moment.
Tandis que, dans la salle où le même spectateur décide de se rendre (la différence est déjà là), de payer son entrée et de prendre place dans l’obscurité, le voici acteur de ce choix. Il ne s’agit en rien de changer le fil de sa vie, mais de l’en distraire. Il va falloir maintenant que le comédien satisfasse cet appétit, cette exigence, cette attente. Et si je répète deux fois la même idée en jouant mon spectacle sous le feu des projecteurs, chaque observateur l’aura vu, entendu ou remarqué. Chaque geste de trop va gêner, puisque son attention n’est prise que par ce qui bouge au milieu du noir. Il n’a réellement qu’une seule chose à faire : observer. De loin. Depuis un abri obscur où le comédien ne peut pas le voir. Un observatoire en gradins avec fauteuils et accoudoirs. Ici, le spectateur est hors du jeu et peut prendre tout le recul qu’il veut pour regarder, analyser, réfléchir sur chaque geste posé devant lui. Il n’est pas devant une télévision, puisqu’il faut le silence et le respect dû à quelqu’un dans la même boîte, la même cage, la même pièce que lui, mais il n’en est pas loin.
En somme, le spectateur de la rue, qui se noie dans le monde, attrape l’artiste, ou se laisse attraper comme une bouée de sauvetage, alors que dans un théâtre, le spectateur vient simplement s’asseoir au bord de la mer, et regarde l’artiste se noyer tout seul? »
(p. 15-18)
Théâtre poétique, théâtre politique (p. 32-35)
Échanges sur un trottoir (p. 82-85)
Extrait court


