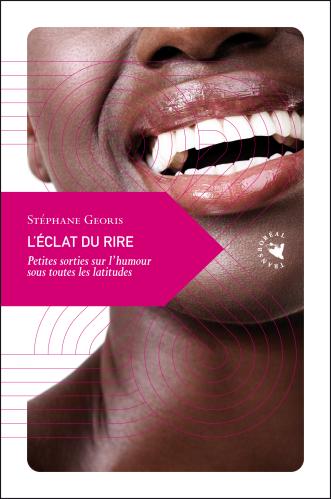
Cent blagues :
« Me revient en tête un épisode important qui se lie avec ce fameux rire de joie. J’avais participé au montage d’un spectacle comique avec trois personnages sans texte. Nous n’étions pas silencieux, non, mais parlions le borborygme, le volapük, le charabia, chacun une fausse langue que le spectateur était invité à comprendre par nos gestes et nos attitudes. Mon rôle était celui d’un Slave bougon migrant vers New York qu’il imaginait pavé d’or pour rencontrer Penélope Cruz afin de lui offrir une magnifique plante verte en plastique. Bien. La scène importante pour ce discours me poussait, suite à un malaise entre tous, à raconter une blague. Le défi est fort. En français, nous avons choisi de raconter l’histoire du fou qui repeint son plafond. Vous la connaissez. Un autre fou arrive et lui dit : “Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle !” Mais il fallait la raconter sans un mot ! Gestes, bruits, mime, grimper l’échelle, tordre un doigt sur la tempe pour parler de folie, appeler vers le plafond et rester suspendu, bête, puis surtout faire éclater un rire tonitruant, sincère et communicatif. Le public comprend et rit. Mais une question s’est posée pour nos tournées internationales : faut-il traduire la blague ? La première réponse fut non, puisque tout se passe en mime. C’est du geste et du bla-bla, ils riront. La suite prouva que non.
Il a fallu traduire un geste ? Une grimace ? Traduire un fou, son échelle et son pinceau alors qu’on ne dit pas un mot ? Autrement dit, traduire un silence ? Oui, car il s’agit de références. Les francophones qui ont ri savaient quand ils devaient rire en comprenant notre humour, mais surtout en se souvenant de la blague. Et les autres alors ? À chaque étape de nos tournées, nous avons demandé : racontez-nous une blague, et je vais tenter de la mimer. En Allemagne ? Fritzchen ramasse une pièce à terre. Sa mère le gronde : on ne ramasse pas ce qui traîne au sol, c’est sale. Puis elle tombe et demande de l’aide. Quand elle tend la main, Fritzchen répond : “On ne ramasse pas ce qui traîne à terre, c’est sale.” Ils rient. Au Bénin ? Si on te demande “Aimes-tu la Béninoise ?”, réponds “Celle qui porte une capsule ?” Une bière porte le même nom. Ils rient. En Équateur ? Une mère promet à son fils un sandwich au poulet chaque jour de la semaine. Et le dimanche, elle lui sert des pommes de terre. Sandwiche de pollo ! Sandwiche de pollo ! Ils gloussent.
Le plus étrange, c’est en Estonie. “Juku, ayant mal à la gorge, va à la pharmacie. Mais la pharmacie est fermée. Alors Juku rentre chez lui.” Ils s’esclaffent. Mais nous l’avons vite compris : c’est notre personnage et son rire sincère, tonitruant et communicatif qui mettaient le feu aux bouches. Rien d’autre que cette joie-là, que nous avons connue bébé, et qu’un jour nous retrouvons dans une assemblée ou un mariage. Si l’un des invités lance un rire généreux et communicatif, ou si ce rire est une guirlande drôle de hihi et de haha, comme une vache asthmatique qui respire ou comme la cloche éraillée d’une messe de communion, tout le reste de la salle se mettra à rire. C’est ce partage-là que nous tentions de faire vivre plutôt que la blague qui restera toujours au fond un peu idiote.
Fritzchen, Juku, Nasr Eddin Hodja sont comme notre Toto, ambassadeurs de l’empire Rigolo. Je veux emmener Pince-mi et Pince-moi sur leur bateau pour vous faire voyager un peu : en Italie, le héros des blagues se nomme Pierrino. C’est un adolescent ignare. Aux Pays-Bas, il s’appelle Jantje, petit Jean. Vototchka en Russie, Temel en Turquie ou encore Johnny et Sheila, couple victime de toutes les moqueries en Australie. Notre Toto a été inventé par Émile Durafour en 1892 pour un premier livre : Les Farces de Toto, Folie-vaudeville en un acte. Feydeau s’en est emparé pour sa pièce On purge bébé où il se révèle difficile de purger un enfant qui pose des questions dont on ne se sort qu’en se prenant les pieds dans le tapis. Juku, lui, est typiquement estonien, il ne quitte pas ses frontières, alors que le vieux sage Nasr Eddin Hodja voyage partout avec Khadidja, une femme formidable. Au Maghreb, il s’appelle Joha ou Djeha, en Afghanistan ou en Iran, ce sera Mollah Nasr Eddin et en Asie centrale Appendi. Et s’il vient de Turquie, puisque sa naissance a été certifiée à Hortu, sa célébrité a tout de même donné lieu à de nombreuses statues et portraits, au titre d’un magazine (Molla Nasreddin en Azerbaïdjan) ou à une année célébrée par l’Unesco : 1996 fut décrétée année Nasr Eddin Hodja ! »
La poésie du mode (p. 22-25)
Changer le monde (p. 82-86)
Extrait court
« Me revient en tête un épisode important qui se lie avec ce fameux rire de joie. J’avais participé au montage d’un spectacle comique avec trois personnages sans texte. Nous n’étions pas silencieux, non, mais parlions le borborygme, le volapük, le charabia, chacun une fausse langue que le spectateur était invité à comprendre par nos gestes et nos attitudes. Mon rôle était celui d’un Slave bougon migrant vers New York qu’il imaginait pavé d’or pour rencontrer Penélope Cruz afin de lui offrir une magnifique plante verte en plastique. Bien. La scène importante pour ce discours me poussait, suite à un malaise entre tous, à raconter une blague. Le défi est fort. En français, nous avons choisi de raconter l’histoire du fou qui repeint son plafond. Vous la connaissez. Un autre fou arrive et lui dit : “Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle !” Mais il fallait la raconter sans un mot ! Gestes, bruits, mime, grimper l’échelle, tordre un doigt sur la tempe pour parler de folie, appeler vers le plafond et rester suspendu, bête, puis surtout faire éclater un rire tonitruant, sincère et communicatif. Le public comprend et rit. Mais une question s’est posée pour nos tournées internationales : faut-il traduire la blague ? La première réponse fut non, puisque tout se passe en mime. C’est du geste et du bla-bla, ils riront. La suite prouva que non.
Il a fallu traduire un geste ? Une grimace ? Traduire un fou, son échelle et son pinceau alors qu’on ne dit pas un mot ? Autrement dit, traduire un silence ? Oui, car il s’agit de références. Les francophones qui ont ri savaient quand ils devaient rire en comprenant notre humour, mais surtout en se souvenant de la blague. Et les autres alors ? À chaque étape de nos tournées, nous avons demandé : racontez-nous une blague, et je vais tenter de la mimer. En Allemagne ? Fritzchen ramasse une pièce à terre. Sa mère le gronde : on ne ramasse pas ce qui traîne au sol, c’est sale. Puis elle tombe et demande de l’aide. Quand elle tend la main, Fritzchen répond : “On ne ramasse pas ce qui traîne à terre, c’est sale.” Ils rient. Au Bénin ? Si on te demande “Aimes-tu la Béninoise ?”, réponds “Celle qui porte une capsule ?” Une bière porte le même nom. Ils rient. En Équateur ? Une mère promet à son fils un sandwich au poulet chaque jour de la semaine. Et le dimanche, elle lui sert des pommes de terre. Sandwiche de pollo ! Sandwiche de pollo ! Ils gloussent.
Le plus étrange, c’est en Estonie. “Juku, ayant mal à la gorge, va à la pharmacie. Mais la pharmacie est fermée. Alors Juku rentre chez lui.” Ils s’esclaffent. Mais nous l’avons vite compris : c’est notre personnage et son rire sincère, tonitruant et communicatif qui mettaient le feu aux bouches. Rien d’autre que cette joie-là, que nous avons connue bébé, et qu’un jour nous retrouvons dans une assemblée ou un mariage. Si l’un des invités lance un rire généreux et communicatif, ou si ce rire est une guirlande drôle de hihi et de haha, comme une vache asthmatique qui respire ou comme la cloche éraillée d’une messe de communion, tout le reste de la salle se mettra à rire. C’est ce partage-là que nous tentions de faire vivre plutôt que la blague qui restera toujours au fond un peu idiote.
Fritzchen, Juku, Nasr Eddin Hodja sont comme notre Toto, ambassadeurs de l’empire Rigolo. Je veux emmener Pince-mi et Pince-moi sur leur bateau pour vous faire voyager un peu : en Italie, le héros des blagues se nomme Pierrino. C’est un adolescent ignare. Aux Pays-Bas, il s’appelle Jantje, petit Jean. Vototchka en Russie, Temel en Turquie ou encore Johnny et Sheila, couple victime de toutes les moqueries en Australie. Notre Toto a été inventé par Émile Durafour en 1892 pour un premier livre : Les Farces de Toto, Folie-vaudeville en un acte. Feydeau s’en est emparé pour sa pièce On purge bébé où il se révèle difficile de purger un enfant qui pose des questions dont on ne se sort qu’en se prenant les pieds dans le tapis. Juku, lui, est typiquement estonien, il ne quitte pas ses frontières, alors que le vieux sage Nasr Eddin Hodja voyage partout avec Khadidja, une femme formidable. Au Maghreb, il s’appelle Joha ou Djeha, en Afghanistan ou en Iran, ce sera Mollah Nasr Eddin et en Asie centrale Appendi. Et s’il vient de Turquie, puisque sa naissance a été certifiée à Hortu, sa célébrité a tout de même donné lieu à de nombreuses statues et portraits, au titre d’un magazine (Molla Nasreddin en Azerbaïdjan) ou à une année célébrée par l’Unesco : 1996 fut décrétée année Nasr Eddin Hodja ! »
(p. 61-65)
La poésie du mode (p. 22-25)
Changer le monde (p. 82-86)
Extrait court


