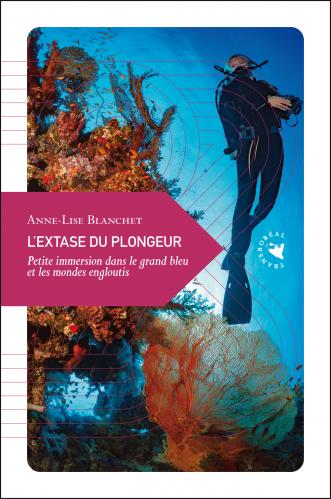
Évoluer sous l’eau :
« Revenons un instant aux premiers scaphandres autonomes ou à casque. Le plongeur lesté à la taille ou aux pieds marchait sur le fond, comme l’illustrent bien les “pieds lourds” de Tintin. Ses déplacements étaient donc limités. Il fallut attendre 1914 pour pouvoir prendre son envol sous-marin grâce à l’invention de Louis de Corlieu : les palmes. Elles ouvrent les trois dimensions de l’espace au plongeur, qui peut désormais avancer et se diriger en pleine eau avec le corps à l’horizontale. Ne ressemble-t-il pas alors à un batracien ? Sans doute ne faut-il pas chercher plus loin l’origine du surnom d’homme-grenouille ! Ces équipements qui paraissent anodins parce que familiers du vacancier à la plage sont pourtant indispensables ; pas de palmes, pas de plongée !
Techniquement, il est possible de plonger sans masque, c’était d’ailleurs le cas de certains pionniers qui ne partaient qu’avec un pince-nez. Mais cela présente peu d’intérêt : sans masque, on ne voit sous l’eau que des formes floues, soit quasiment rien? Le masque facial inventé en 1933 par Yves Le Prieur améliore les lunettes subaquatiques créées en 1920, car il intègre le nez, ce qui est plus confortable et pratique.
Pour rester en sécurité, il est nécessaire d’avoir accès à tout moment à des paramètres tels que la profondeur et le temps de plongée, qui déterminent les paliers. Levons tout de suite le mystère de ces fameux paliers qui mobilisent tant les plongeurs en revenant à des notions de physique. L’air est composé de 21 % d’oxygène et 79 % d’azote. À chaque inspiration, l’air va dans les alvéoles des poumons où s’effectuent des échanges gazeux au niveau sanguin, auxquels l’azote participe. Que se passe-t-il en profondeur ? L’air inspiré est à pression ambiante donc comprimé. L’azote tout autant comprimé se dissout dans les tissus et circule dans le corps par le sang. Lorsque le plongeur remonte, la pression diminue et l’azote se dilate en microbulles. Si l’ascension est lente, elles seront évacuées par l’expiration, et la saturation est à l’équilibre. Si elle est rapide, les bulles grossissent trop vite et demeurent dans le corps, où elles continuent à se déplacer. Au risque de se bloquer quelque part. Si une bulle se coince au niveau d’une articulation, on en est quitte pour une douleur, mais dans un poumon, c’est l’embolie, dans la colonne vertébrale, la paralysie, dans le cœur ou le cerveau, potentiellement la mort.
La plongée est une activité à risques, qu’il faut connaître pour les éviter. L’équipement, les gestes, les procédures circonscrivent ces risques. La sécurité, de son binôme et de soi-même, reste la priorité, sans que cela ne gâche le plaisir ! Avoir conscience des problèmes potentiels, maîtriser les réponses à apporter pour les contourner, c’est se sentir en confiance et cela permet de profiter pleinement de l’émerveillement constant que procure la découverte du monde sous-marin. »
Éveil des sens (p. 15-19)
Luxuriance sous-marine (p. 51-53)
Extrait court
« Revenons un instant aux premiers scaphandres autonomes ou à casque. Le plongeur lesté à la taille ou aux pieds marchait sur le fond, comme l’illustrent bien les “pieds lourds” de Tintin. Ses déplacements étaient donc limités. Il fallut attendre 1914 pour pouvoir prendre son envol sous-marin grâce à l’invention de Louis de Corlieu : les palmes. Elles ouvrent les trois dimensions de l’espace au plongeur, qui peut désormais avancer et se diriger en pleine eau avec le corps à l’horizontale. Ne ressemble-t-il pas alors à un batracien ? Sans doute ne faut-il pas chercher plus loin l’origine du surnom d’homme-grenouille ! Ces équipements qui paraissent anodins parce que familiers du vacancier à la plage sont pourtant indispensables ; pas de palmes, pas de plongée !
Techniquement, il est possible de plonger sans masque, c’était d’ailleurs le cas de certains pionniers qui ne partaient qu’avec un pince-nez. Mais cela présente peu d’intérêt : sans masque, on ne voit sous l’eau que des formes floues, soit quasiment rien? Le masque facial inventé en 1933 par Yves Le Prieur améliore les lunettes subaquatiques créées en 1920, car il intègre le nez, ce qui est plus confortable et pratique.
Pour rester en sécurité, il est nécessaire d’avoir accès à tout moment à des paramètres tels que la profondeur et le temps de plongée, qui déterminent les paliers. Levons tout de suite le mystère de ces fameux paliers qui mobilisent tant les plongeurs en revenant à des notions de physique. L’air est composé de 21 % d’oxygène et 79 % d’azote. À chaque inspiration, l’air va dans les alvéoles des poumons où s’effectuent des échanges gazeux au niveau sanguin, auxquels l’azote participe. Que se passe-t-il en profondeur ? L’air inspiré est à pression ambiante donc comprimé. L’azote tout autant comprimé se dissout dans les tissus et circule dans le corps par le sang. Lorsque le plongeur remonte, la pression diminue et l’azote se dilate en microbulles. Si l’ascension est lente, elles seront évacuées par l’expiration, et la saturation est à l’équilibre. Si elle est rapide, les bulles grossissent trop vite et demeurent dans le corps, où elles continuent à se déplacer. Au risque de se bloquer quelque part. Si une bulle se coince au niveau d’une articulation, on en est quitte pour une douleur, mais dans un poumon, c’est l’embolie, dans la colonne vertébrale, la paralysie, dans le cœur ou le cerveau, potentiellement la mort.
La plongée est une activité à risques, qu’il faut connaître pour les éviter. L’équipement, les gestes, les procédures circonscrivent ces risques. La sécurité, de son binôme et de soi-même, reste la priorité, sans que cela ne gâche le plaisir ! Avoir conscience des problèmes potentiels, maîtriser les réponses à apporter pour les contourner, c’est se sentir en confiance et cela permet de profiter pleinement de l’émerveillement constant que procure la découverte du monde sous-marin. »
(p. 26-28)
Éveil des sens (p. 15-19)
Luxuriance sous-marine (p. 51-53)
Extrait court


