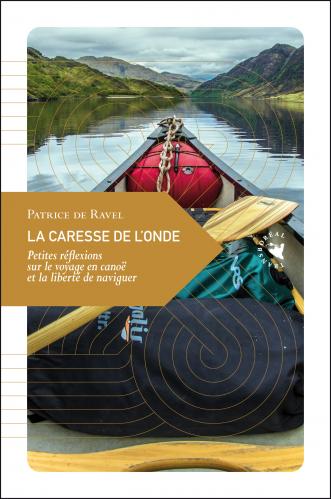
Déboucher en mer :
« En fin de parcours, déboucher en mer, la pagaie à la main, est une expérience forte. D’abord sentir que l’on a atteint le but, puis prendre en pleine figure le changement d’univers. La transition est brutale au sortir des petits fleuves côtiers normands, landais ou picards qui conservent presque jusqu’au dernier moment leur ambiance terrienne ; les grands estuaires ménagent leurs effets beaucoup plus longtemps. Cependant ils partagent tous l’unité de progression qui n’est plus en kilomètres mais en heures, dont ce n’est même pas la quantité en valeur absolue qui importe : seule l’heure relative à la marée est à prendre en compte. Accroché à une pierre ou à une touffe de roseaux (en changeant de prise au fur et à mesure de la montée des eaux), je me remémore l’heure de pleine mer de référence de la région et je révise la règle des douzièmes apprise des marins tout en contemplant, sidéré, le flot envahir à rebrousse-poil le lit de la rivière. Il faut attendre bien au-delà de la mi-marée pour que le flux diminue d’intensité et que l’on puisse reprendre la route, rien ne sert de lutter. Cette montée des eaux est une crue officielle, programmée, dont les habitants du lit, bien mieux que les hommes qui l’ont déserté, se garantissent par des migrations biquotidiennes : amont-aval, enfouissement-vie de surface, vase ou pré. Sa rencontre, en venant par l’amont, est subtile. Bien avant que le paysage ne se transforme, le sel ne faisant pas encore ses ravages sur la végétation, le courant commence à avoir des humeurs changeantes. Lui qui poussait régulièrement par l’arrière devient neutre comme lorsque l’on arrive en amont d’un barrage, puis s’inverse. La pagaie ne croche plus l’eau comme précédemment, une mollesse vient troubler la propulsion. À cet instant d’équilibre entre les deux courants, la marée est à son plus haut. Tout ce qui se passe ensuite est une descente vers le fond, désormais l’eau ne coule plus seulement, elle se retire.
Le long du parcours, jusqu’à l’étale de basse mer, une bordure vaseuse se découvre tant et si bien qu’elle devient l’essentiel du paysage. Autour de moi, des pentes grises et flasques, peuplées d’animalcules que viennent chercher les oiseaux, ont pris la place des herbes qui restent réfugiées sur la crête. Les embases des pontons et les chaînes des corps-morts apparaissent. À s’offrir ainsi à la mer, la rivière en devient presque impudique. Puis elle se reprend et retrouve son eau, m’obligeant assez vite à m’arrêter pour patienter comme si elle voulait se présenter sous un meilleur jour. Un calcul avait débuté là-haut à l’étale des courants : combien de temps avant que le courant, devenu contraire, ne soit trop fort ? Et combien de périodes seront nécessaires pour atteindre, non pas la limite maritime (l’administrative est dépassée), mais la plage où l’arrêt est prévu ? Et puis, quand même, cette question lancinante : quel temps fera-t-il plus tard, plus en aval, là où l’horizon est grand ouvert ? Parce que le canoë est presque indésirable dans l’univers maritime. Il n’a pas le profil. Courir avec le reflux, se laisser griser par la vitesse qui entraîne vers la mer et ne pas voir ou savoir, ou bien oublier, que le vent qui souffle contre le courant lève un clapot court et raide, peut mener à sa perte. »
Souvenir d’enfance (p. 32-34)
Le rapport à la ville (p. 72-76)
Extrait court
« En fin de parcours, déboucher en mer, la pagaie à la main, est une expérience forte. D’abord sentir que l’on a atteint le but, puis prendre en pleine figure le changement d’univers. La transition est brutale au sortir des petits fleuves côtiers normands, landais ou picards qui conservent presque jusqu’au dernier moment leur ambiance terrienne ; les grands estuaires ménagent leurs effets beaucoup plus longtemps. Cependant ils partagent tous l’unité de progression qui n’est plus en kilomètres mais en heures, dont ce n’est même pas la quantité en valeur absolue qui importe : seule l’heure relative à la marée est à prendre en compte. Accroché à une pierre ou à une touffe de roseaux (en changeant de prise au fur et à mesure de la montée des eaux), je me remémore l’heure de pleine mer de référence de la région et je révise la règle des douzièmes apprise des marins tout en contemplant, sidéré, le flot envahir à rebrousse-poil le lit de la rivière. Il faut attendre bien au-delà de la mi-marée pour que le flux diminue d’intensité et que l’on puisse reprendre la route, rien ne sert de lutter. Cette montée des eaux est une crue officielle, programmée, dont les habitants du lit, bien mieux que les hommes qui l’ont déserté, se garantissent par des migrations biquotidiennes : amont-aval, enfouissement-vie de surface, vase ou pré. Sa rencontre, en venant par l’amont, est subtile. Bien avant que le paysage ne se transforme, le sel ne faisant pas encore ses ravages sur la végétation, le courant commence à avoir des humeurs changeantes. Lui qui poussait régulièrement par l’arrière devient neutre comme lorsque l’on arrive en amont d’un barrage, puis s’inverse. La pagaie ne croche plus l’eau comme précédemment, une mollesse vient troubler la propulsion. À cet instant d’équilibre entre les deux courants, la marée est à son plus haut. Tout ce qui se passe ensuite est une descente vers le fond, désormais l’eau ne coule plus seulement, elle se retire.
Le long du parcours, jusqu’à l’étale de basse mer, une bordure vaseuse se découvre tant et si bien qu’elle devient l’essentiel du paysage. Autour de moi, des pentes grises et flasques, peuplées d’animalcules que viennent chercher les oiseaux, ont pris la place des herbes qui restent réfugiées sur la crête. Les embases des pontons et les chaînes des corps-morts apparaissent. À s’offrir ainsi à la mer, la rivière en devient presque impudique. Puis elle se reprend et retrouve son eau, m’obligeant assez vite à m’arrêter pour patienter comme si elle voulait se présenter sous un meilleur jour. Un calcul avait débuté là-haut à l’étale des courants : combien de temps avant que le courant, devenu contraire, ne soit trop fort ? Et combien de périodes seront nécessaires pour atteindre, non pas la limite maritime (l’administrative est dépassée), mais la plage où l’arrêt est prévu ? Et puis, quand même, cette question lancinante : quel temps fera-t-il plus tard, plus en aval, là où l’horizon est grand ouvert ? Parce que le canoë est presque indésirable dans l’univers maritime. Il n’a pas le profil. Courir avec le reflux, se laisser griser par la vitesse qui entraîne vers la mer et ne pas voir ou savoir, ou bien oublier, que le vent qui souffle contre le courant lève un clapot court et raide, peut mener à sa perte. »
(p. 44-47)
Souvenir d’enfance (p. 32-34)
Le rapport à la ville (p. 72-76)
Extrait court


