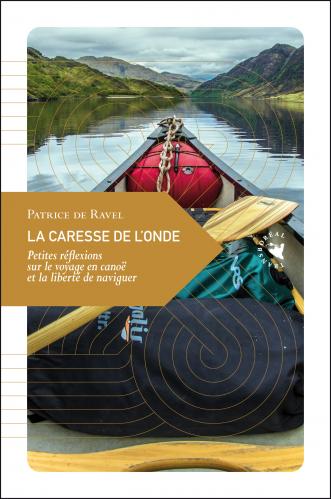
Souvenir d’enfance :
« Je l’avoue, je ne connais pas les rivières canadiennes, mais je me souviens – que dis-je, “je me souviens” ; il ne s’agit pas d’un souvenir, c’est ancré en moi ! – de l’instant où, pour la première fois, je me suis mis à flotter. J’étais à un âge où tout est encore à inventer et, subitement, j’eus le privilège de découvrir un nouvel état, au sens chimique du terme ; au-delà du solide et du liquide, je trouvai un autre monde. Je découvris qu’il était possible non seulement d’être sur ou dans un élément (sur terre ou enfoui, dans l’eau ou en l’air), mais également de se placer entre deux, et dans une situation qui n’était pas éphémère. Un état dans lequel je n’étais pas en équilibre, vacillant comme je pouvais l’être sur un vélo, ou bien en sursis comme lors d’un plongeon, mais bien dans une nouvelle situation a priori stable et dont la durée ne dépendait que de moi. Quelques minutes auparavant, je me tenais comme des milliards d’humains, bien campé sur mes deux pieds, les semelles rivées au sol. Mon poids assurait l’ancrage, le moindre mouvement de mes jambes entraînait un déplacement géographique de mon corps, l’appui était solide, ferme, certain. Je pouvais, immédiatement, avancer, reculer ou tourner. Depuis que j’avais enjambé le plat-bord du canoë, qui attendait sans impatience le long du ponton, ces certitudes s’étaient évanouies. Elles avaient cédé la place à une cascade de sensations nouvelles engendrées par un monde mouvant et fluide. Je venais d’entrer ailleurs. Le canoë était en fibre de verre – construction amateur comme la plupart de ses contemporains – et son fond possédait une souplesse sans doute supérieure à ce qu’avait voulu son constructeur. Avant d’avoir eu le temps de m’asseoir sur le barrot, debout sur ce fond, je me sentis Aladin sur son tapis volant. Plus âgé, on se serait moqué de moi en me rapprochant des héros de la chasse-galerie, ces Voyageurs qui, emportés par les effluves de vin, de malt et de houblon réunis, traversaient nuitamment le ciel québécois en canoë pour rejoindre leurs belles. Je marchais sur l’eau. Je percevais par les pieds, comme par capillarité, le moindre mouvement de surface, la plus petite frisure. Je sentais même sa fraîcheur.
L’embarquement m’avait écarté du ponton : je pris mon envol. Assis, la pagaie maladroitement en main, je compris l’immensité offerte. En un instant, je rejoignis les héros de mes lectures enfantines, les draveurs et les coureurs de bois canadiens et leurs amis indiens, les flotteurs de bois de chez nous et les gabariers. Je survolai le Nautilus, je pénétrai l’univers de Grey Owl et de Longfellow. Plus loin encore de la rive, j’accompagnai la jangada de Jules Verne. Bientôt, les moulins à eau n’auraient plus de secrets pour moi, ni les gouffres cachés sous les ponts, ni? Cela ne dura qu’un instant, mais il y a des éternités brèves. Plus tard, bien plus tard, j’ai compris sa proximité avec l’ukiyo-e, ce monde cher aux Japonais que l’on rétrécit un peu rapidement à celui des plaisirs et qu’ils disent flottant. Le bien nommé. »
Déboucher en mer (p. 44-47)
Le rapport à la ville (p. 72-76)
Extrait court
« Je l’avoue, je ne connais pas les rivières canadiennes, mais je me souviens – que dis-je, “je me souviens” ; il ne s’agit pas d’un souvenir, c’est ancré en moi ! – de l’instant où, pour la première fois, je me suis mis à flotter. J’étais à un âge où tout est encore à inventer et, subitement, j’eus le privilège de découvrir un nouvel état, au sens chimique du terme ; au-delà du solide et du liquide, je trouvai un autre monde. Je découvris qu’il était possible non seulement d’être sur ou dans un élément (sur terre ou enfoui, dans l’eau ou en l’air), mais également de se placer entre deux, et dans une situation qui n’était pas éphémère. Un état dans lequel je n’étais pas en équilibre, vacillant comme je pouvais l’être sur un vélo, ou bien en sursis comme lors d’un plongeon, mais bien dans une nouvelle situation a priori stable et dont la durée ne dépendait que de moi. Quelques minutes auparavant, je me tenais comme des milliards d’humains, bien campé sur mes deux pieds, les semelles rivées au sol. Mon poids assurait l’ancrage, le moindre mouvement de mes jambes entraînait un déplacement géographique de mon corps, l’appui était solide, ferme, certain. Je pouvais, immédiatement, avancer, reculer ou tourner. Depuis que j’avais enjambé le plat-bord du canoë, qui attendait sans impatience le long du ponton, ces certitudes s’étaient évanouies. Elles avaient cédé la place à une cascade de sensations nouvelles engendrées par un monde mouvant et fluide. Je venais d’entrer ailleurs. Le canoë était en fibre de verre – construction amateur comme la plupart de ses contemporains – et son fond possédait une souplesse sans doute supérieure à ce qu’avait voulu son constructeur. Avant d’avoir eu le temps de m’asseoir sur le barrot, debout sur ce fond, je me sentis Aladin sur son tapis volant. Plus âgé, on se serait moqué de moi en me rapprochant des héros de la chasse-galerie, ces Voyageurs qui, emportés par les effluves de vin, de malt et de houblon réunis, traversaient nuitamment le ciel québécois en canoë pour rejoindre leurs belles. Je marchais sur l’eau. Je percevais par les pieds, comme par capillarité, le moindre mouvement de surface, la plus petite frisure. Je sentais même sa fraîcheur.
L’embarquement m’avait écarté du ponton : je pris mon envol. Assis, la pagaie maladroitement en main, je compris l’immensité offerte. En un instant, je rejoignis les héros de mes lectures enfantines, les draveurs et les coureurs de bois canadiens et leurs amis indiens, les flotteurs de bois de chez nous et les gabariers. Je survolai le Nautilus, je pénétrai l’univers de Grey Owl et de Longfellow. Plus loin encore de la rive, j’accompagnai la jangada de Jules Verne. Bientôt, les moulins à eau n’auraient plus de secrets pour moi, ni les gouffres cachés sous les ponts, ni? Cela ne dura qu’un instant, mais il y a des éternités brèves. Plus tard, bien plus tard, j’ai compris sa proximité avec l’ukiyo-e, ce monde cher aux Japonais que l’on rétrécit un peu rapidement à celui des plaisirs et qu’ils disent flottant. Le bien nommé. »
(p. 32-34)
Déboucher en mer (p. 44-47)
Le rapport à la ville (p. 72-76)
Extrait court


