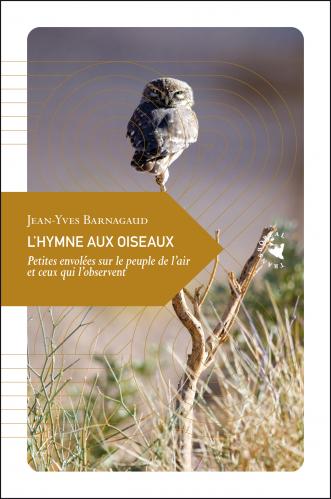
Communauté de destin :
« Le “printemps silencieux” n’est pas seulement celui de la biologiste Rachel Carson, une agriculture intensive dont les pesticides ont décimé les populations d’oiseaux des champs ; il accompagne aussi la désertification des paysages qu’impose la disparition de l’agriculture traditionnelle. L’abandon des mosaïques pastorales cévenoles et ardéchoises au milieu du siècle dernier fut fatal à nombre d’espèces méditerranéennes : les maquis de chênes qui les ont remplacées sont désespérément stériles, car trop denses pour convenir à la majorité des oiseaux forestiers. Le drame ornithologique qui accompagne l’exode rural est particulièrement criant sur les hauts plateaux tibétains. Dans ces déserts d’altitude, les villages de nomades constituaient, il y a dix ans encore, des oasis rayonnantes de vie, où bergeronnettes citrines, niverolles et roselins abondaient parmi les troupeaux de yacks ou de chèvres. Lorsque j’ai récemment revu ces villages, que l’assèchement des cours d’eau et une vie trop rude ont vidés de leurs éleveurs, ne restait qu’une alouette ou deux cherchant une maigre pitance dans des enclos devenus stériles. Même le rougequeue de Güldenstädt, hôte emblématique des alpages himalayens, a pratiquement disparu de ces ruines où le bétail lui garantissait une profusion d’arthropodes dont nourrir ses nichées.
Dans ces paysages désolés, comme partout ailleurs dans le monde, hommes et oiseaux se sont alliés dans leurs pérégrinations immémoriales en quête de territoires, de climats favorables et de nourriture. C’est probablement parce qu’ils lui procuraient d’abondantes ressources que le moineau domestique, alors restreint au Moyen-Orient, accompagna il y a dix millénaires les peuples nomades dans leurs migrations vers l’ouest. Bien avant que les grandes cultures céréalières et les palmeraies industrielles du XXe siècle ne stérilisent des régions entières, l’ouverture des bocages dans les vastes massifs forestiers d’Europe de l’Ouest ou l’invention des foggara sahariennes ont ainsi ouvert de nouveaux horizons aux communautés d’oiseaux steppiques durant des millénaires d’agriculture. En retour, les oiseaux facilitent la dispersion des graines, contrôlent les ravageurs des cultures, nettoient les carcasses et fournissent un gibier facile d’accès : ces interactions spontanées leur ont non seulement permis de coexister durablement avec l’humain, mais aussi de tirer parti de son expansion. Ne cherche-t-on pas désormais à préserver les haies, les saules têtards et les prairies humides du centre de la France, constructions parfaitement artificielles, pour sauver de l’extinction une population de chevêches ou de râles des genêts ? Ce n’est pas à l’humain qu’il faut reprocher le déclin des oiseaux, mais à une certaine pensée de la civilisation, en opposition avec la nature, qui entraîne avec elle mosaïques paysagères, polyculture traditionnelle et forêts primaires, sur fond de changements climatiques et d’invasions d’espèces. L’agriculteur en souffre tout autant que l’oiseau : c’est le même processus qui, en fin de compte, fait disparaître le berger et le rougequeue des alpages qu’ils avaient colonisés ensemble – et ils y reviennent ensemble lorsque, petite lueur d’espoir, on restaure le pastoralisme de montagne. »
Un compagnonnnage fécond (p. 21-24)
Façons de voir (p. 55-59)
Extrait court
« Le “printemps silencieux” n’est pas seulement celui de la biologiste Rachel Carson, une agriculture intensive dont les pesticides ont décimé les populations d’oiseaux des champs ; il accompagne aussi la désertification des paysages qu’impose la disparition de l’agriculture traditionnelle. L’abandon des mosaïques pastorales cévenoles et ardéchoises au milieu du siècle dernier fut fatal à nombre d’espèces méditerranéennes : les maquis de chênes qui les ont remplacées sont désespérément stériles, car trop denses pour convenir à la majorité des oiseaux forestiers. Le drame ornithologique qui accompagne l’exode rural est particulièrement criant sur les hauts plateaux tibétains. Dans ces déserts d’altitude, les villages de nomades constituaient, il y a dix ans encore, des oasis rayonnantes de vie, où bergeronnettes citrines, niverolles et roselins abondaient parmi les troupeaux de yacks ou de chèvres. Lorsque j’ai récemment revu ces villages, que l’assèchement des cours d’eau et une vie trop rude ont vidés de leurs éleveurs, ne restait qu’une alouette ou deux cherchant une maigre pitance dans des enclos devenus stériles. Même le rougequeue de Güldenstädt, hôte emblématique des alpages himalayens, a pratiquement disparu de ces ruines où le bétail lui garantissait une profusion d’arthropodes dont nourrir ses nichées.
Dans ces paysages désolés, comme partout ailleurs dans le monde, hommes et oiseaux se sont alliés dans leurs pérégrinations immémoriales en quête de territoires, de climats favorables et de nourriture. C’est probablement parce qu’ils lui procuraient d’abondantes ressources que le moineau domestique, alors restreint au Moyen-Orient, accompagna il y a dix millénaires les peuples nomades dans leurs migrations vers l’ouest. Bien avant que les grandes cultures céréalières et les palmeraies industrielles du XXe siècle ne stérilisent des régions entières, l’ouverture des bocages dans les vastes massifs forestiers d’Europe de l’Ouest ou l’invention des foggara sahariennes ont ainsi ouvert de nouveaux horizons aux communautés d’oiseaux steppiques durant des millénaires d’agriculture. En retour, les oiseaux facilitent la dispersion des graines, contrôlent les ravageurs des cultures, nettoient les carcasses et fournissent un gibier facile d’accès : ces interactions spontanées leur ont non seulement permis de coexister durablement avec l’humain, mais aussi de tirer parti de son expansion. Ne cherche-t-on pas désormais à préserver les haies, les saules têtards et les prairies humides du centre de la France, constructions parfaitement artificielles, pour sauver de l’extinction une population de chevêches ou de râles des genêts ? Ce n’est pas à l’humain qu’il faut reprocher le déclin des oiseaux, mais à une certaine pensée de la civilisation, en opposition avec la nature, qui entraîne avec elle mosaïques paysagères, polyculture traditionnelle et forêts primaires, sur fond de changements climatiques et d’invasions d’espèces. L’agriculteur en souffre tout autant que l’oiseau : c’est le même processus qui, en fin de compte, fait disparaître le berger et le rougequeue des alpages qu’ils avaient colonisés ensemble – et ils y reviennent ensemble lorsque, petite lueur d’espoir, on restaure le pastoralisme de montagne. »
(p. 77-80)
Un compagnonnnage fécond (p. 21-24)
Façons de voir (p. 55-59)
Extrait court


