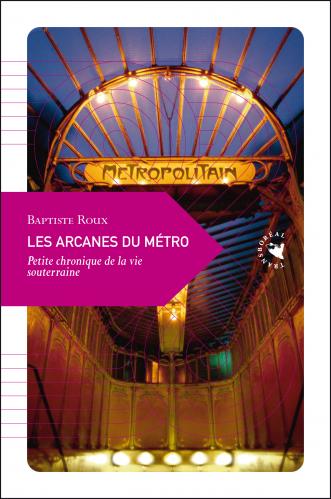
Un miroir de la surface :
« C’est ainsi que le métro, miroir de la conscience urbaine, a perdu en charme pittoresque ce qu’il gagnait en efficacité impersonnelle. La modernité d’après-guerre semble avoir consacré le reflux de l’humain dans un irrésistible mouvement d’automatisation. Jusqu’à la fin des années 1960, les différentes compagnies parisiennes (la CMP ou la fameuse Nord-Sud, aux N et S entrecroisés qui jalonnaient les emprises des deux lignes, enfin la RATP) s’ingénièrent à multiplier les agents pour doter le réseau souterrain de la légitimité du chemin de fer aérien. Du receveur au surveillant de quai, en passant par le chef de train responsable de tout le personnel à bord – y compris le conducteur –, évoluait en sous-sol un personnel pléthorique qui, pénétré de son importance, construisait l’identité métropolitaine à partir de rituels soigneusement établis comme la vérification suspicieuse du billet de première classe, ou d’objets devenus mythiques comme la sacoche noire du contrôleur, le portillon à moteur extérieur ou le bâton incurvé agité par le chef de station dans les gares en courbe. L’icône par excellence de cette époque révolue demeure le poinçonneur, cerbère interdisant l’accès à la rame bien avant son entrée dans la station, inflexible sous le feu des suppliques de l’étudiant fauché ou du salarié fâché avec l’horaire. Serge Gainsbourg lui attribue en 1958 une crise existentielle et des désirs d’absolu difficiles à imaginer derrière ces figures marmoréennes qui s’adonnaient avec une gravité sourcilleuse, entre deux oblitérations, au crochet ou aux mots croisés.
Cette galaxie peuple tout un pan de la mémoire parisienne, portée par une certaine nostalgie qu’entretiennent les photographies de Brassaï ou de Doisneau et le réalisme poétique des films de Marcel Carné, Claude Autant-Lara ou René Clair. Des œuvres comme Marguerite de la nuit, Les Portes de la nuit – où les personnages évoluent autour de la station Barbès –, La Traversée de Paris – et son fameux début à la station Saint-Marcel – ou Porte des Lilas, avec un Georges Brassens en artiste lunaire, accordent au décor “naturel” du métro une place essentielle, lieu des hasards et des possibles qui consonne parfaitement avec des personnages évoluant aux marges de la légalité. Point de rencontre au crépuscule d’amours contrariées, lieu du partage de secrets compromettants ou d’arrangements troubles, les quais ou les abords du métro offrent un cadre d’élection pour illustrer les ténèbres morales des personnages, sur fond d’un air d’accordéon joué par un mendiant dans les couloirs. Le Paris des crieurs de journaux, des vendeurs de boulets, des marchands des quatre saisons ou des concierges indiscrètes s’harmonise à merveille avec ce véhicule populaire et familier – quand les Immortels refusaient catégoriquement le passage de la ligne Porte-d’Orléans/Porte-de-Clignancourt sous l’Académie française, par peur que les trépidations ne dérangeassent leurs travaux?
Las, depuis cinquante ans, la RATP s’obstine à substituer à l’être humain des machines au rendement similaire mais totalement désincarnées, détruisant du même coup la mythologie des premières décennies. L’introduction des rames sur pneus, le système de conduite automatique – à laquelle échappe aujourd’hui la seule ligne Boulogne/Gare-d’Austerlitz –, la disparition des guichetiers ou la généralisation des portillons pneumatiques signent la désertion des agents, réservant les stations aux seuls voyageurs. Devenue invisible, l’institution métropolitaine semble déléguer à un univers autonome le soin de réguler son organisation et son contrôle. »
Mélodies en sous-sol (p. 36-40)
Petite sociologie suburbaine (p. 73-79)
Extrait court
« C’est ainsi que le métro, miroir de la conscience urbaine, a perdu en charme pittoresque ce qu’il gagnait en efficacité impersonnelle. La modernité d’après-guerre semble avoir consacré le reflux de l’humain dans un irrésistible mouvement d’automatisation. Jusqu’à la fin des années 1960, les différentes compagnies parisiennes (la CMP ou la fameuse Nord-Sud, aux N et S entrecroisés qui jalonnaient les emprises des deux lignes, enfin la RATP) s’ingénièrent à multiplier les agents pour doter le réseau souterrain de la légitimité du chemin de fer aérien. Du receveur au surveillant de quai, en passant par le chef de train responsable de tout le personnel à bord – y compris le conducteur –, évoluait en sous-sol un personnel pléthorique qui, pénétré de son importance, construisait l’identité métropolitaine à partir de rituels soigneusement établis comme la vérification suspicieuse du billet de première classe, ou d’objets devenus mythiques comme la sacoche noire du contrôleur, le portillon à moteur extérieur ou le bâton incurvé agité par le chef de station dans les gares en courbe. L’icône par excellence de cette époque révolue demeure le poinçonneur, cerbère interdisant l’accès à la rame bien avant son entrée dans la station, inflexible sous le feu des suppliques de l’étudiant fauché ou du salarié fâché avec l’horaire. Serge Gainsbourg lui attribue en 1958 une crise existentielle et des désirs d’absolu difficiles à imaginer derrière ces figures marmoréennes qui s’adonnaient avec une gravité sourcilleuse, entre deux oblitérations, au crochet ou aux mots croisés.
Cette galaxie peuple tout un pan de la mémoire parisienne, portée par une certaine nostalgie qu’entretiennent les photographies de Brassaï ou de Doisneau et le réalisme poétique des films de Marcel Carné, Claude Autant-Lara ou René Clair. Des œuvres comme Marguerite de la nuit, Les Portes de la nuit – où les personnages évoluent autour de la station Barbès –, La Traversée de Paris – et son fameux début à la station Saint-Marcel – ou Porte des Lilas, avec un Georges Brassens en artiste lunaire, accordent au décor “naturel” du métro une place essentielle, lieu des hasards et des possibles qui consonne parfaitement avec des personnages évoluant aux marges de la légalité. Point de rencontre au crépuscule d’amours contrariées, lieu du partage de secrets compromettants ou d’arrangements troubles, les quais ou les abords du métro offrent un cadre d’élection pour illustrer les ténèbres morales des personnages, sur fond d’un air d’accordéon joué par un mendiant dans les couloirs. Le Paris des crieurs de journaux, des vendeurs de boulets, des marchands des quatre saisons ou des concierges indiscrètes s’harmonise à merveille avec ce véhicule populaire et familier – quand les Immortels refusaient catégoriquement le passage de la ligne Porte-d’Orléans/Porte-de-Clignancourt sous l’Académie française, par peur que les trépidations ne dérangeassent leurs travaux?
Las, depuis cinquante ans, la RATP s’obstine à substituer à l’être humain des machines au rendement similaire mais totalement désincarnées, détruisant du même coup la mythologie des premières décennies. L’introduction des rames sur pneus, le système de conduite automatique – à laquelle échappe aujourd’hui la seule ligne Boulogne/Gare-d’Austerlitz –, la disparition des guichetiers ou la généralisation des portillons pneumatiques signent la désertion des agents, réservant les stations aux seuls voyageurs. Devenue invisible, l’institution métropolitaine semble déléguer à un univers autonome le soin de réguler son organisation et son contrôle. »
(p. 47-50)
Mélodies en sous-sol (p. 36-40)
Petite sociologie suburbaine (p. 73-79)
Extrait court


