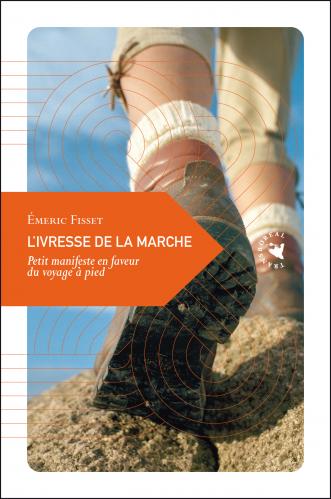
Le goût de l’humanité :
« Le paradoxe qu’éprouve le voyageur à pied réside dans le fait que plus il s’éloigne de l’humanité, pour quitter les destructions qu’elle a infligées à la nature – pollution, urbanisation, réseau routier, lignes à haute tension, canalisations – et pour retrouver le monde sauvage, l’arpenter et y subsister, plus l’humanité lui redevient estimable et finit par lui manquer. Affronter les dangers du terrain et l’âpreté du désert, de la taïga ou de la toundra, s’exposer au risque des rencontres animalières et de la furie des éléments, connaître la solitude à cent lieues de toute habitation est mentalement très exigeant. Plus encore, il est à la fois exaltant et épuisant d’être à tout moment l’unique responsable de chaque acte qu’on décide, au point qu’on hésite à sauter du plus modeste caillou pour ne pas risquer de se fouler la cheville, qu’on mûrit l’heure et le lieu de franchissement d’un cours d’eau, qu’on anticipe, avant que le vent ne forcisse, l’enfilage d’un autre vêtement ou d’une seconde paire de moufles, qu’on économise scrupuleusement ses provisions et qu’on veille de manière quasi obsessionnelle à ne pas écraser sa boussole ou laisser sa carte s’envoler.
Cette hyperconscience des gestes qu’il accomplit et la maturation des choix qu’il fait, cette remise en question de la place qu’il occupe dans le milieu au sein duquel il évolue, dont rien ni personne d’autre que lui ne saurait l’extraire, font à la fois la grandeur et la fragilité du voyageur à pied. En proie à l’isolement qu’il s’est imposé, il en vient à reconsidérer d’un œil neuf les inconvénients de la vie en société, à regretter la chaleur du foyer et la sécurité d’un toit. Après cinquante jours de périple en terre d’Ellesmere, dans le Grand Nord canadien, sans l’observation sur terre, sur mer ou dans le ciel du moindre signe de présence humaine autre qu’une cabane et un campement inuit abandonné – imagine-t-on en quels lieux de solitude on peut ne pas observer le passage d’un avion cinquante jours durant ? –, la vue d’un fût de carburant rouillé sur un rocher constitua pour mon compagnon de voyage et moi-même une émotion intense avant que les maisons préfabriquées et sans charme du hameau de Grise Fiord n’incarnent à nos yeux la victoire de l’homme sur l’impitoyable univers du haut Arctique.
Je compris alors pourquoi la plupart des Iñupiat du détroit de Béring laissaient sans scrupule leurs détritus sur la toundra ou les lançaient par-dessus bord en mer : la vue de cette immonde canette ou de cette bouteille brisée redonnerait peut-être le sursaut de courage qui permettrait à l’homme égaré dans le blizzard de prendre encore sur lui pour s’acharner à survivre et atteindre un point habité. Quand on se met à apprécier la vue fortuite des artefacts qu’on a fuis, on devient semblable à Zarathustra qui, après dix années de solitude, s’estimant rassasié de sa sagesse solipsiste, décide qu’il est temps de redescendre vers les hommes, avec lesquels il se trouve réconcilié. »
L’abandon à l’espace et au temps (p. 13-17)
Avec ma solitude (p. 80-83)
Extrait court
« Le paradoxe qu’éprouve le voyageur à pied réside dans le fait que plus il s’éloigne de l’humanité, pour quitter les destructions qu’elle a infligées à la nature – pollution, urbanisation, réseau routier, lignes à haute tension, canalisations – et pour retrouver le monde sauvage, l’arpenter et y subsister, plus l’humanité lui redevient estimable et finit par lui manquer. Affronter les dangers du terrain et l’âpreté du désert, de la taïga ou de la toundra, s’exposer au risque des rencontres animalières et de la furie des éléments, connaître la solitude à cent lieues de toute habitation est mentalement très exigeant. Plus encore, il est à la fois exaltant et épuisant d’être à tout moment l’unique responsable de chaque acte qu’on décide, au point qu’on hésite à sauter du plus modeste caillou pour ne pas risquer de se fouler la cheville, qu’on mûrit l’heure et le lieu de franchissement d’un cours d’eau, qu’on anticipe, avant que le vent ne forcisse, l’enfilage d’un autre vêtement ou d’une seconde paire de moufles, qu’on économise scrupuleusement ses provisions et qu’on veille de manière quasi obsessionnelle à ne pas écraser sa boussole ou laisser sa carte s’envoler.
Cette hyperconscience des gestes qu’il accomplit et la maturation des choix qu’il fait, cette remise en question de la place qu’il occupe dans le milieu au sein duquel il évolue, dont rien ni personne d’autre que lui ne saurait l’extraire, font à la fois la grandeur et la fragilité du voyageur à pied. En proie à l’isolement qu’il s’est imposé, il en vient à reconsidérer d’un œil neuf les inconvénients de la vie en société, à regretter la chaleur du foyer et la sécurité d’un toit. Après cinquante jours de périple en terre d’Ellesmere, dans le Grand Nord canadien, sans l’observation sur terre, sur mer ou dans le ciel du moindre signe de présence humaine autre qu’une cabane et un campement inuit abandonné – imagine-t-on en quels lieux de solitude on peut ne pas observer le passage d’un avion cinquante jours durant ? –, la vue d’un fût de carburant rouillé sur un rocher constitua pour mon compagnon de voyage et moi-même une émotion intense avant que les maisons préfabriquées et sans charme du hameau de Grise Fiord n’incarnent à nos yeux la victoire de l’homme sur l’impitoyable univers du haut Arctique.
Je compris alors pourquoi la plupart des Iñupiat du détroit de Béring laissaient sans scrupule leurs détritus sur la toundra ou les lançaient par-dessus bord en mer : la vue de cette immonde canette ou de cette bouteille brisée redonnerait peut-être le sursaut de courage qui permettrait à l’homme égaré dans le blizzard de prendre encore sur lui pour s’acharner à survivre et atteindre un point habité. Quand on se met à apprécier la vue fortuite des artefacts qu’on a fuis, on devient semblable à Zarathustra qui, après dix années de solitude, s’estimant rassasié de sa sagesse solipsiste, décide qu’il est temps de redescendre vers les hommes, avec lesquels il se trouve réconcilié. »
(p. 43-45)
L’abandon à l’espace et au temps (p. 13-17)
Avec ma solitude (p. 80-83)
Extrait court


