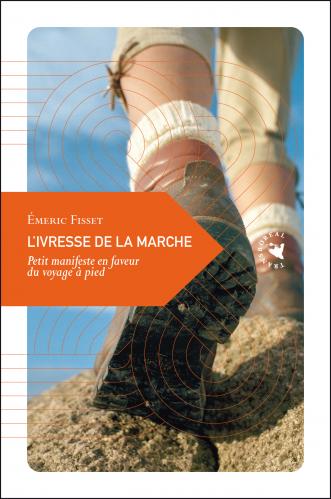
L’abandon à l’espace et au temps :
« Voyager à pied signifie s’abandonner à l’espace et au temps. À l’espace, car une fois tracée la ligne entre son point de départ et le but qu’il s’est assigné – la pointe sud d’un continent ou le cap nord d’un autre, le bout d’une chaîne de montagnes ou le delta d’un fleuve –, le marcheur ne sait jamais exactement où ses pas l’entraîneront le jour suivant. Il sait juste que ce jour-là et le jour d’après encore ses jambes le porteront, et ne doute pas qu’elles ne lui permettent d’entrevoir, à une date indéterminée, le finistère dont il a rêvé. L’homme qui marche au long cours n’a pas la maîtrise de l’étape. Celle-ci peut dépendre d’un abri providentiel sous la pluie drue, de l’autochtone qui, au vu de sa fatigue et du soir tombant, le retient chez lui, plus rarement de l’ouverture de l’ultime magasin sur son itinéraire. Quoi qu’il en soit, une fois que le voyageur a effectué ses huit à douze heures de progression quotidienne – ce qui, en terrain inconnu, ne représente guère plus de 35 kilomètres –, il ne saurait être question pour lui de rallier la ville et ses petits hôtels, telle auberge de charme ou tel camping au bord d’un lac.
Une lapalissade veut que le marcheur s’arrête là où s’achève sa journée de marche. En deux heures de plus, un cycliste pourrait échapper à la steppe poussiéreuse en couvrant les 30 kilomètres qui le séparent encore d’une bourgade, ou quitter un lieu inquiétant en se mettant sous la protection de la police. Le motard pourrait rouler jusque tard dans la nuit vers les lumières rassurantes de la ville, tandis que le voyageur qui utilise le train ou les cars locaux connaîtrait son heure et son lieu d’arrivée, quand bien même un incident viendrait le retarder avec les autres passagers. Le marcheur, lui, s’arrêtera parfois là où nul autre que lui n’aurait jamais songé à s’arrêter : au bord d’un chemin, dans un campement isolé, une ferme, des ruines, un camp de bûcheronnage ou une mine perdue. Il demandera l’autorisation de planter sa tente là où rien de remarquable ni de touristique ne prédispose à le faire. Et pour ne pas éveiller la suspicion à l’endroit où se trouve sa seule chance de faire halte, il devra avoir le regard pur de celui qui vient de loin, ne convoite rien hormis l’espace sur lequel ses jambes seules lui donnent prise.
Voyager à pied signifie aussi s’abandonner au temps. Cela revient à accepter pleinement de la nature ce qu’elle prodigue, le soleil comme les intempéries, la chaleur comme le froid, l’exubérance comme l’austérité, l’exaltation comme le découragement. Quiconque entreprend un périple de quelque ampleur se refuse à choisir les seuls jours de météo favorable pour avancer. Ni la pluie, ni la neige, ni le vent, ni même la saison n’arrête le marcheur au long cours, car c’est dans le rythme de l’effort, dans la confrontation quotidienne avec le terrain et les éléments, dans l’action qu’il puise sa force ; c’est la tension du but à atteindre qui l’amène à se dépasser, à faire fi des aléas climatiques, de la belle saison qui s’achève. Car la marche permet de redécouvrir l’importance des saisons et des grands rendez-vous annuels qu’étaient autrefois les équinoxes et plus encore les solstices. Celui qui est dehors et n’a d’autre protection que ce que renferme son sac et les ressources que lui dicte sa sagacité face au terrain sait ce que représentent l’été qui s’efface devant l’automne ou l’hiver qui fait place au printemps, l’apparition des narcisses ou la fanaison des épilobes. Ne pas passer de parasol en parapluie, de bus climatisé en hôtel de luxe, d’animation collective en soirée folklorique, mais connaître le bonheur du rayon de soleil dont on désespérait, la joie d’une cabane inattendue ou d’une rencontre sincère et fortuite : la confrontation du marcheur au terrain offre tout cela, et bien plus encore. »
Le goût de l’humanité (p. 43-45)
Avec ma solitude (p. 80-83)
Extrait court
« Voyager à pied signifie s’abandonner à l’espace et au temps. À l’espace, car une fois tracée la ligne entre son point de départ et le but qu’il s’est assigné – la pointe sud d’un continent ou le cap nord d’un autre, le bout d’une chaîne de montagnes ou le delta d’un fleuve –, le marcheur ne sait jamais exactement où ses pas l’entraîneront le jour suivant. Il sait juste que ce jour-là et le jour d’après encore ses jambes le porteront, et ne doute pas qu’elles ne lui permettent d’entrevoir, à une date indéterminée, le finistère dont il a rêvé. L’homme qui marche au long cours n’a pas la maîtrise de l’étape. Celle-ci peut dépendre d’un abri providentiel sous la pluie drue, de l’autochtone qui, au vu de sa fatigue et du soir tombant, le retient chez lui, plus rarement de l’ouverture de l’ultime magasin sur son itinéraire. Quoi qu’il en soit, une fois que le voyageur a effectué ses huit à douze heures de progression quotidienne – ce qui, en terrain inconnu, ne représente guère plus de 35 kilomètres –, il ne saurait être question pour lui de rallier la ville et ses petits hôtels, telle auberge de charme ou tel camping au bord d’un lac.
Une lapalissade veut que le marcheur s’arrête là où s’achève sa journée de marche. En deux heures de plus, un cycliste pourrait échapper à la steppe poussiéreuse en couvrant les 30 kilomètres qui le séparent encore d’une bourgade, ou quitter un lieu inquiétant en se mettant sous la protection de la police. Le motard pourrait rouler jusque tard dans la nuit vers les lumières rassurantes de la ville, tandis que le voyageur qui utilise le train ou les cars locaux connaîtrait son heure et son lieu d’arrivée, quand bien même un incident viendrait le retarder avec les autres passagers. Le marcheur, lui, s’arrêtera parfois là où nul autre que lui n’aurait jamais songé à s’arrêter : au bord d’un chemin, dans un campement isolé, une ferme, des ruines, un camp de bûcheronnage ou une mine perdue. Il demandera l’autorisation de planter sa tente là où rien de remarquable ni de touristique ne prédispose à le faire. Et pour ne pas éveiller la suspicion à l’endroit où se trouve sa seule chance de faire halte, il devra avoir le regard pur de celui qui vient de loin, ne convoite rien hormis l’espace sur lequel ses jambes seules lui donnent prise.
Voyager à pied signifie aussi s’abandonner au temps. Cela revient à accepter pleinement de la nature ce qu’elle prodigue, le soleil comme les intempéries, la chaleur comme le froid, l’exubérance comme l’austérité, l’exaltation comme le découragement. Quiconque entreprend un périple de quelque ampleur se refuse à choisir les seuls jours de météo favorable pour avancer. Ni la pluie, ni la neige, ni le vent, ni même la saison n’arrête le marcheur au long cours, car c’est dans le rythme de l’effort, dans la confrontation quotidienne avec le terrain et les éléments, dans l’action qu’il puise sa force ; c’est la tension du but à atteindre qui l’amène à se dépasser, à faire fi des aléas climatiques, de la belle saison qui s’achève. Car la marche permet de redécouvrir l’importance des saisons et des grands rendez-vous annuels qu’étaient autrefois les équinoxes et plus encore les solstices. Celui qui est dehors et n’a d’autre protection que ce que renferme son sac et les ressources que lui dicte sa sagacité face au terrain sait ce que représentent l’été qui s’efface devant l’automne ou l’hiver qui fait place au printemps, l’apparition des narcisses ou la fanaison des épilobes. Ne pas passer de parasol en parapluie, de bus climatisé en hôtel de luxe, d’animation collective en soirée folklorique, mais connaître le bonheur du rayon de soleil dont on désespérait, la joie d’une cabane inattendue ou d’une rencontre sincère et fortuite : la confrontation du marcheur au terrain offre tout cela, et bien plus encore. »
(p. 13-17)
Le goût de l’humanité (p. 43-45)
Avec ma solitude (p. 80-83)
Extrait court


