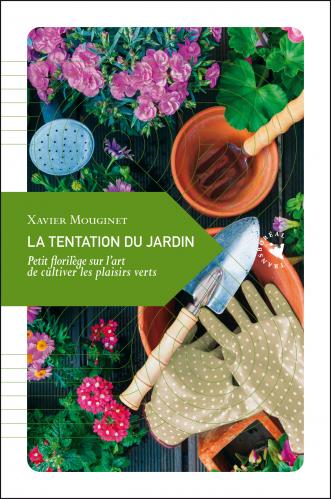
Temporalité du jardin :
« Si le temps s’imbrique avec une telle force dans le jardin, dans sa morphologie, dans sa croissance et son évolution, il ne paraît pas illégitime de s’interroger sur l’apparition de l’acte de jardinage dans l’histoire de l’humanité. Quand ce travail de la terre a-t-il vu le jour ? Si la réponse n’est pas définitive, je soutiendrais volontiers que le jardin est né avec la découverte du phénomène de reproduction par les semences, pour épargner aux hommes de longues marches à la recherche d’une pitance quotidienne. Le jardin des origines fut certainement un potager. On plante à proximité de chez soi ce que l’on a trouvé de comestible plus loin. Cette histoire qui ne grandit pas l’homme, praticien de l’indolence, avec sa pure intention de se nourrir en abondance, à moindre effort, est conforme au plus naturel de ses penchants.
Le jardin comme moyen d’expression débarrassé du dessein nourricier germe probablement bien plus tard. Peu à peu, l’idée de créer des formes avec le végétal, en assemblant différentes espèces ou en sculptant directement la plante, prend corps et transforme le paysan en jardinier. Celui-là est toujours homme de la terre, mais, à présent, il conçoit et dessine des plans, nécessairement dans un cadre, car son esprit ne peut embrasser l’horizon. Il balise l’espace végétal et, ce faisant, le sacralise. La nature l’inspire. Elle lui donne des leçons et édicte ses lois : on ne plante pas n’importe quoi à cet emplacement-là ou à côté de cette plante-là ; on ne plante pas n’importe quand sous cette latitude-là. La terre est rancunière ; elle peut vite faire baver la peinture à cet endroit du tableau. Et dans cet équilibre fragile, le trait mal assuré du jardinier peut à son tour gâcher la composition. Le vivant n’est pas aussi malléable que l’homme le souhaiterait, et les végétaux n’ont pas toujours le caractère facile : alors que certains ont une docilité à toute épreuve, d’autres ont la rancœur à fleur d’écorce. A-t-on déjà vu fourmi nonchalante ou pie désintéressée ? Dans le même registre du vivant, pourquoi chaque plante n’aurait-elle pas sa personnalité ? J’ai peine à croire que la nature, faisant preuve d’une telle créativité dans la conception des formes des végétaux, ne soit pas aussi inventive dans le fond. Les stratégies de reproduction sont nombreuses, celles de l’adaptation ne le sont pas moins, et il appartient aux botanistes et aux jardiniers d’en découvrir tous les stratagèmes pour mieux les comprendre.
Le jardinier tient un peu du sorcier. Il doit trouver l’endroit qui convient pour que la magie opère, en composant avec l’irrationnel qui anime parfois le développement du vivant et en faisant de l’empirisme une donnée essentielle du succès. L’observation devrait le guider dans ses choix.
Quoi de plus commun que d’invoquer les dieux, de prier dame nature, d’enterrer des cornes de vache pleines de préparat ou de faire des tisanes pour certains figurants? avec l’ambition de la seule réussite d’une symphonie qui résonnerait en parfaite harmonie avec la nature ? La biodynamie aide à parvenir à cet équilibre et dispense le jardinier d’utiliser des intrants chimiques. On ne gagne rien à tricher avec le vivant, d’autant que l’observateur n’est pas dupe, à qui l’on expose une floraison outrancière ou une croissance improbable. En créant un nouvel espace ou en le végétalisant davantage, le jardinier doit l’insérer dans le cycle de la vie déjà présente à cet endroit. Ce devrait être une qualité qui l’anime : s’abstenir à tout prix de recourir aux pesticides et herbicides pour mener à bien son projet. Je sais la difficulté du combat contre la pyrale du buis ou les cicadelles. Mais rendons-leur grâce : elles ont simplement la même dévorante passion que nous pour le végétal. Au jardin, nous devons oublier la chimie pour conserver la vie. »
Jardins du monde (p. 30-33)
L’hirsute et le rigoureux (p. 36-40)
Extrait court
« Si le temps s’imbrique avec une telle force dans le jardin, dans sa morphologie, dans sa croissance et son évolution, il ne paraît pas illégitime de s’interroger sur l’apparition de l’acte de jardinage dans l’histoire de l’humanité. Quand ce travail de la terre a-t-il vu le jour ? Si la réponse n’est pas définitive, je soutiendrais volontiers que le jardin est né avec la découverte du phénomène de reproduction par les semences, pour épargner aux hommes de longues marches à la recherche d’une pitance quotidienne. Le jardin des origines fut certainement un potager. On plante à proximité de chez soi ce que l’on a trouvé de comestible plus loin. Cette histoire qui ne grandit pas l’homme, praticien de l’indolence, avec sa pure intention de se nourrir en abondance, à moindre effort, est conforme au plus naturel de ses penchants.
Le jardin comme moyen d’expression débarrassé du dessein nourricier germe probablement bien plus tard. Peu à peu, l’idée de créer des formes avec le végétal, en assemblant différentes espèces ou en sculptant directement la plante, prend corps et transforme le paysan en jardinier. Celui-là est toujours homme de la terre, mais, à présent, il conçoit et dessine des plans, nécessairement dans un cadre, car son esprit ne peut embrasser l’horizon. Il balise l’espace végétal et, ce faisant, le sacralise. La nature l’inspire. Elle lui donne des leçons et édicte ses lois : on ne plante pas n’importe quoi à cet emplacement-là ou à côté de cette plante-là ; on ne plante pas n’importe quand sous cette latitude-là. La terre est rancunière ; elle peut vite faire baver la peinture à cet endroit du tableau. Et dans cet équilibre fragile, le trait mal assuré du jardinier peut à son tour gâcher la composition. Le vivant n’est pas aussi malléable que l’homme le souhaiterait, et les végétaux n’ont pas toujours le caractère facile : alors que certains ont une docilité à toute épreuve, d’autres ont la rancœur à fleur d’écorce. A-t-on déjà vu fourmi nonchalante ou pie désintéressée ? Dans le même registre du vivant, pourquoi chaque plante n’aurait-elle pas sa personnalité ? J’ai peine à croire que la nature, faisant preuve d’une telle créativité dans la conception des formes des végétaux, ne soit pas aussi inventive dans le fond. Les stratégies de reproduction sont nombreuses, celles de l’adaptation ne le sont pas moins, et il appartient aux botanistes et aux jardiniers d’en découvrir tous les stratagèmes pour mieux les comprendre.
Le jardinier tient un peu du sorcier. Il doit trouver l’endroit qui convient pour que la magie opère, en composant avec l’irrationnel qui anime parfois le développement du vivant et en faisant de l’empirisme une donnée essentielle du succès. L’observation devrait le guider dans ses choix.
Quoi de plus commun que d’invoquer les dieux, de prier dame nature, d’enterrer des cornes de vache pleines de préparat ou de faire des tisanes pour certains figurants? avec l’ambition de la seule réussite d’une symphonie qui résonnerait en parfaite harmonie avec la nature ? La biodynamie aide à parvenir à cet équilibre et dispense le jardinier d’utiliser des intrants chimiques. On ne gagne rien à tricher avec le vivant, d’autant que l’observateur n’est pas dupe, à qui l’on expose une floraison outrancière ou une croissance improbable. En créant un nouvel espace ou en le végétalisant davantage, le jardinier doit l’insérer dans le cycle de la vie déjà présente à cet endroit. Ce devrait être une qualité qui l’anime : s’abstenir à tout prix de recourir aux pesticides et herbicides pour mener à bien son projet. Je sais la difficulté du combat contre la pyrale du buis ou les cicadelles. Mais rendons-leur grâce : elles ont simplement la même dévorante passion que nous pour le végétal. Au jardin, nous devons oublier la chimie pour conserver la vie. »
(p. 82-85)
Jardins du monde (p. 30-33)
L’hirsute et le rigoureux (p. 36-40)
Extrait court


