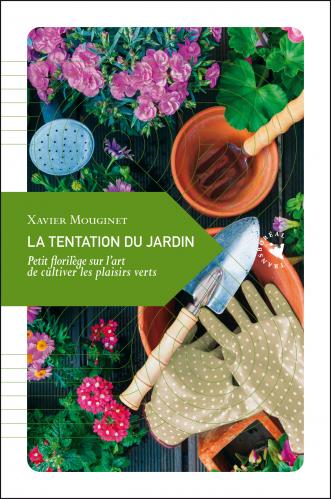
Jardins du monde :
« Paysages ou jardins, leur substance donne à voir la nature dans des oripeaux bigarrés que nous ne considérons pas toujours avec l’acuité qui nous les rendrait enchanteurs. Arrêtons-nous un instant. Prenons le temps d’observer ce monde que nous nous représentons, à tort, comme statique. Les lacs de Plitvice, non loin des côtes septentrionales de la Croatie, y invitent assurément. C’est un lieu étonnant, moins pour sa beauté que pour son ordonnancement. Les paysages créés par cet ensemble de lacs et de cascades sont tellement équilibrés qu’ils paraissent artificiels. Ces lacs se déversent en chutes qui traversent différents plateaux, au milieu d’une végétation dont l’harmonie pose question. Tout y semble si judicieusement placé qu’on en vient à se demander s’il ne s’agit pas de l’œuvre de quelque paysagiste : l’eau est si claire, les joncs si bien disposés, les bosquets de Festuca si exubérants, les moussus teints d’un vert si outrancier? Plus que la majesté de la nature, c’est la disposition parfaite des éléments qui frappe le voyageur, jusqu’aux carpes qui se pavanent ostensiblement à proximité des berges ; chaque portion de paysage semble organisée pour satisfaire à l’idée que l’on a de la perfection esthétique. Pourtant, nulle intervention humaine ici – ce parc naturel est classé au patrimoine mondial de l’Unesco –, seulement la démonstration que la nature se dispense sans faillir de la main de l’homme pour donner naissance, librement, à des jardins oniriques, parfois à notre échelle.
Il arrive, à l’inverse, que la création d’un jardin réponde à une exigence de copie d’un paysage. Le jardin japonais remplit cette aspiration. Comme aucun autre, il s’attache à produire ce que la nature est en mesure de nous communiquer, offrant à l’œil la quintessence d’un paysage tout entier inscrit dans un espace clos. De là vient peut-être la fascination des premiers voyageurs qui découvrirent l’archipel nippon. Les jardiniers y ont poussé l’art de la miniaturisation à son paroxysme en cultivant jusqu’à une forêt entière dans un seul et même pot. Les noms de taille des arbres évoquent l’effet des éléments sur la forme : battue par les vents, en nuages? D’où l’utilisation d’arbustes greffés, de caducs au feuillage changeant qui évoquent le rythme des saisons, de résineux persistants, de couvre-sols qui parlent de toutes les dimensions de la nature, de ses couleurs et du temps qui passe.
Ce qui étonne, à la vue de ces univers réduits, c’est la maîtrise technique au service de l’imitation. Le jardinier travaille à faire disparaître son intervention, à l’inverse de ce que l’on observe dans les jardins occidentaux où la taille et l’agencement sont souvent ostentatoires. En ce sens, le jardin asiatique parfait est celui qui réussit à devenir paysage. Il y a là une curiosité. Comment le jardin, qui naît de la main de l’homme, pourrait-il sembler naturel ? À bien y réfléchir, l’œuvre du jardinier japonais tient moins dans son habileté – quand bien même celle-ci reste déterminante – que dans sa capacité à observer la nature et à en synthétiser les éléments pour mieux la reproduire. Point de fantaisie : on retrouve dans le jardin japonais toute la rigueur d’une culture codifiée à l’extrême.
Que le paysage imite le jardin ou que le jardin tente de devenir paysage, une chose est sûre : grâce au regard, l’imaginaire nous transporte. Tous les sens s’aiguisent dans la direction voulue par l’auteur. Ne serait-ce pas d’ailleurs la grande affaire du jardinier, comme celle du peintre, que de donner à voir son œuvre pour faire voyager ? Contempler et partir. Contempler pour mieux partir, débarrassé du superficiel, et, au contact des végétaux, apprécier les textures, s’imprégner du vert, faire l’expérience du beau. En somme, faire naître d’un espace fini un imaginaire infini. »
L’hirsute et le rigoureux (p. 36-40)
Temporalité du jardin (p. 82-85)
Extrait court
« Paysages ou jardins, leur substance donne à voir la nature dans des oripeaux bigarrés que nous ne considérons pas toujours avec l’acuité qui nous les rendrait enchanteurs. Arrêtons-nous un instant. Prenons le temps d’observer ce monde que nous nous représentons, à tort, comme statique. Les lacs de Plitvice, non loin des côtes septentrionales de la Croatie, y invitent assurément. C’est un lieu étonnant, moins pour sa beauté que pour son ordonnancement. Les paysages créés par cet ensemble de lacs et de cascades sont tellement équilibrés qu’ils paraissent artificiels. Ces lacs se déversent en chutes qui traversent différents plateaux, au milieu d’une végétation dont l’harmonie pose question. Tout y semble si judicieusement placé qu’on en vient à se demander s’il ne s’agit pas de l’œuvre de quelque paysagiste : l’eau est si claire, les joncs si bien disposés, les bosquets de Festuca si exubérants, les moussus teints d’un vert si outrancier? Plus que la majesté de la nature, c’est la disposition parfaite des éléments qui frappe le voyageur, jusqu’aux carpes qui se pavanent ostensiblement à proximité des berges ; chaque portion de paysage semble organisée pour satisfaire à l’idée que l’on a de la perfection esthétique. Pourtant, nulle intervention humaine ici – ce parc naturel est classé au patrimoine mondial de l’Unesco –, seulement la démonstration que la nature se dispense sans faillir de la main de l’homme pour donner naissance, librement, à des jardins oniriques, parfois à notre échelle.
Il arrive, à l’inverse, que la création d’un jardin réponde à une exigence de copie d’un paysage. Le jardin japonais remplit cette aspiration. Comme aucun autre, il s’attache à produire ce que la nature est en mesure de nous communiquer, offrant à l’œil la quintessence d’un paysage tout entier inscrit dans un espace clos. De là vient peut-être la fascination des premiers voyageurs qui découvrirent l’archipel nippon. Les jardiniers y ont poussé l’art de la miniaturisation à son paroxysme en cultivant jusqu’à une forêt entière dans un seul et même pot. Les noms de taille des arbres évoquent l’effet des éléments sur la forme : battue par les vents, en nuages? D’où l’utilisation d’arbustes greffés, de caducs au feuillage changeant qui évoquent le rythme des saisons, de résineux persistants, de couvre-sols qui parlent de toutes les dimensions de la nature, de ses couleurs et du temps qui passe.
Ce qui étonne, à la vue de ces univers réduits, c’est la maîtrise technique au service de l’imitation. Le jardinier travaille à faire disparaître son intervention, à l’inverse de ce que l’on observe dans les jardins occidentaux où la taille et l’agencement sont souvent ostentatoires. En ce sens, le jardin asiatique parfait est celui qui réussit à devenir paysage. Il y a là une curiosité. Comment le jardin, qui naît de la main de l’homme, pourrait-il sembler naturel ? À bien y réfléchir, l’œuvre du jardinier japonais tient moins dans son habileté – quand bien même celle-ci reste déterminante – que dans sa capacité à observer la nature et à en synthétiser les éléments pour mieux la reproduire. Point de fantaisie : on retrouve dans le jardin japonais toute la rigueur d’une culture codifiée à l’extrême.
Que le paysage imite le jardin ou que le jardin tente de devenir paysage, une chose est sûre : grâce au regard, l’imaginaire nous transporte. Tous les sens s’aiguisent dans la direction voulue par l’auteur. Ne serait-ce pas d’ailleurs la grande affaire du jardinier, comme celle du peintre, que de donner à voir son œuvre pour faire voyager ? Contempler et partir. Contempler pour mieux partir, débarrassé du superficiel, et, au contact des végétaux, apprécier les textures, s’imprégner du vert, faire l’expérience du beau. En somme, faire naître d’un espace fini un imaginaire infini. »
(p. 30-33)
L’hirsute et le rigoureux (p. 36-40)
Temporalité du jardin (p. 82-85)
Extrait court


