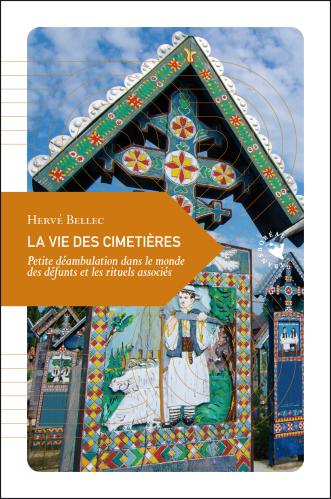
Taphophilie :
« En règle générale, le randonneur est taphophile. En premier lieu pour une raison bien pratique : on trouve un robinet dans la plupart des cimetières. Il arrive qu’on trouve également un ou deux bancs, que la modeste église paroissiale soit ouverte pour offrir une fraîcheur toujours bienvenue par temps caniculaire et s’il y a des toilettes, alors là, c’est Byzance ! Cheminant dans le sud de l’Angleterre en direction de la cathédrale de Canterbury, j’ai traversé de nombreux villages, et c’est d’abord l’église que je cherchais pour m’octroyer une pause et grignoter mon casse-croûte. J’avais de l’eau à disposition et même un coin d’herbe tendre pour délasser mes jambes fatiguées. Des stèles rustiques entouraient la vieille église à la façon d’une partie de dominos. Il m’est arrivé de m’adosser contre l’une d’elles et, à ma connaissance, la nommée Deborah Wright (1891-1967) ne s’en est pas offusquée. Je ne gênais personne sinon un couple de sansonnets disparaissant aussitôt dans les fourrés. Les chemins de grande randonnée évitent autant que faire se peut les villes et les axes principaux, ce qui nous permet de découvrir ces petites oasis. Le village au fond de la vallée, le cimetière au bout d’un hameau abandonné depuis des décennies. Ici reposent des êtres qu’on n’a jamais connus. On regarde les noms gravés sur la pierre, aux consonances exotiques. On imagine leur vie. Sans doute beaucoup sont nés dans ce village où ils sont morts, ont passé l’essentiel de leur existence dans un périmètre réduit. Ils ont grandi ici, sont allés à l’école communale, ont parcouru tous les sentiers et appris le nom des arbres et des oiseaux. Peut-être ont-ils aussi trouvé l’âme sœur qu’ils ont épousée dans l’église même où ils ont été baptisés puis ont-ils repris l’exploitation familiale, fait à leur tour des enfants, et le cycle immuable aurait pu continuer ainsi jusqu’à la nuit des temps. Mais la révolution industrielle a changé la donne et les Trente Glorieuses ont accéléré le processus. Les enfants du pays sont partis à la recherche d’un emploi vers les usines des villes qui avaient grand soif de main-d’œuvre. L’exode rural a dépeuplé les campagnes, en Angleterre comme en Bretagne, la grande famine a vidé l’Irlande, c’est ainsi qu’on trouve des cimetières quasiment abandonnés. Celui d’Inishowen, une presqu’île au nord du Donegal, m’avait frappé par sa solitude tragique. Il était situé au bord d’une falaise abrupte, loin du village, au cœur d’un paysage qui semblait tragique, lui aussi. D’antiques murets de pierres délimitaient d’anciens champs qui n’avaient plus lieu d’être puisque plus rien n’était cultivé. Le vent glacial qui s’infiltrait sous mes vêtements n’arrangeait rien. À l’extrémité, il y avait une chapelle toute blanche qui était close. J’errai à travers les tombes sur un sol détrempé. Je regardais les noms de famille. Les Doherty, les O’Conor, les Williams? des familles qui peut-être s’étaient installées là à l’époque où saint Patrick évangélisait l’île et étaient restées pour la simple et bonne raison qu’on ne pouvait pas aller plus loin, ou alors en Amérique, ce que beaucoup d’entre eux firent plus tard. Et ils moururent à leur tour et on les enterra dans le quartier irlandais des cimetières périphériques de Brooklyn ou de Chicago.
Quelques-unes arboraient la croix celtique. Il n’y avait pas d’allées ni d’ordre préétabli. Juste un gazon mal entretenu et même pas du tout entretenu, ce qui donnait au cimetière un aspect délaissé bien qu’il ne le fût point, en témoignaient ces récentes stèles. Mais plusieurs de ces défunts n’avaient pas reçu de visiteurs depuis des lustres. Les lourdes pierres s’enfonçaient dans le sol. J’avais froid et pourtant, je n’arrivais pas à me décider à rejoindre ma voiture. Je faisais des allers et retours entre la chapelle et la falaise, vertigineuse. L’endroit aurait pu s’appeler Wuthering Heights, les “Hauts de Hurlevent”. Ici, nulle quiétude. Tout semblait terriblement tourmenté, les collines comme l’océan, les pierres comme les rares arbres soumis à la violence des éléments. Il m’aurait été difficile de trouver ici le repos de mon âme et pourtant, le cimetière d’Inishowen est celui qui, au cours de toutes mes pérégrinations, m’a peut-être le plus ému. »
De plus en plus loin des reliques (p. 24-27)
Un Néandertalien en Corrèze (p. 32-36)
Extrait court
« En règle générale, le randonneur est taphophile. En premier lieu pour une raison bien pratique : on trouve un robinet dans la plupart des cimetières. Il arrive qu’on trouve également un ou deux bancs, que la modeste église paroissiale soit ouverte pour offrir une fraîcheur toujours bienvenue par temps caniculaire et s’il y a des toilettes, alors là, c’est Byzance ! Cheminant dans le sud de l’Angleterre en direction de la cathédrale de Canterbury, j’ai traversé de nombreux villages, et c’est d’abord l’église que je cherchais pour m’octroyer une pause et grignoter mon casse-croûte. J’avais de l’eau à disposition et même un coin d’herbe tendre pour délasser mes jambes fatiguées. Des stèles rustiques entouraient la vieille église à la façon d’une partie de dominos. Il m’est arrivé de m’adosser contre l’une d’elles et, à ma connaissance, la nommée Deborah Wright (1891-1967) ne s’en est pas offusquée. Je ne gênais personne sinon un couple de sansonnets disparaissant aussitôt dans les fourrés. Les chemins de grande randonnée évitent autant que faire se peut les villes et les axes principaux, ce qui nous permet de découvrir ces petites oasis. Le village au fond de la vallée, le cimetière au bout d’un hameau abandonné depuis des décennies. Ici reposent des êtres qu’on n’a jamais connus. On regarde les noms gravés sur la pierre, aux consonances exotiques. On imagine leur vie. Sans doute beaucoup sont nés dans ce village où ils sont morts, ont passé l’essentiel de leur existence dans un périmètre réduit. Ils ont grandi ici, sont allés à l’école communale, ont parcouru tous les sentiers et appris le nom des arbres et des oiseaux. Peut-être ont-ils aussi trouvé l’âme sœur qu’ils ont épousée dans l’église même où ils ont été baptisés puis ont-ils repris l’exploitation familiale, fait à leur tour des enfants, et le cycle immuable aurait pu continuer ainsi jusqu’à la nuit des temps. Mais la révolution industrielle a changé la donne et les Trente Glorieuses ont accéléré le processus. Les enfants du pays sont partis à la recherche d’un emploi vers les usines des villes qui avaient grand soif de main-d’œuvre. L’exode rural a dépeuplé les campagnes, en Angleterre comme en Bretagne, la grande famine a vidé l’Irlande, c’est ainsi qu’on trouve des cimetières quasiment abandonnés. Celui d’Inishowen, une presqu’île au nord du Donegal, m’avait frappé par sa solitude tragique. Il était situé au bord d’une falaise abrupte, loin du village, au cœur d’un paysage qui semblait tragique, lui aussi. D’antiques murets de pierres délimitaient d’anciens champs qui n’avaient plus lieu d’être puisque plus rien n’était cultivé. Le vent glacial qui s’infiltrait sous mes vêtements n’arrangeait rien. À l’extrémité, il y avait une chapelle toute blanche qui était close. J’errai à travers les tombes sur un sol détrempé. Je regardais les noms de famille. Les Doherty, les O’Conor, les Williams? des familles qui peut-être s’étaient installées là à l’époque où saint Patrick évangélisait l’île et étaient restées pour la simple et bonne raison qu’on ne pouvait pas aller plus loin, ou alors en Amérique, ce que beaucoup d’entre eux firent plus tard. Et ils moururent à leur tour et on les enterra dans le quartier irlandais des cimetières périphériques de Brooklyn ou de Chicago.
Quelques-unes arboraient la croix celtique. Il n’y avait pas d’allées ni d’ordre préétabli. Juste un gazon mal entretenu et même pas du tout entretenu, ce qui donnait au cimetière un aspect délaissé bien qu’il ne le fût point, en témoignaient ces récentes stèles. Mais plusieurs de ces défunts n’avaient pas reçu de visiteurs depuis des lustres. Les lourdes pierres s’enfonçaient dans le sol. J’avais froid et pourtant, je n’arrivais pas à me décider à rejoindre ma voiture. Je faisais des allers et retours entre la chapelle et la falaise, vertigineuse. L’endroit aurait pu s’appeler Wuthering Heights, les “Hauts de Hurlevent”. Ici, nulle quiétude. Tout semblait terriblement tourmenté, les collines comme l’océan, les pierres comme les rares arbres soumis à la violence des éléments. Il m’aurait été difficile de trouver ici le repos de mon âme et pourtant, le cimetière d’Inishowen est celui qui, au cours de toutes mes pérégrinations, m’a peut-être le plus ému. »
(p. 62-66)
De plus en plus loin des reliques (p. 24-27)
Un Néandertalien en Corrèze (p. 32-36)
Extrait court


