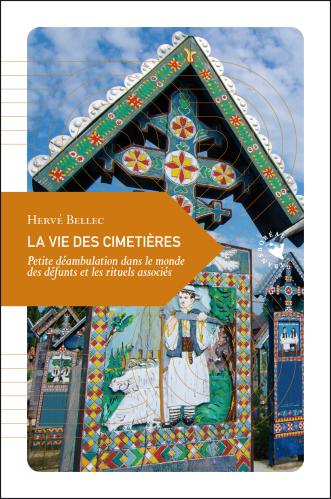
Un Néandertalien en Corrèze :
« Bien sûr, il ne sera pas question dans ce voyage funéraire de prêcher uniquement pour ma paroisse. Des cimetières, on en trouve partout à travers le monde, ses cinq continents et même ses océans. On considère que depuis l’apparition de l’Homo sapiens sur la terre, 80 milliards d’êtres humains y ont fait un séjour plus ou moins long, et tous ces braves gens, il a bien fallu les caser quelque part. Les premières traces d’inhumation ont été découvertes au Proche-Orient, notamment en Jordanie. Elles dateraient de plus de 100 000 ans. La plus ancienne sépulture découverte en France est celle d’un Néandertalien inhumé dans l’actuel département de la Corrèze il y a 60 000 ans. Neanderthalensis et Sapiens ont su protéger des charognards les dépouilles de leurs semblables sous des amas de terre et de cailloux, mais il faut attendre les sédentarisations du néolithique (9000 av. J.-C.) pour qu’apparaissent les premières nécropoles (du grec ancien nekropolis, “cité des morts”). On abandonne le nomadisme, la chasse et la cueillette, on sème du blé, on élève des chèvres, on apprivoise les chiens, on crée des villages, des clôtures, des temples, on se regroupe en tribus, on invente le troc et donc le commerce, on se choisit des chefs? et les emmerdements commencent. L’inhumation devient la règle, du moins en Europe, alors que la crémation s’impose en Asie. L’hommage aux défunts s’exprime sous différentes formes. Sur l’île de Téviec, dans le Morbihan, on a mis au jour dix sépultures regroupant 23 individus, certains ayant été visiblement massacrés. Les corps étaient enduits d’ocre rouge et parés de colliers de coquillages. Des bois de cerf encadraient les dépouilles. Ceci se passait 5 400 ans avant notre ère.
En Égypte, pays que je n’ai jamais visité sinon par le biais de mes lectures, le site de la nécropole de Gizeh où se trouvent les trois grandes pyramides abrite 9 000 corps répartis en six cimetières. Bien avant l’édification de ces pyramides, la construction du grand cairn de Barnenez, “le Parthénon des Bretons” selon André Malraux, dominant l’admirable baie de Morlaix, date de 4700 avant notre ère. C’est aussi un mausolée parmi les plus imposants d’Europe. Qui étaient ces chefs qui méritaient une telle sépulture ? Napoléon aux Invalides, Lénine sur la place Rouge, Tamerlan à Samarcande et tant d’autres ont eu droit aux mêmes honneurs. De tels exemples, on pourrait en citer des centaines de par le monde, sans doute des milliers, depuis que les grandes civilisations ont commencé à se développer, à s’épanouir et à se chamailler. L’hommage aux illustres disparus a servi également de prétexte pour les architectes et les artisans qui s’en sont donnés à cœur joie pour exprimer toute la plénitude de leur art. La cité de Samarcande, en Ouzbékistan, se trouve à la croisée des routes de la Soie. Sur les pans de la colline d’Afrosyab, l’ancienne forteresse d’Alexandre le Grand, se dresse le site de Shah-i-Zinda, un ensemble absolument remarquable de mausolées et de mosquées d’une richesse inouïe. Les plus anciens édifices, qui abriteraient les dépouilles des épouses de Tamerlan, datent du XIe siècle, les plus récents du XVIe. Chaque détail est minutieusement travaillé, chaque pièce de céramique est un trésor, une invention. C’est magnifique. Du temps de l’occupation soviétique, le pouvoir central en avait fait un “musée de l’athéisme”, mais depuis l’indépendance le site a repris ses droits et sa fonction, et les pèlerins ne cessent d’y affluer. Plus haut sur la colline, se trouvent le cimetière public et les lourdes tombes des familles russes où sont gravés sur le granit poli des portraits tantôt solennels, tantôt souriants. Le plus récent mausolée (2018), construit sur les hauteurs auprès de la mosquée des Voyageurs, est celui d’Islam Karimov. Un édifice bien coquet pour l’ancien dictateur. »
De plus en plus loin des reliques (p. 24-27)
Taphophilie (p. 62-66)
Extrait court
« Bien sûr, il ne sera pas question dans ce voyage funéraire de prêcher uniquement pour ma paroisse. Des cimetières, on en trouve partout à travers le monde, ses cinq continents et même ses océans. On considère que depuis l’apparition de l’Homo sapiens sur la terre, 80 milliards d’êtres humains y ont fait un séjour plus ou moins long, et tous ces braves gens, il a bien fallu les caser quelque part. Les premières traces d’inhumation ont été découvertes au Proche-Orient, notamment en Jordanie. Elles dateraient de plus de 100 000 ans. La plus ancienne sépulture découverte en France est celle d’un Néandertalien inhumé dans l’actuel département de la Corrèze il y a 60 000 ans. Neanderthalensis et Sapiens ont su protéger des charognards les dépouilles de leurs semblables sous des amas de terre et de cailloux, mais il faut attendre les sédentarisations du néolithique (9000 av. J.-C.) pour qu’apparaissent les premières nécropoles (du grec ancien nekropolis, “cité des morts”). On abandonne le nomadisme, la chasse et la cueillette, on sème du blé, on élève des chèvres, on apprivoise les chiens, on crée des villages, des clôtures, des temples, on se regroupe en tribus, on invente le troc et donc le commerce, on se choisit des chefs? et les emmerdements commencent. L’inhumation devient la règle, du moins en Europe, alors que la crémation s’impose en Asie. L’hommage aux défunts s’exprime sous différentes formes. Sur l’île de Téviec, dans le Morbihan, on a mis au jour dix sépultures regroupant 23 individus, certains ayant été visiblement massacrés. Les corps étaient enduits d’ocre rouge et parés de colliers de coquillages. Des bois de cerf encadraient les dépouilles. Ceci se passait 5 400 ans avant notre ère.
En Égypte, pays que je n’ai jamais visité sinon par le biais de mes lectures, le site de la nécropole de Gizeh où se trouvent les trois grandes pyramides abrite 9 000 corps répartis en six cimetières. Bien avant l’édification de ces pyramides, la construction du grand cairn de Barnenez, “le Parthénon des Bretons” selon André Malraux, dominant l’admirable baie de Morlaix, date de 4700 avant notre ère. C’est aussi un mausolée parmi les plus imposants d’Europe. Qui étaient ces chefs qui méritaient une telle sépulture ? Napoléon aux Invalides, Lénine sur la place Rouge, Tamerlan à Samarcande et tant d’autres ont eu droit aux mêmes honneurs. De tels exemples, on pourrait en citer des centaines de par le monde, sans doute des milliers, depuis que les grandes civilisations ont commencé à se développer, à s’épanouir et à se chamailler. L’hommage aux illustres disparus a servi également de prétexte pour les architectes et les artisans qui s’en sont donnés à cœur joie pour exprimer toute la plénitude de leur art. La cité de Samarcande, en Ouzbékistan, se trouve à la croisée des routes de la Soie. Sur les pans de la colline d’Afrosyab, l’ancienne forteresse d’Alexandre le Grand, se dresse le site de Shah-i-Zinda, un ensemble absolument remarquable de mausolées et de mosquées d’une richesse inouïe. Les plus anciens édifices, qui abriteraient les dépouilles des épouses de Tamerlan, datent du XIe siècle, les plus récents du XVIe. Chaque détail est minutieusement travaillé, chaque pièce de céramique est un trésor, une invention. C’est magnifique. Du temps de l’occupation soviétique, le pouvoir central en avait fait un “musée de l’athéisme”, mais depuis l’indépendance le site a repris ses droits et sa fonction, et les pèlerins ne cessent d’y affluer. Plus haut sur la colline, se trouvent le cimetière public et les lourdes tombes des familles russes où sont gravés sur le granit poli des portraits tantôt solennels, tantôt souriants. Le plus récent mausolée (2018), construit sur les hauteurs auprès de la mosquée des Voyageurs, est celui d’Islam Karimov. Un édifice bien coquet pour l’ancien dictateur. »
(p. 32-36)
De plus en plus loin des reliques (p. 24-27)
Taphophilie (p. 62-66)
Extrait court


