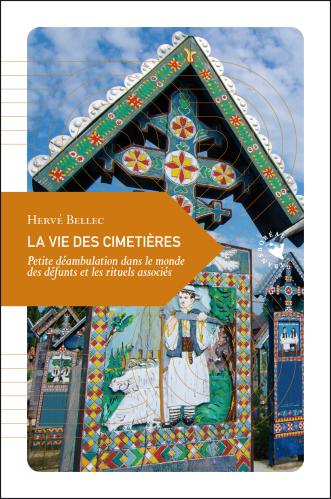
De plus en plus loin des reliques :
« Depuis 1776, et pour d’évidentes raisons sanitaires, un édit royal interdisait les inhumations à l’intérieur des églises et préconisait la création de nouveaux cimetières hors les murs. La fonctionnalité a peu à peu pris le pas sur la religiosité. Jadis, le cimetière jouxtait l’église mais, la population ne cessant d’augmenter, le nombre de sépultures aussi, il fallut se résoudre à déménager. Bien auparavant, je parle des temps médiévaux, mais on a constaté ce phénomène dans certaines régions jusqu’au XVIIe siècle, les morts étaient enterrés au sein même des églises. Il s’agissait de se faire inhumer le plus près possible du saint tabernacle et des reliques du maître-autel. Bien entendu, nobles et clercs, et même certains bourgeois contre espèces sonnantes et trébuchantes, s’appropriaient les meilleures places du chœur ou de la nef et reposaient sous de larges dalles de schiste, de telle sorte qu’en allant communier on passait sur le corps de madame la marquise de Poulpiquet ou celui du vicaire général Queffurus. C’est encore le cas pour les personnalités royales. Les autres, ceux de la plèbe, se contentaient des allées latérales, à l’ombre des lourds piliers. Une piètre couche de terre recouvrait leur dépouille. On aura compris que, dans une telle promiscuité, les microbes se propageaient comme dans un bouillon de culture, ouvrant un boulevard à la prochaine épidémie qui décimait des populations déjà affaiblies par la sous-alimentation. Ce n’est qu’à la charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance qu’on se décida à prendre des mesures autoritaires même si, pour les gens de l’époque, enterrer un chrétien hors les murs était sacrilège. C’est la victoire des autorités sanitaires sur cette mentalité ancestrale qui finalement annonça la notion de périmètre sacré, ceint par une couronne de pierres, autour de l’église. L’enclos devint la nouvelle résidence des morts. Ces enclos paroissiaux représentaient un sas entre les deux mondes, étrangers mais terriblement intimes. Les morts habitaient au milieu de la communauté, et à chaque jour suffisaient sa peine et ses angoisses. Pour se rendre à l’église, il fallait d’abord passer entre les tombes et s’incliner au pied du grand calvaire. Une femme relevant de couches se devait d’ailleurs de passer au-delà de l’échalier, le muret de pierres délimitant le monde sacré du profane, afin de se confesser avant de pouvoir retrouver sa place dans la communauté. Ainsi vivaient nos ancêtres, “farouchement intimes avec la mort”, comme le rappelait Anatole Le Braz, l’auteur de La Légende de la mort.
Dans ces enclos, on érigea des ossuaires pour entreposer les ossements des ancêtres, les “reliques”. Comme pour nous ôter toute illusion, une tête de mort ornait le linteau de la porte d’entrée. En Bretagne, je connais trois ossuaires où subsistent encore ces ossements à la vue de tous bien que protégés derrière de solides barreaux de granit. Les os sont rangés par catégories. Les crânes sont savamment empilés sur un tas de fémurs et de tibias, rangés comme des stères de bois. Au sol gisent quelques fragments épars d’omoplates ou de vertèbres. Une légère couche verdâtre s’est incrustée au sommet des têtes. C’est certes un peu morbide, glauque, dirait-on aujourd’hui. Les orbites semblent encore nous regarder droit dans les yeux, grimaçantes, mais les enfants du village qui passaient devant pour se rendre à l’école n’étaient, me semble-t-il, pas pour autant traumatisés à vie. Au moins, ils pouvaient déjà se faire une idée assez précise de ce qui les attendait. Il y a une vingtaine d’années, deux jeunes férus de black metal avaient réussi à dérober “six crânes et trois fémurs”, ce qui aurait été très chic pour décorer leur chambre et épater leurs petites amies. Trahis par la plaque de leur voiture, ils furent vite arrêtés et condamnés à je ne sais plus quelle peine pour “atteinte à l’intégrité de cadavres”. On ne badine pas plus avec Dame la Mort qu’avec Dame la République. »
Un Néandertalien en Corrèze (p. 32-36)
Taphophilie (p. 62-66)
Extrait court
« Depuis 1776, et pour d’évidentes raisons sanitaires, un édit royal interdisait les inhumations à l’intérieur des églises et préconisait la création de nouveaux cimetières hors les murs. La fonctionnalité a peu à peu pris le pas sur la religiosité. Jadis, le cimetière jouxtait l’église mais, la population ne cessant d’augmenter, le nombre de sépultures aussi, il fallut se résoudre à déménager. Bien auparavant, je parle des temps médiévaux, mais on a constaté ce phénomène dans certaines régions jusqu’au XVIIe siècle, les morts étaient enterrés au sein même des églises. Il s’agissait de se faire inhumer le plus près possible du saint tabernacle et des reliques du maître-autel. Bien entendu, nobles et clercs, et même certains bourgeois contre espèces sonnantes et trébuchantes, s’appropriaient les meilleures places du chœur ou de la nef et reposaient sous de larges dalles de schiste, de telle sorte qu’en allant communier on passait sur le corps de madame la marquise de Poulpiquet ou celui du vicaire général Queffurus. C’est encore le cas pour les personnalités royales. Les autres, ceux de la plèbe, se contentaient des allées latérales, à l’ombre des lourds piliers. Une piètre couche de terre recouvrait leur dépouille. On aura compris que, dans une telle promiscuité, les microbes se propageaient comme dans un bouillon de culture, ouvrant un boulevard à la prochaine épidémie qui décimait des populations déjà affaiblies par la sous-alimentation. Ce n’est qu’à la charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance qu’on se décida à prendre des mesures autoritaires même si, pour les gens de l’époque, enterrer un chrétien hors les murs était sacrilège. C’est la victoire des autorités sanitaires sur cette mentalité ancestrale qui finalement annonça la notion de périmètre sacré, ceint par une couronne de pierres, autour de l’église. L’enclos devint la nouvelle résidence des morts. Ces enclos paroissiaux représentaient un sas entre les deux mondes, étrangers mais terriblement intimes. Les morts habitaient au milieu de la communauté, et à chaque jour suffisaient sa peine et ses angoisses. Pour se rendre à l’église, il fallait d’abord passer entre les tombes et s’incliner au pied du grand calvaire. Une femme relevant de couches se devait d’ailleurs de passer au-delà de l’échalier, le muret de pierres délimitant le monde sacré du profane, afin de se confesser avant de pouvoir retrouver sa place dans la communauté. Ainsi vivaient nos ancêtres, “farouchement intimes avec la mort”, comme le rappelait Anatole Le Braz, l’auteur de La Légende de la mort.
Dans ces enclos, on érigea des ossuaires pour entreposer les ossements des ancêtres, les “reliques”. Comme pour nous ôter toute illusion, une tête de mort ornait le linteau de la porte d’entrée. En Bretagne, je connais trois ossuaires où subsistent encore ces ossements à la vue de tous bien que protégés derrière de solides barreaux de granit. Les os sont rangés par catégories. Les crânes sont savamment empilés sur un tas de fémurs et de tibias, rangés comme des stères de bois. Au sol gisent quelques fragments épars d’omoplates ou de vertèbres. Une légère couche verdâtre s’est incrustée au sommet des têtes. C’est certes un peu morbide, glauque, dirait-on aujourd’hui. Les orbites semblent encore nous regarder droit dans les yeux, grimaçantes, mais les enfants du village qui passaient devant pour se rendre à l’école n’étaient, me semble-t-il, pas pour autant traumatisés à vie. Au moins, ils pouvaient déjà se faire une idée assez précise de ce qui les attendait. Il y a une vingtaine d’années, deux jeunes férus de black metal avaient réussi à dérober “six crânes et trois fémurs”, ce qui aurait été très chic pour décorer leur chambre et épater leurs petites amies. Trahis par la plaque de leur voiture, ils furent vite arrêtés et condamnés à je ne sais plus quelle peine pour “atteinte à l’intégrité de cadavres”. On ne badine pas plus avec Dame la Mort qu’avec Dame la République. »
(p. 24-27)
Un Néandertalien en Corrèze (p. 32-36)
Taphophilie (p. 62-66)
Extrait court


