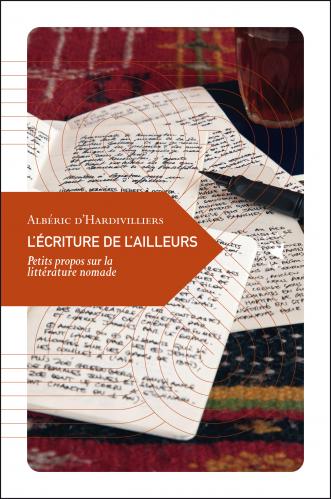
Le monde pour théâtre :
« L’anecdote de voyage ennuie souvent et le voyageur lui-même en la racontant sent parfois qu’elle s’est comme vidée de sa substance : il sait qu’il ne dit pas tout, qu’il n’arrive pas à “faire sentir” et conclut en s’excusant que “c’était mieux en vrai”. C’est qu’il dépasse rarement la description pure, il aligne les faits et ne retrouve pas ce qui sur place semblait si bien les relier entre eux. Dans le souci de ne pas ennuyer, il s’efforce d’enlever les moments creux et oublie le petit détail qui lui avait paru touchant et qui, devant les autres, devient ridicule ; il s’arrête aux moments forts mais ne pose pas de contexte, sa pièce est sans décor. Il ne s’agit évidemment pas ici de décor décoratif, de petits bouts de carton peints pour faire illusion. Le théâtre contemporain nous a plus d’une fois prouvé qu’un simple tapis déposé sur le plateau pouvait faire apparaître aux yeux du spectateur la lande de Macbeth ou celle du Roi Lear. La différence n’est pas énorme, tout bien réfléchi, entre l’anecdote à raconter et le récit de voyage : certains, malgré la suite d’exploits alignés de page en page, ne marchent pas, l’illusion théâtrale n’agit pas.
Dans une pièce où l’on imaginerait deux hommes se battre, le fait qu’une porte soit fermée ou ouverte allonge la liste des possibles, cet élément du décor permet la fuite. En évoquant un ciel sombre et chargé, le voyageur fait planer sur son anecdote la menace permanente d’un orage qui vient donner à son histoire une nouvelle épaisseur dramatique. Mais aurait-il spontanément pensé à cet insignifiant détail météorologique qui pourtant, sur le moment, sans qu’il s’en rendît vraiment compte, était venu pour lui donner le ton, créer l’atmosphère ? Avec le temps, la mémoire agglomère tous ces détails, elle les condense, rend les souvenirs confus et comme perméables les uns aux autres. Il n’est pas rare alors que l’on aille chercher en Inde ce qui manquait pour bien parler de l’Égypte. Mais peut-être aussi certains détails trouvent-ils entre eux une parenté plus discrète. Il s’agit alors moins d’une défaillance de la mémoire que de similitudes autrement parlantes.
J’avais en me promenant un jour à Brooklyn l’impression tenace d’être dans une des rues du sud de Londres, à Tulse Hill, où j’avais habité deux ans plus tôt. Au-delà de l’anglais que j’entendais autour de moi, rien, apparemment, ne venait relier entre eux ces deux décors. Je m’attendais à chaque instant à arriver au pied de mon appartement et je crois même avoir machinalement cherché les clés dans ma poche. Plus tard, en passant devant une arrière-cour, je remarquai que, dans ce quartier de Brooklyn comme à Londres, les fenêtres et les tuyauteries extérieures étaient peintes en noir. Sur les briques rouge sombre des maisons, elles dessinaient un motif auquel je n’avais jamais prêté la moindre attention et qui me replongea, pour quelques mètres seulement, au cœur de Londres et d’une époque que je croyais oubliée.
La mémoire, qui offre des raccourcis surprenants, a en cela beaucoup à voir avec la secondarité propre au processus d’écriture ; elle “est la condition de la poésie [et] le révolu [est] sa substance”, dit Cioran. Cette forme de digestion est le temps où l’écrivain extrait de son passé ce qu’il y a en lui de plus profond et de plus narratif. C’est un temps qui lui est donné pour laisser décanter ses souvenirs. Ce filtrage que l’écriture opère sur la mémoire tend tout autant à redonner à chaque particule sa juste place qu’à obtenir un condensé, un extrait qui, comme un concentré de musc ou de lilas, aura le pouvoir de faire ressentir au lecteur ce que l’écrivain a perçu. »
Au Yémen, avec Malraux et la reine de Saba (p. 15-19)
Une lecture en route pour Kashgar (p. 45-49)
Extrait court
« L’anecdote de voyage ennuie souvent et le voyageur lui-même en la racontant sent parfois qu’elle s’est comme vidée de sa substance : il sait qu’il ne dit pas tout, qu’il n’arrive pas à “faire sentir” et conclut en s’excusant que “c’était mieux en vrai”. C’est qu’il dépasse rarement la description pure, il aligne les faits et ne retrouve pas ce qui sur place semblait si bien les relier entre eux. Dans le souci de ne pas ennuyer, il s’efforce d’enlever les moments creux et oublie le petit détail qui lui avait paru touchant et qui, devant les autres, devient ridicule ; il s’arrête aux moments forts mais ne pose pas de contexte, sa pièce est sans décor. Il ne s’agit évidemment pas ici de décor décoratif, de petits bouts de carton peints pour faire illusion. Le théâtre contemporain nous a plus d’une fois prouvé qu’un simple tapis déposé sur le plateau pouvait faire apparaître aux yeux du spectateur la lande de Macbeth ou celle du Roi Lear. La différence n’est pas énorme, tout bien réfléchi, entre l’anecdote à raconter et le récit de voyage : certains, malgré la suite d’exploits alignés de page en page, ne marchent pas, l’illusion théâtrale n’agit pas.
Dans une pièce où l’on imaginerait deux hommes se battre, le fait qu’une porte soit fermée ou ouverte allonge la liste des possibles, cet élément du décor permet la fuite. En évoquant un ciel sombre et chargé, le voyageur fait planer sur son anecdote la menace permanente d’un orage qui vient donner à son histoire une nouvelle épaisseur dramatique. Mais aurait-il spontanément pensé à cet insignifiant détail météorologique qui pourtant, sur le moment, sans qu’il s’en rendît vraiment compte, était venu pour lui donner le ton, créer l’atmosphère ? Avec le temps, la mémoire agglomère tous ces détails, elle les condense, rend les souvenirs confus et comme perméables les uns aux autres. Il n’est pas rare alors que l’on aille chercher en Inde ce qui manquait pour bien parler de l’Égypte. Mais peut-être aussi certains détails trouvent-ils entre eux une parenté plus discrète. Il s’agit alors moins d’une défaillance de la mémoire que de similitudes autrement parlantes.
J’avais en me promenant un jour à Brooklyn l’impression tenace d’être dans une des rues du sud de Londres, à Tulse Hill, où j’avais habité deux ans plus tôt. Au-delà de l’anglais que j’entendais autour de moi, rien, apparemment, ne venait relier entre eux ces deux décors. Je m’attendais à chaque instant à arriver au pied de mon appartement et je crois même avoir machinalement cherché les clés dans ma poche. Plus tard, en passant devant une arrière-cour, je remarquai que, dans ce quartier de Brooklyn comme à Londres, les fenêtres et les tuyauteries extérieures étaient peintes en noir. Sur les briques rouge sombre des maisons, elles dessinaient un motif auquel je n’avais jamais prêté la moindre attention et qui me replongea, pour quelques mètres seulement, au cœur de Londres et d’une époque que je croyais oubliée.
La mémoire, qui offre des raccourcis surprenants, a en cela beaucoup à voir avec la secondarité propre au processus d’écriture ; elle “est la condition de la poésie [et] le révolu [est] sa substance”, dit Cioran. Cette forme de digestion est le temps où l’écrivain extrait de son passé ce qu’il y a en lui de plus profond et de plus narratif. C’est un temps qui lui est donné pour laisser décanter ses souvenirs. Ce filtrage que l’écriture opère sur la mémoire tend tout autant à redonner à chaque particule sa juste place qu’à obtenir un condensé, un extrait qui, comme un concentré de musc ou de lilas, aura le pouvoir de faire ressentir au lecteur ce que l’écrivain a perçu. »
(p. 60-63)
Au Yémen, avec Malraux et la reine de Saba (p. 15-19)
Une lecture en route pour Kashgar (p. 45-49)
Extrait court


