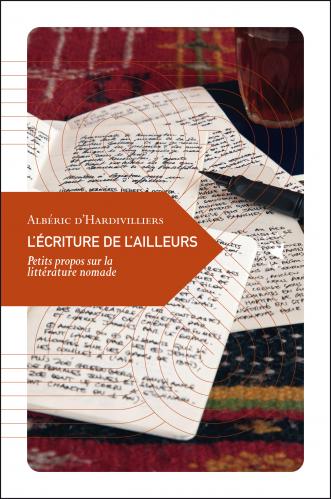
Une lecture en route pour Kashgar :
« On dit souvent que l’on écrit sur les livres des autres, couche sur couche, strate sur strate ; sans doute les voyages ne fonctionnent-ils pas autrement : ils se superposent les uns aux autres pour créer une tourbe compacte et riche. C’est à cette stratification de la perception que l’écriture doit se rendre disponible pour lui redonner toute sa profondeur et éviter ainsi de ne rester qu’à la surface cultivable des choses – stratification que les livres lus eux-mêmes, en dessinant dans l’esprit du voyageur l’image qu’il se fait de son propre voyage, contribuent à définir.
Le livre que l’on emporte avec soi sur la route est un excellent compagnon pour peu qu’on l’ait choisi avec attention. Les Trois Mousquetaires, par exemple, détonnait légèrement dans les montagnes de Kirghizie où je l’ai lu alors que certaines incongruités apparentes, au contraire, ne manquent pas de créer d’intéressantes passerelles : Le Manifeste du surréalisme de Breton, si friand d’apparitions et de fantômes, convenait plutôt bien, finalement, à la lande shakespearienne des Highlands.
Comme j’arrivais à Saint-Raphaël après avoir descendu la Nationale 7, l’apparition brutale de la mer dans le cadre du pare-brise me fit penser à un livre de Morand, Méditerranée, mer des surprises. Je pensais aussi, dans le même mouvement, à Tendre est la nuit de Fitzgerald où un jeune couple d’Américains se défait sur fond de Provence et de sable chaud. Ces deux livres, malgré Kerouac que je lisais alors, ont définitivement teinté l’image que j’ai maintenant de cette partie de la France, de leur esthétique années folles et d’une certaine nostalgie à l’alcoolémie grimpante.
Il arrive aussi parfois qu’au cœur même du voyage la lecture vienne recréer un espace familier et dessiner autour de nous un environnement qui repose des aléas de la route. La musicalité d’une langue connue, l’onomastique rendue subitement proche par l’éloignement, transforment certains livres en lieux de reconnaissance, en ambassades françaises où se détendre après un long voyage. Le Berry de George Sand qu’on n’aurait considéré chez soi qu’avec une attention pour le moins distraite revêt les couleurs d’une France traversée en plein été, dans la chaleur brûlante d’août, pour rejoindre un lieu de vacances, et même les longs développements de Victor Hugo ne deviennent plus si difficiles à lire car ils rappellent à notre mémoire les images des livres d’histoire de notre enfance, la frise chronologique qui courait au-dessus du tableau noir.
Dans le train de nuit qui me conduisait de l’oasis de Turfan à Kashgar par le désert du Xinjiang, un livre dont j’ai oublié le titre creusa ainsi une parenthèse réconfortante dans le temps. La nuit tombait depuis plusieurs heures déjà, enlevant minute après minute au paysage ses couleurs et son relief jusqu’à ne plus laisser qu’un gris-bleu opaque que seules venaient éclairer les lumières des cabanes d’ouvriers. Les montagnes au loin formaient une ligne continue le long de laquelle les voies s’appuyaient et je les regardais disparaître entre deux wagons. J’avais les jambes flasques, la poitrine chaude, quelque chose d’épais dans la bouche et les cheveux lourds. Neuf semaines de voyage s’abattaient sur moi. Dans mon compartiment, une famille ouïghoure dînait, sur une feuille de journal, de concombres et de tomates. Les parents parlaient à leurs enfants avec cette voix calme et chaude qui atténue la peur du noir. Peu à peu, un silence agréable se fit, derrière lequel je n’entendis plus que les doigts du petit garçon qui se posaient sur le carreau à chaque point jaune que les lampadaires le long des voies laissaient sur la vitre.
J’allumai ma veilleuse et commençai à lire. À cette heure de la nuit, le rythme lent et monotone du train ramenait l’espace du wagon aux dimensions d’une chambre à coucher et, bientôt, le livre que je tenais entre les mains vint reprendre le caractère confortable et presque sacré que conserve pour moi depuis l’enfance tout livre de chevet. À ces simples mots, le décor de ce train chinois disparut avec le surgissement soudain que fit au milieu du désert ce petit bout d’enfance : pour un instant, je pus me reposer enfin, m’alléger d’un poids mal identifié et qui sans doute n’était que la peur du soir ou l’appel du retour. Au réveil, je me levai avec ce vers de René Char dont je ne me souvenais pourtant pas d’avoir rêvé : “Il n’y a de pays que l’enfance.” Il faisait chaud, déjà lourd, et bientôt les montagnes disparurent pour ne laisser qu’une grande plaine où poussaient çà et là quelques arbres de plus en plus nombreux. On arriverait vers midi. »
Au Yémen, avec Malraux et la reine de Saba (p. 15-19)
Le monde pour théâtre (p. 60-63)
Extrait court
« On dit souvent que l’on écrit sur les livres des autres, couche sur couche, strate sur strate ; sans doute les voyages ne fonctionnent-ils pas autrement : ils se superposent les uns aux autres pour créer une tourbe compacte et riche. C’est à cette stratification de la perception que l’écriture doit se rendre disponible pour lui redonner toute sa profondeur et éviter ainsi de ne rester qu’à la surface cultivable des choses – stratification que les livres lus eux-mêmes, en dessinant dans l’esprit du voyageur l’image qu’il se fait de son propre voyage, contribuent à définir.
Le livre que l’on emporte avec soi sur la route est un excellent compagnon pour peu qu’on l’ait choisi avec attention. Les Trois Mousquetaires, par exemple, détonnait légèrement dans les montagnes de Kirghizie où je l’ai lu alors que certaines incongruités apparentes, au contraire, ne manquent pas de créer d’intéressantes passerelles : Le Manifeste du surréalisme de Breton, si friand d’apparitions et de fantômes, convenait plutôt bien, finalement, à la lande shakespearienne des Highlands.
Comme j’arrivais à Saint-Raphaël après avoir descendu la Nationale 7, l’apparition brutale de la mer dans le cadre du pare-brise me fit penser à un livre de Morand, Méditerranée, mer des surprises. Je pensais aussi, dans le même mouvement, à Tendre est la nuit de Fitzgerald où un jeune couple d’Américains se défait sur fond de Provence et de sable chaud. Ces deux livres, malgré Kerouac que je lisais alors, ont définitivement teinté l’image que j’ai maintenant de cette partie de la France, de leur esthétique années folles et d’une certaine nostalgie à l’alcoolémie grimpante.
Il arrive aussi parfois qu’au cœur même du voyage la lecture vienne recréer un espace familier et dessiner autour de nous un environnement qui repose des aléas de la route. La musicalité d’une langue connue, l’onomastique rendue subitement proche par l’éloignement, transforment certains livres en lieux de reconnaissance, en ambassades françaises où se détendre après un long voyage. Le Berry de George Sand qu’on n’aurait considéré chez soi qu’avec une attention pour le moins distraite revêt les couleurs d’une France traversée en plein été, dans la chaleur brûlante d’août, pour rejoindre un lieu de vacances, et même les longs développements de Victor Hugo ne deviennent plus si difficiles à lire car ils rappellent à notre mémoire les images des livres d’histoire de notre enfance, la frise chronologique qui courait au-dessus du tableau noir.
Dans le train de nuit qui me conduisait de l’oasis de Turfan à Kashgar par le désert du Xinjiang, un livre dont j’ai oublié le titre creusa ainsi une parenthèse réconfortante dans le temps. La nuit tombait depuis plusieurs heures déjà, enlevant minute après minute au paysage ses couleurs et son relief jusqu’à ne plus laisser qu’un gris-bleu opaque que seules venaient éclairer les lumières des cabanes d’ouvriers. Les montagnes au loin formaient une ligne continue le long de laquelle les voies s’appuyaient et je les regardais disparaître entre deux wagons. J’avais les jambes flasques, la poitrine chaude, quelque chose d’épais dans la bouche et les cheveux lourds. Neuf semaines de voyage s’abattaient sur moi. Dans mon compartiment, une famille ouïghoure dînait, sur une feuille de journal, de concombres et de tomates. Les parents parlaient à leurs enfants avec cette voix calme et chaude qui atténue la peur du noir. Peu à peu, un silence agréable se fit, derrière lequel je n’entendis plus que les doigts du petit garçon qui se posaient sur le carreau à chaque point jaune que les lampadaires le long des voies laissaient sur la vitre.
J’allumai ma veilleuse et commençai à lire. À cette heure de la nuit, le rythme lent et monotone du train ramenait l’espace du wagon aux dimensions d’une chambre à coucher et, bientôt, le livre que je tenais entre les mains vint reprendre le caractère confortable et presque sacré que conserve pour moi depuis l’enfance tout livre de chevet. À ces simples mots, le décor de ce train chinois disparut avec le surgissement soudain que fit au milieu du désert ce petit bout d’enfance : pour un instant, je pus me reposer enfin, m’alléger d’un poids mal identifié et qui sans doute n’était que la peur du soir ou l’appel du retour. Au réveil, je me levai avec ce vers de René Char dont je ne me souvenais pourtant pas d’avoir rêvé : “Il n’y a de pays que l’enfance.” Il faisait chaud, déjà lourd, et bientôt les montagnes disparurent pour ne laisser qu’une grande plaine où poussaient çà et là quelques arbres de plus en plus nombreux. On arriverait vers midi. »
(p. 45-49)
Au Yémen, avec Malraux et la reine de Saba (p. 15-19)
Le monde pour théâtre (p. 60-63)
Extrait court


