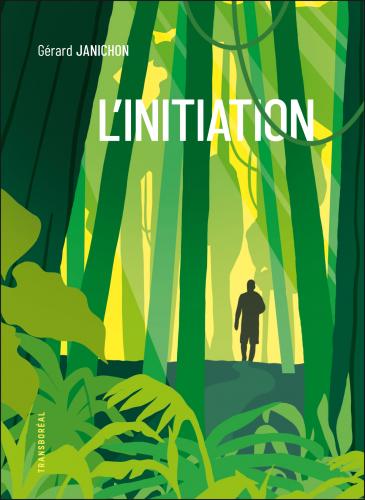
Initiation (L’)
Gérard Janichon
Gérard Janichon est connu pour le récit du fameux périple du voilier Damien réalisé en compagnie de Jérôme Poncet. Parvenus sur le fleuve Amazone, ils risquent leur petit cotre dans le légendaire Enfer vert. Fascinés par l’exubérance végétale, où peut se dissimuler la folie ou même la mort, ils rencontrent le plus surprenant des passeurs : Atalaya. Le vieux métis perçoit l’âme de la selva et conduit ses hôtes au cœur de la jungle. Il enseigne à Gérard les secrets de la forêt et de la perception. L’harmonie de sa relation à la nature en fait un guide inattendu pour le voyageur d’abord sceptique et indocile, et bientôt ébranlé dans ses certitudes. De cette expérience initiatique vécue sous les frondaisons, au milieu du babil des singes et du ballet des oiseaux, le jeune homme sort transformé, et à jamais éclairé sur son destin.
Avec une postface par : Gérard Janichon
« Voilà que, près de vingt ans après, le livre Atalaya connaît une nouvelle naissance et, du même coup, redonne vie à Grand-Père Atalaya qui n’en reviendrait pas de sa longévité ! Cinquante ans, un demi-siècle, que nos chemins se croisèrent (notre rencontre eut lieu en 1970) !
Aujourd’hui encore, dans le voyage et la rencontre, tout est conditionnel, il n’existe aucune certitude. Tout dépend du voyage, tout dépend de la rencontre. Et c’était encore plus palpable un demi-siècle en arrière, l’inconnu et le mystère s’ouvraient à celui qui en rêvait et savait s’en émerveiller, l’Amazonie elle-même était encore en grande partie une terra incognita. Le voyageur était facilement un explorateur, et l’on sait qu’en ces conditions c’est soi-même que l’on découvre, souvent d’une façon inattendue, étrange. Et autant vous le dire tout de suite, Atalaya est une histoire étrange. Elle mit à mal mes certitudes de jeune homme européen et certains lecteurs ne sauront la percevoir qu’au conditionnel sceptique, une conjugaison pragmatique et rationnelle de la vie aujourd’hui largement répandue. Qu’importe, je ne cherche pas à convaincre, je raconte une expérience qui ressemble parfois à un conte. Elle en a la simplicité et l’ébahissement. Il en va ainsi lorsque le voyageur avide de découverte et d’émerveillement s’enfonce dans une nature sauvage et majestueuse, forte, envoûtante et qu’il y fait la rencontre de gens qui vivent en harmonie avec leur environnement dont ils soupçonnent à peine l’exubérance. Pas besoin de maîtriser le dialecte local pour comprendre et partager, on est immédiatement dans l’essentiel. Parvenu en ces lieux comme guidé par une fatalité divine, bonne ou mauvaise, l’échange peut prendre une tournure inattendue pour ce voyageur subjugué, dépassé !
Tout avait d’ailleurs commencé comme un conte quelques années auparavant. Nous étions deux amis d’école, Jérôme Poncet et moi-même, et avions décidé d’un projet ambitieux : réaliser un tour du monde sur un petit voilier en visitant des latitudes vierges ou quasi vierges à l’époque, vers le pôle Nord, le pôle Sud, le cap Horn bien sûr, avec au milieu un défi lui aussi inédit pour un petit voilier, la remontée de l’Amazone jusqu’à ses sources andines ! Nous avions 17 ans, l’idée fit sourire, le projet fut moqué mais, après cinq ans d’efforts, Damien, robuste voilier en bois de 10 mètres existait bel et bien et nous étions plus déterminés que jamais. Le voyage de 55 000 milles entre 80° Nord et 68° Sud dura près de cinq ans, entre mai 1969 et septembre 1973. Nous réalisâmes à peu près toutes nos annonces et parfois un peu mieux.
Le projet amazonien, lui, connut quelques bouleversements.
Dans un voyage autour du monde, les fortunes de mer et les infortunes tout court font partie du quotidien. L’important pour les surmonter est de rester fidèle à ses objectifs, et de demeurer un équipage solidaire. Partis à trois, nous nous étions retrouvés à deux au bout de six à sept mois de route mais Jérôme et moi formions un duo qui fonctionnait bien en mer comme aux escales. Nous nous appréciions, nous respections, nous complétions.
Aux Antilles, Jérôme se vit alléger d’un rein et la parenthèse tropicale parsemée d’autres embûches se prolongea plus longtemps que prévu. Elle nous contraignit à renoncer au projet de remonter l’Amazone jusqu’au Pérou : nous dûmes nous contenter de forcer son cours sur 2 000 kilomètres environ, jusqu’à Manaus. En 1970, l’ancienne cité glorieuse du caoutchouc tombait en ruines, la Selva, vorace forêt amazonienne, avait même commencé à dévorer O Teatro, son imposant opéra de marbre.
Dès notre entrée sur le Fleuve-Mer, je ressentis de curieuses fièvres qui n’avaient rien à voir avec la malaria. J’avais rêvé de cet Enfer vert durant des années et, en longeant ses berges dévastées et rongées par la puissance du fleuve, mon excitation ne cessait de croître ! Je ressentais l’appel de la forêt comme si j’avais déjà vécu en ces lieux : il me prenait aux tripes. Dans cette jungle où il était si facile de se perdre, de sombrer dans la folie ou de mourir de la simple piqûre d’une araignée, quelque chose ou quelqu’un m’attendait ! Je remplissais régulièrement mon journal de bord en m’interrogeant sur mon exaltation mais ne trouvais aucune explication rationnelle. Heureusement, la lutte quotidienne contre le courant violent pour sauter d’un village à l’autre ou pour se déséchouer des bancs de sable sur lesquels nous butions avec régularité réclamait toute notre énergie. Elle ne permettait aucun relâchement et évitait de s’attarder aux questionnements existentiels.
Une fois atteints Manaus et le spectaculaire mélange des eaux du Rio Negro et du Rio Solimões qui forment ainsi le cours principal de l’Amazone, nous sentîmes que nous passions à côté d’une découverte essentielle. À force de remonter les artères du grand corps Amazonia, nous étions parvenus jusqu’à son cœur, nous en ressentions les battements, mais nous n’avions qu’une idée superficielle de ce qu’était sa vie. Nous longions l’immense forêt, nous en percevions les sons et les odeurs, croisions des pirogues menées par des Caboclos aux mines résignées et qui répondaient avec indifférence à nos saluts, mais nous n’avions rien partagé, rien vu, rien affronté. Nous n’étions que des voyageurs passifs, assis dans un train, qui contemplent, sans en faire partie, le paysage immense qui défile derrière la vitre du wagon. Notre voyage nous conduisait forcément quelque part de plus excitant qu’une gare et j’étais de plus en plus impatient de découvrir où, je savais déjà que c’était dans la Selva. Les deux sapajous adoptés lors d’une escale dans un village semblaient également de cet avis. Un forestier nous indiqua le Lago Sapucuá, un petit lac perdu au milieu de la forêt. Nous allâmes donc y échouer Damien.
À peine l’ancre mouillée, une pirogue menée par un vieil homme ridé accosta notre bord. C’était Grand-Père Atalaya, le héros du présent récit. Il semblait nous attendre, c’est d’ailleurs ce qu’il prétendit.
On verra qu’il était fort bavard et savait se faire entendre, se faire comprendre ! Cela ouvre voie à la question récurrente, mais comment réussissiez-vous à communiquer ? Pas plus que je me suis demandé qui était réellement ce grand-père qui ne payait pas de mine dans son short élimé et sa chemisette déchirée, me contentant de l’accepter tel qu’il était, communiquer est une question que nous ne nous sommes jamais posée durant tout notre voyage autour du monde, où que ce soit et avec qui que ce soit, et au lac Sapucuá moins qu’ailleurs ! Certes, à l’entame de notre périple amazonien, nous ne maîtrisions ni le portugais (langue officielle du Brésil) ni le dialecte local fondé sur les langues tupi-guarani assez répandues le long des grands fleuves de l’Amérique du Sud et dont usaient alors les communautés caboclos les plus isolées. Mais les rencontres au fil de la remontée du fleuve nous y initièrent et nous habituèrent à nous débrouiller avec ce que nous pouvions retenir au gré des circonstances. Nous parvenions à converser sans complexe avec les uns et les autres. Tous les nomades vous diront d’ailleurs qu’il existe un espéranto du voyageur, un langage universel de la rencontre. La circonstance factuelle invente le système de communication. On se rencontre, on échange, on partage et on se comprend. Parfois tant bien que mal, mais ensuite on est toujours étonné de l’empreinte qui s’est imprimée en soi. Nous communiquions ainsi avec Grand-Père et tous les gens rencontrés au Lago Sapucuá, Francesca, Waldemar et ceux dont nous ne connaissions pas toujours les noms.
De plus, les soliloques de Grand-Père étaient souvent interminables : peut-être voulait-il être sûr de graver quelque chose dans mon esprit ou mon âme ? Car s’il se montrait aussi insistant, ce n’est pas par crainte que je ne le comprenne pas mais parce qu’il me sentait particulièrement récalcitrant à ce qu’il devait considérer comme son devoir de transmission ou d’enseignement. Je n’étais pas prêt à les recevoir. J’appréciais sa compagnie, j’aimais apprendre de ses gestes et attitudes de survie dans le milieu hostile qui nous cernait ; il avait raison de jouer avec mes sens, de me pousser à mieux voir, mieux écouter, mieux sentir tout ce qui m’entourait, ici le fleuve, la forêt et ses habitants, humains et animaux ; c’était un bon guide qui nous ouvrait aux rencontres avec la petite communauté dispersée dans la Selva, mais quand il déclinait ses logorrhées sans fin ou ses monologues ésotériques, souvent, je m’agaçais. D’abord parce que ces moments-là me réclamaient concentration et énergie pour saisir où il voulait en venir (ses propos n’étaient pas toujours limpides et fluides du premier coup) et j’en ressortais fatigué, frustré de n’être pas en forêt, au milieu des arbres dont on apercevait à peine les cimes. Ensuite, parce que, pour le dire clairement, j’ai peu d’attirance pour le surnaturel. Sa patience (et la mienne !) fut toutefois récompensée. Peu à peu, je sus l’écouter autrement, un autre système de perception complémentaire au langage se mit en place tout seul. Elle était là notre communication, la perception. Atalaya n’était pas un simple personnage verbomoteur, il possédait des dons. Il ne m’en a transmis aucun, mais a su ouvrir des portes en moi. On le sait, on ne comprend pas seulement avec les mots. Les mots ne sont que des étiquettes, ils désignent, ils définissent, ils dissèquent, ils intellectualisent, mais on comprend vraiment par la perception, c’est elle qui fait entrer le concept dans notre esprit et l’ancre à jamais. Cela se vérifie dès l’enfance : pourquoi un écolier bloque-t-il sur l’enseignement et, d’un seul coup, “déclenche-t-il”, comme on dit ? Souvent parce qu’un professeur a su trouver la clé pour harmoniser leur relation, puis l’interrupteur pour faire surgir la lumière, alors que les autres n’y parvenaient pas. L’écolier ne redoute plus l’inconnu et ce qu’il ne sait pas, il voit, il est ouvert à ce qu’il entend, il comprend, il assimile et pourra restituer.
Maîtrisée, la perception peut déboucher sur un autre type d’approche pour entendre et comprendre. Grand-Père, friand de métaphores pour expliciter ses propos, l’avait baptisée, on le verra, “naviguer dans la pensée de l’autre”. Cette perception est assez déroutante lorsqu’on l’expérimente ou la pousse à l’extrême, mais elle est également instinctive dans tous les rapports humains. Et elle peut se développer si on l’exerce. Car elle repose sur l’écoute de l’autre dans une attitude neutre, objective, ouverte et sans jugement. Pour aller un peu plus loin que le simple “je vois ce que tu veux dire”, on doit lâcher prise, se laisser porter par le courant de la pensée de l’autre afin d’y embarquer, la pénétrer sans l’altérer. Une méditation en l’autre en quelque sorte ou, par exemple, un voyage exploratoire au-delà de la conscience, un peu à la façon d’une séance de yoga nidra dont le but ne serait pas uniquement la relaxation mais la compréhension. Une pratique qui, évidemment, a des limites, selon les individus. Personnellement, ignare en ces domaines et sans doute trop récalcitrant, j’ai eu du mal à l’appliquer, mais ce qui est certain c’est que j’étais davantage réceptif, je saisissais ce que Grand-Père Atalaya me racontait. De son côté, il semblait avoir tout deviné de moi.
Tel était notre fonctionnement de communication.
Quelques discours de Grand-Père avaient été enregistrés sur le petit magnétophone du bord, un appareil à bandes magnétiques pas très pratique, mais à l’époque les cassettes et les CD n’existaient pas encore. À l’escale de Rio de Janeiro, nous retrouvâmes notre ami Jean-Pierre croisé dans différents villages amazoniens. Habitué à ces lieux où il supervisait ses chantiers et familier du dialecte local, il fut plutôt interloqué en écoutant la voix du vieil homme et se fendit d’un premier commentaire énigmatique : “Eh bien, dis donc, ton ami prêcheur est étonnant !” Son avis m’intéressait et nous étions convenus de prendre plusieurs soirées pour analyser ces bandes et en discuter. Ce que nous ne fîmes jamais. Et puis au fil du temps, des nouveaux bateaux, des fortunes de mer, tout disparut.
De même, dans l’Amazonie mutilée d’aujourd’hui, il n’existe probablement plus aucune trace de Grand-Père Atalaya. Mais, comme par magie, il existe ce livre – son livre – qui s’est refusé à passer dans l’oubli après sa première édition.
Pour terminer cet avertissement, je voudrais rappeler que ce qui peut apparaître exceptionnel, étrange ou fantasque, invraisemblable à un lecteur confortablement installé dans son canapé, peut posséder une autre normalité, presque une banalité, en d’autres contextes d’action et de lieu. À de multiples égards, cette saison en Amazonie fut pour moi exceptionnelle, je la vécus intensément au présent et elle imprégna le jeune voyageur que j’étais autrement qu’au conditionnel ! Elle m’accompagne toujours. »


