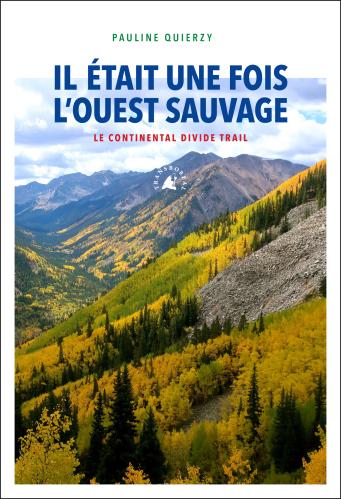
Hospitalité et tempête du désert :
« Rien n’avait été convenu mais nous déjeunerions. Eric nous proposa une douche. La salle de bains était de plastique comme dans les paquebots. Sur un coin de lavabo, entre un numéro spécial balistique de la revue American Hunter et des poils épars, je posai ma serviette puis tournai le robinet. Ce fut si bon d’entendre l’eau couler ! Dans le désert, elle se tapit, muette. Eric avait installé Fred sur le canapé et m’offrit le rocking-chair. Sur la table basse, dans deux assiettes en carton, maïs et haricots disparaissaient sous la sauce barbecue. “Bon appétit !” sourit-il de ses quelques mots de français. Et voilà comment on fait un pas de plus dans la vie des gens. “La frontière a fermé à 16 heures aujourd’hui. Vous ne trouverez plus personne sur la route. Je vous emmène.”
Ainsi nous retrouvâmes le territoire des musaraignes quitté au matin. Pas une à l’horizon mais un magnifique serpent à sonnette ondulant, sensuel, sur le bitume. Sa présence – redoutable pour certains, pour nous merveilleuse – remplissait tout l’espace. Eric s’en approcha et, d’un mouvement de pied lent, respectueux, sans même effleurer sa peau, l’invita à se ranger sur le bas-côté. Le reptile leva la tête, Eric baissa la sienne. Souvent il retrouve des serpents écrasés, ce qui le mine. Les gens s’en fichent. Peut-être ne les voient-ils même pas. L’animal se fondit dans l’herbe. J’aimerais qu’il emprunte lui aussi le tuyau d’écoulement des eaux. Les souris ne seraient pas de mon avis.
Sur nos épaules, nous hissâmes notre barda. “Oh les gars ! Quels sacs ! Vous avez des couilles grosses comme des noix de coco !” Rires. À Hachita, nous ne nous étions pas allégés. Les coutures craquaient sous les bonnes choses.
Au réveil, nous découvrons le lit de la rivière. Le vent fait chanter les buissons d’armoise et promène les cendres. Nous replions la tente et, sur son empreinte, replaçons un à un les galets. Si leurs surfaces polies par l’eau sont douces sous la main, elles sont dures pour le dos. Nous reste à soulever les plus gros, en pliant bien les genoux, ceux que le courant ne doit pas emporter facilement, à la saison des pluies. Nous redéplaçons aussi ces pierres qui ont fait nos sièges et table de Pâques, dressés dans la nuit noire, ainsi que celles qui ont cerclé le feu. Ça a été la fête ! Sans les chercher, les œufs vinrent à nous : ceux des poules d’Eric. Crépitant au fond de la poêle, de la mie des petits pains au maïs de la station-service, nous les avons fait s’épancher tels des soleils.
Malgré notre soin à ne pas en laisser, nous abandonnons ici nos traces. Les flammes ont léché les pierres du foyer, qui n’ont plus leur blancheur. Le temps d’une nuit, aux êtres vivant sous les galets, nous avons ôté leur toit pour installer le nôtre. Notre présence même est trace, aussi nous exerçons-nous à la discrétion. Dans ce paysage, nous ne voulons jurer à l’image de ces niches en plastique, dans les jardins, dans lesquelles les chiens ne vont pas dormir, de ces barbecues de parpaings ou de ces trampolines venus de Chine. Nous aspirons au savoir-vivre du rosier sauvage qu’on n’a pas arraché à la construction car, après tout, il ne gêne pas, se contentant de la pluie, du soleil, des abeilles et du vent.
Nous reprenons le sentier dont le tracé suit tantôt la piste, tantôt s’engouffre dans l’armoise argentée. Il révèle alors toute la diversité que la niveleuse a emportée. La taille des cactus rustiques nous impressionne. Leurs branches me font penser à des jambes et des bras, et la plante tout entière, à une foule de personnages enthousiastes, image de liesse populaire. Leurs gros fruits jaunes sont de joyeuses pupilles – on peut être plein d’épines et incarner l’allégresse. Les ferocactus cylindriques sont quant à eux plutôt cyclopes : leurs fleurs sont réunies au sommet de leur corps dodu, en un seul œil. On les surnomme avec humour “fauteuils de belle-mère”. Gare à qui y poserait son derrière !
Aller à la rencontre de ces plantes et les décrire, c’est les sortir de l’oubli, elles qui ont pourtant fait le quotidien des Indiens. Fut un temps où ils faisaient de leurs épines des aiguilles ou des punaises. Grâce à des pinces rudimentaires, ils récoltaient dans des paniers leurs fruits abondants, importante source de ravitaillement. Puis ils les déversaient au sol et, au moyen d’un petit balai dur, les débarrassaient de leurs épines, ou celles-ci étaient brûlées. Très sucrés, les fruits se mangeaient frais, séchés, ou se buvaient sous forme de sirop ou de vin.
Pour économiser l’eau, les végétaux du désert ne poussent pas très haut. Le genévrier des Rocheuses, lui, s’élève un peu plus. Il a appris à danser avec les rayons du soleil. Près de lui se dresse souvent une éolienne. Dans le sol où il plonge ses racines, l’homme a foré. Le genévrier transforme l’énergie du soleil et l’éolienne, celle du vent. Il est facile à repérer dans ce paysage sans fin, grain de beauté au milieu d’un visage.
À leur pied, nous déjeunons. Le soleil projette leur ramure sur l’ocre de la terre, pour en augmenter la beauté. D’un bout de bois, j’épouse les contours de cette ombre qui, quand la Terre tournera – de ce mouvement imperceptible qu’on accompagne nous aussi –, se déplacera. Mon dessin, immobile lui, sera emporté par le vent et les sabots des vaches. Craintives, elles se tiennent à distance. Grâce à l’éolienne, la pompe de l’abreuvoir s’actionne toutes les vingt minutes, faisant couler l’eau. Pour ne pas boire celle moussue sur laquelle sont massées les abeilles, il faut tendre l’oreille. Si, divertis par le chant du roitelet, nous manquons ce flot, c’est comme pour le bus : il faut attendre le suivant. Tout près, le passereau est venu se poser – l’ombre est rare, qui se partage –, sans craindre les grincements de l’éolienne ni les ronflements de Fred.
Les nuages ont envahi le ciel, plafond bas. Nous sommes pris entre ce grand drap blanc tendu et le vaste tapis d’herbes blondes, voluptueux. Le relief ondule en courbes légères. Dans celui des Little Hatchet Mountains, nous ne parvenons pas à déceler l’origine de leur nom : “petite hache”. Rien d’aussi net que le coup d’épée porté par Roland qui a donné naissance, dans les Pyrénées, à la fameuse brèche. Sur leurs parois, nous cherchons les mouflons. Pas le moindre en vue. Sensation de nudité, comme si la faune avait déserté. Dès l’aube, il y a pourtant eu ce lézard qui a traversé la piste, tout engourdi, le sang encore froid. Puis ce hiker suédois qui se frottait les yeux, ensommeillé de rêves. D’invisibles corbeaux croassent. Nous ne savons plus l’atmosphère paisible ou inquiétante.
Dans nos jumelles, la rassurante Hachita, déformée par les volutes de chaleur. Nous tournons lentement sur nous-mêmes. Apparaissent alors, au pied des montagnes, des ruines bien camouflées. Nous comptons sept maisons dont seuls restent les murs, de briques. La discrétion est l’élégance de ces villages nés de la contrainte de faire avec ce qui était offert sur place. C’est comme si la terre les avait enfantés. Abandonnés, ils lui reviennent. Lloyd nous a révélé l’existence d’un village fantôme où les pumas aiment séjourner. Ce que l’oreille a entendu ailleurs, l’œil l’observe ici.
En 1875, un camp de mineurs s’établit dans les Little Hatchet Mountains pour y chercher de l’argent, du plomb, du cuivre et de la turquoise. Dix ans plus tard, ses 300 résidents appelaient la localité “petite hache”, hachita en espagnol. Après 1900, avec l’apparition du chemin de fer à une dizaine de miles à l’est, un second campement apparut. La voie divisait alors la communauté en Old Hachita et New Hachita. Ce qu’il reste d’Old Hachita est sous nos yeux ; New Hachita, c’est chez Eric. La prospection prit fin. Demeurent les terrils, tels les monticules des taupes qui creusent des galeries dans les jardins.
Aujourd’hui, c’est sûr, quelque chose diffère d’hier et d’avant-hier. Le vent râle plus, bouscule la végétation. Les animaux, eux, continuent d’être discrets. Le ciel a changé. Cette dernière heure, son drap s’est froissé, comme si l’on y avait cauchemardé. Les nuages se sont épaissis mais laissent encore quelques trouées pour le soleil. Une nuée de pigeons rend un instant le ciel moins effrayant. Où vont-ils ? Il a noirci. Nous pressons le pas. Hors sentier, un gilet orange sur lequel Fred ne s’attarde pas, préoccupé qu’il est de voir les herbes ployer. La surface ondule, mer agitée, les cactées sont ses oursins. Je pense au sac de Cathy. Il est peut-être arrivé quelque chose : je file jeter un œil. Les nuages se mettent à pleurer, de ces chagrins secs – dans le désert, on ne s’épanche pas. Ils forment les larmes mêmes, des fumerolles. Le ciel est sens dessus dessous et la terre, semblable aux sombres fonds océaniques. Je découvre un sac gisant, carcasse autour de laquelle s’éparpillent ses entrailles. Pantalon, chemise en jean, piles, briquet, boîte de sardines, piment, housse de canif. Et ce gilet qui a alerté notre attention tel le sang, les vautours. Un livre dont le vent fait la lecture. Il en tourne les pages, en a même arraché. Je ramasse la 172e retenue par l’armoise. Dios morara con los hombres para siempre, Apo 21:3. Un schéma dense tente de rendre intelligible une vision étagée du monde. Des mots et des dessins de flammes, du siège de la justice divine, de Jérusalem, du mont des Oliviers, d’une couronne. J’ai la tête qui tourne. Fred m’appelle. Sa voix me semble venir d’ailleurs. Une bible en espagnol. Le vent souffle entre ses pages et répand la parole de Dieu. Le sac d’un migrant. Pour fuir plus vite, il a dû l’abandonner.
“C’était quoi ?
— Je te raconterai !”
Seul le vent, qui a haussé le ton, peut prendre la parole. L’atmosphère s’électrise. À l’horizon, la plaine s’imprime de larges zones d’ombre et de lumière. Les nuages projettent la pénombre et les rayons du soleil transforment la prairie en des champs de blé d’or. Fred me montre un nid. Il ne veut pas que je m’égare mais ne résiste pas à me faire apparaître le génie de la nature. Il y a, dans l’observation, une intimité de l’instant, une communion silencieuse, un besoin de partage immédiat. Et l’amour encourage la fusion des regards. »
La plaine Saline (p. 269-273)
Les cavernes d’Ali Baba (p. 596-600)
Extrait court
« Rien n’avait été convenu mais nous déjeunerions. Eric nous proposa une douche. La salle de bains était de plastique comme dans les paquebots. Sur un coin de lavabo, entre un numéro spécial balistique de la revue American Hunter et des poils épars, je posai ma serviette puis tournai le robinet. Ce fut si bon d’entendre l’eau couler ! Dans le désert, elle se tapit, muette. Eric avait installé Fred sur le canapé et m’offrit le rocking-chair. Sur la table basse, dans deux assiettes en carton, maïs et haricots disparaissaient sous la sauce barbecue. “Bon appétit !” sourit-il de ses quelques mots de français. Et voilà comment on fait un pas de plus dans la vie des gens. “La frontière a fermé à 16 heures aujourd’hui. Vous ne trouverez plus personne sur la route. Je vous emmène.”
Ainsi nous retrouvâmes le territoire des musaraignes quitté au matin. Pas une à l’horizon mais un magnifique serpent à sonnette ondulant, sensuel, sur le bitume. Sa présence – redoutable pour certains, pour nous merveilleuse – remplissait tout l’espace. Eric s’en approcha et, d’un mouvement de pied lent, respectueux, sans même effleurer sa peau, l’invita à se ranger sur le bas-côté. Le reptile leva la tête, Eric baissa la sienne. Souvent il retrouve des serpents écrasés, ce qui le mine. Les gens s’en fichent. Peut-être ne les voient-ils même pas. L’animal se fondit dans l’herbe. J’aimerais qu’il emprunte lui aussi le tuyau d’écoulement des eaux. Les souris ne seraient pas de mon avis.
Sur nos épaules, nous hissâmes notre barda. “Oh les gars ! Quels sacs ! Vous avez des couilles grosses comme des noix de coco !” Rires. À Hachita, nous ne nous étions pas allégés. Les coutures craquaient sous les bonnes choses.
Au réveil, nous découvrons le lit de la rivière. Le vent fait chanter les buissons d’armoise et promène les cendres. Nous replions la tente et, sur son empreinte, replaçons un à un les galets. Si leurs surfaces polies par l’eau sont douces sous la main, elles sont dures pour le dos. Nous reste à soulever les plus gros, en pliant bien les genoux, ceux que le courant ne doit pas emporter facilement, à la saison des pluies. Nous redéplaçons aussi ces pierres qui ont fait nos sièges et table de Pâques, dressés dans la nuit noire, ainsi que celles qui ont cerclé le feu. Ça a été la fête ! Sans les chercher, les œufs vinrent à nous : ceux des poules d’Eric. Crépitant au fond de la poêle, de la mie des petits pains au maïs de la station-service, nous les avons fait s’épancher tels des soleils.
Malgré notre soin à ne pas en laisser, nous abandonnons ici nos traces. Les flammes ont léché les pierres du foyer, qui n’ont plus leur blancheur. Le temps d’une nuit, aux êtres vivant sous les galets, nous avons ôté leur toit pour installer le nôtre. Notre présence même est trace, aussi nous exerçons-nous à la discrétion. Dans ce paysage, nous ne voulons jurer à l’image de ces niches en plastique, dans les jardins, dans lesquelles les chiens ne vont pas dormir, de ces barbecues de parpaings ou de ces trampolines venus de Chine. Nous aspirons au savoir-vivre du rosier sauvage qu’on n’a pas arraché à la construction car, après tout, il ne gêne pas, se contentant de la pluie, du soleil, des abeilles et du vent.
Nous reprenons le sentier dont le tracé suit tantôt la piste, tantôt s’engouffre dans l’armoise argentée. Il révèle alors toute la diversité que la niveleuse a emportée. La taille des cactus rustiques nous impressionne. Leurs branches me font penser à des jambes et des bras, et la plante tout entière, à une foule de personnages enthousiastes, image de liesse populaire. Leurs gros fruits jaunes sont de joyeuses pupilles – on peut être plein d’épines et incarner l’allégresse. Les ferocactus cylindriques sont quant à eux plutôt cyclopes : leurs fleurs sont réunies au sommet de leur corps dodu, en un seul œil. On les surnomme avec humour “fauteuils de belle-mère”. Gare à qui y poserait son derrière !
Aller à la rencontre de ces plantes et les décrire, c’est les sortir de l’oubli, elles qui ont pourtant fait le quotidien des Indiens. Fut un temps où ils faisaient de leurs épines des aiguilles ou des punaises. Grâce à des pinces rudimentaires, ils récoltaient dans des paniers leurs fruits abondants, importante source de ravitaillement. Puis ils les déversaient au sol et, au moyen d’un petit balai dur, les débarrassaient de leurs épines, ou celles-ci étaient brûlées. Très sucrés, les fruits se mangeaient frais, séchés, ou se buvaient sous forme de sirop ou de vin.
Pour économiser l’eau, les végétaux du désert ne poussent pas très haut. Le genévrier des Rocheuses, lui, s’élève un peu plus. Il a appris à danser avec les rayons du soleil. Près de lui se dresse souvent une éolienne. Dans le sol où il plonge ses racines, l’homme a foré. Le genévrier transforme l’énergie du soleil et l’éolienne, celle du vent. Il est facile à repérer dans ce paysage sans fin, grain de beauté au milieu d’un visage.
À leur pied, nous déjeunons. Le soleil projette leur ramure sur l’ocre de la terre, pour en augmenter la beauté. D’un bout de bois, j’épouse les contours de cette ombre qui, quand la Terre tournera – de ce mouvement imperceptible qu’on accompagne nous aussi –, se déplacera. Mon dessin, immobile lui, sera emporté par le vent et les sabots des vaches. Craintives, elles se tiennent à distance. Grâce à l’éolienne, la pompe de l’abreuvoir s’actionne toutes les vingt minutes, faisant couler l’eau. Pour ne pas boire celle moussue sur laquelle sont massées les abeilles, il faut tendre l’oreille. Si, divertis par le chant du roitelet, nous manquons ce flot, c’est comme pour le bus : il faut attendre le suivant. Tout près, le passereau est venu se poser – l’ombre est rare, qui se partage –, sans craindre les grincements de l’éolienne ni les ronflements de Fred.
Les nuages ont envahi le ciel, plafond bas. Nous sommes pris entre ce grand drap blanc tendu et le vaste tapis d’herbes blondes, voluptueux. Le relief ondule en courbes légères. Dans celui des Little Hatchet Mountains, nous ne parvenons pas à déceler l’origine de leur nom : “petite hache”. Rien d’aussi net que le coup d’épée porté par Roland qui a donné naissance, dans les Pyrénées, à la fameuse brèche. Sur leurs parois, nous cherchons les mouflons. Pas le moindre en vue. Sensation de nudité, comme si la faune avait déserté. Dès l’aube, il y a pourtant eu ce lézard qui a traversé la piste, tout engourdi, le sang encore froid. Puis ce hiker suédois qui se frottait les yeux, ensommeillé de rêves. D’invisibles corbeaux croassent. Nous ne savons plus l’atmosphère paisible ou inquiétante.
Dans nos jumelles, la rassurante Hachita, déformée par les volutes de chaleur. Nous tournons lentement sur nous-mêmes. Apparaissent alors, au pied des montagnes, des ruines bien camouflées. Nous comptons sept maisons dont seuls restent les murs, de briques. La discrétion est l’élégance de ces villages nés de la contrainte de faire avec ce qui était offert sur place. C’est comme si la terre les avait enfantés. Abandonnés, ils lui reviennent. Lloyd nous a révélé l’existence d’un village fantôme où les pumas aiment séjourner. Ce que l’oreille a entendu ailleurs, l’œil l’observe ici.
En 1875, un camp de mineurs s’établit dans les Little Hatchet Mountains pour y chercher de l’argent, du plomb, du cuivre et de la turquoise. Dix ans plus tard, ses 300 résidents appelaient la localité “petite hache”, hachita en espagnol. Après 1900, avec l’apparition du chemin de fer à une dizaine de miles à l’est, un second campement apparut. La voie divisait alors la communauté en Old Hachita et New Hachita. Ce qu’il reste d’Old Hachita est sous nos yeux ; New Hachita, c’est chez Eric. La prospection prit fin. Demeurent les terrils, tels les monticules des taupes qui creusent des galeries dans les jardins.
Aujourd’hui, c’est sûr, quelque chose diffère d’hier et d’avant-hier. Le vent râle plus, bouscule la végétation. Les animaux, eux, continuent d’être discrets. Le ciel a changé. Cette dernière heure, son drap s’est froissé, comme si l’on y avait cauchemardé. Les nuages se sont épaissis mais laissent encore quelques trouées pour le soleil. Une nuée de pigeons rend un instant le ciel moins effrayant. Où vont-ils ? Il a noirci. Nous pressons le pas. Hors sentier, un gilet orange sur lequel Fred ne s’attarde pas, préoccupé qu’il est de voir les herbes ployer. La surface ondule, mer agitée, les cactées sont ses oursins. Je pense au sac de Cathy. Il est peut-être arrivé quelque chose : je file jeter un œil. Les nuages se mettent à pleurer, de ces chagrins secs – dans le désert, on ne s’épanche pas. Ils forment les larmes mêmes, des fumerolles. Le ciel est sens dessus dessous et la terre, semblable aux sombres fonds océaniques. Je découvre un sac gisant, carcasse autour de laquelle s’éparpillent ses entrailles. Pantalon, chemise en jean, piles, briquet, boîte de sardines, piment, housse de canif. Et ce gilet qui a alerté notre attention tel le sang, les vautours. Un livre dont le vent fait la lecture. Il en tourne les pages, en a même arraché. Je ramasse la 172e retenue par l’armoise. Dios morara con los hombres para siempre, Apo 21:3. Un schéma dense tente de rendre intelligible une vision étagée du monde. Des mots et des dessins de flammes, du siège de la justice divine, de Jérusalem, du mont des Oliviers, d’une couronne. J’ai la tête qui tourne. Fred m’appelle. Sa voix me semble venir d’ailleurs. Une bible en espagnol. Le vent souffle entre ses pages et répand la parole de Dieu. Le sac d’un migrant. Pour fuir plus vite, il a dû l’abandonner.
“C’était quoi ?
— Je te raconterai !”
Seul le vent, qui a haussé le ton, peut prendre la parole. L’atmosphère s’électrise. À l’horizon, la plaine s’imprime de larges zones d’ombre et de lumière. Les nuages projettent la pénombre et les rayons du soleil transforment la prairie en des champs de blé d’or. Fred me montre un nid. Il ne veut pas que je m’égare mais ne résiste pas à me faire apparaître le génie de la nature. Il y a, dans l’observation, une intimité de l’instant, une communion silencieuse, un besoin de partage immédiat. Et l’amour encourage la fusion des regards. »
(p. 44-48)
La plaine Saline (p. 269-273)
Les cavernes d’Ali Baba (p. 596-600)
Extrait court


