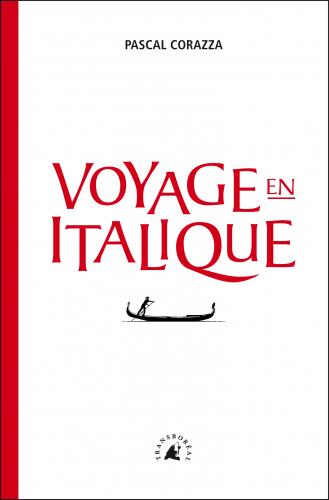
Halt ! Ausweis ! :
« Il devait être près de 5 heures 30 lorsque ce matin-là – un samedi, il n’y avait pas d’école – Osvaldo avait attelé la vache de travail pour se rendre à Guimbelet ; il fallait y sarcler le maïs. Pour l’aider à la tâche, Maria, ainsi que le fils aîné, Giovanni, qui comme à leur habitude le secondaient. Osvaldo, en observant son fils à ses côtés, s’était peut-être rendu compte qu’il était à peine plus jeune que lui, au moment où il avait reçu sa convocation pour partir à la guerre, après Caporetto. Dans cette aurore pâle et sans mouvements de la Gironde défaite, l’ancien caporal s’était revu, lettre de conscription à la main, marchant sur la route qui reliait Annone et Pramaggiore, les lieux de son adolescence. À cette heure-là, le 29 juin 1940, le soleil ne rasait pas encore le bitume de la petite rue du Temple – qu’une ironie de cadastre s’évertuait à vouloir nommer “avenue” – mais les Allemands étaient déjà debout, avec leurs chiens au pied ; après avoir calé les rênes de son modeste attelage, mon grand-père s’était roulé une cigarette de ce tabac que mon père allait chercher, le jeudi, à bicyclette, dans le centre de Castillon. Et comme les peupliers reprenaient vie, près des décombres de l’ancien temple, son cœur n’avait pas manqué de cogner plus fort en songeant aux ruines de l’église. À chaque fois que mon grand-père les voyait, il repensait à sa mère, jadis la plus pieuse d’entre eux ; il était alors jeune soldat et plein d’espoir, celui d’envoyer sa solde à sa famille. Seulement une fois de l’autre côté du fleuve, hors du territoire occupé, il n’avait rien pu faire. Elle était morte le jour de la Libération. Et en ce 29 juin 1940, que pouvait-il faire, si ce n’était aller sarcler le maïs à Guimbelet ? De l’autre côté, c’était la ligne, les Tedeschi ; impossible de traverser la route face à la ferme, limite à ce point absurde qu’elle le rendait furieux : “Il n’était plus le même”, répétait mon père. Comment contrôler la charge des épis, savoir quand moissonner ? “Vous aurez un laissez-passer, le maire est un ami”, avait affirmé le propriétaire ; mais les champs s’étaient mis à parler allemand : Halt ! Keinen Schritt weiter !, Ausweis !, et le Piave coulait goudron sur le pas de sa porte. À peine la famille de Pramaggiore jouissait-elle du titre de citoyen français qu’une frontière était née au ras de leur jardin. Osvaldo, juste débarrassé de son statut de réserviste, au moment où des trains furent affectés à Castillon, selon la mémoire labile du cousin Silvio : la France voulait que les Italiens regagnent leur pays, après le “coup de poignard” asséné par Mussolini.
Maria, ma grand-mère, se résigna sûrement à accepter qu’en effet son mari n’était plus tout à fait le même, comme en 1935, après la bagarre de voisinage dont on ne savait rien, mais qui aurait rendu Osvaldo “dépressionnaire” ; et que dire de la nuit où, avant de se rendre chez le médecin pour lui faire part de son inquiétude, elle avait été réveillée par l’absence à ses côtés, puis était descendue jusqu’à la grange pour découvrir, devant la paille, son mari vêtu d’un maillot de corps, une fourche à la main : le docteur P. avait rassemblé ces détails dans l’avis qui avait déclenché l’internement d’Osvaldo.
Lorsque la charrette s’était mise en route pour Guimbelet, il était aux alentours de 6 heures, selon le rapport d’expertise médico-légal. Ce furent les premiers claquements des fers sur l’asphalte creusé, et après une centaine de mètres, sur la gauche, mon aïeul avait trouvé les décombres de l’église, qui évoquait la Vénétie au lendemain de la Première Guerre ; en 1925, Osvaldo et sa femme avaient quitté un pays en ruine, en partie à cause des shrapnels, les obus autrichiens que mon grand-père entendait siffler encore, et davantage à mesure que le silence avait gagné sa métairie, au lendemain de la mise en place de la ligne de démarcation : les acouphènes en profitaient pour envahir ses nuits ; son corps devait alors revivre les explosions, quand retombait la terre, pleuvaient les ordres, montaient les cris et tremblaient tous ses membres.
En coupant cette fois par le chemin qui menait à l’autre église, sur la hauteur de Mouliets, Osvaldo avait tourné le dos à ces réminiscences, mais quand la charrette s’était trouvée au niveau de la maison du propriétaire, dont le fils n’avait pas donné signe de vie depuis que le tocsin l’avait éloigné du nid, il avait songé à tous ses camarades qui n’étaient pas revenus. Ce vallon morne du Castillonnais, ce coteau sans histoire se présentant à lui, n’avait-il pas les courbes et l’allure du Montello, là où ses frères d’armes étaient tombés l’un après l’autre sitôt le funeste rappel : “Tenir à tout prix” ? Voilà près d’une semaine que l’ancien caporal ne trouvait plus le sommeil, comme durant les jours qui avaient précédé l’assaut des Tedeschi, vingt-trois ans plus tôt.
À l’heure où la vache s’était arrêtée en bordure du maïs, Maria avait dit à Giovanni qu’il lui faudrait retourner à la métairie pour aider les plus jeunes – Alfredo, mon père, et Luigi – pour faire téter les veaux. Les pieds de maïs en ordre de bataille, rangs serrés, alignés, faisaient face à Osvaldo, à l’image de la brigade l’Aquila, jadis en position au bas de la ligne ferroviaire Nervesa-Montebelluna. Le cliquetis du bigot qu’il avait bientôt perçu – Maria et Giovanni s’étaient mis au travail – n’était pas éloigné du bruit des balles lorsqu’elles s’enterraient sous le gravier ; peut-être avait-il senti, dans cette confusion, une présence à ses côtés, mais dont les formes s’étaient brouillées ; près de lui, cependant, on s’agitait entre les rangs ; le métal de la bêche cognait entre terre et graviers, et comment ce bruit ne pouvait-il pas être amplifié par ses nerfs à fleur de peau depuis si longtemps ? Maria, elle, avait déjà revu l’homme de 1935, et dut saisir très vite qu’il était en train de craquer, qu’il allait à nouveau la lâcher, alors même si ce n’était pas le moment, elle s’était approchée de lui? »
Un morceau d’Italie (p. 129-132)
Mon père (p. 164-168)
Extrait court
« Il devait être près de 5 heures 30 lorsque ce matin-là – un samedi, il n’y avait pas d’école – Osvaldo avait attelé la vache de travail pour se rendre à Guimbelet ; il fallait y sarcler le maïs. Pour l’aider à la tâche, Maria, ainsi que le fils aîné, Giovanni, qui comme à leur habitude le secondaient. Osvaldo, en observant son fils à ses côtés, s’était peut-être rendu compte qu’il était à peine plus jeune que lui, au moment où il avait reçu sa convocation pour partir à la guerre, après Caporetto. Dans cette aurore pâle et sans mouvements de la Gironde défaite, l’ancien caporal s’était revu, lettre de conscription à la main, marchant sur la route qui reliait Annone et Pramaggiore, les lieux de son adolescence. À cette heure-là, le 29 juin 1940, le soleil ne rasait pas encore le bitume de la petite rue du Temple – qu’une ironie de cadastre s’évertuait à vouloir nommer “avenue” – mais les Allemands étaient déjà debout, avec leurs chiens au pied ; après avoir calé les rênes de son modeste attelage, mon grand-père s’était roulé une cigarette de ce tabac que mon père allait chercher, le jeudi, à bicyclette, dans le centre de Castillon. Et comme les peupliers reprenaient vie, près des décombres de l’ancien temple, son cœur n’avait pas manqué de cogner plus fort en songeant aux ruines de l’église. À chaque fois que mon grand-père les voyait, il repensait à sa mère, jadis la plus pieuse d’entre eux ; il était alors jeune soldat et plein d’espoir, celui d’envoyer sa solde à sa famille. Seulement une fois de l’autre côté du fleuve, hors du territoire occupé, il n’avait rien pu faire. Elle était morte le jour de la Libération. Et en ce 29 juin 1940, que pouvait-il faire, si ce n’était aller sarcler le maïs à Guimbelet ? De l’autre côté, c’était la ligne, les Tedeschi ; impossible de traverser la route face à la ferme, limite à ce point absurde qu’elle le rendait furieux : “Il n’était plus le même”, répétait mon père. Comment contrôler la charge des épis, savoir quand moissonner ? “Vous aurez un laissez-passer, le maire est un ami”, avait affirmé le propriétaire ; mais les champs s’étaient mis à parler allemand : Halt ! Keinen Schritt weiter !, Ausweis !, et le Piave coulait goudron sur le pas de sa porte. À peine la famille de Pramaggiore jouissait-elle du titre de citoyen français qu’une frontière était née au ras de leur jardin. Osvaldo, juste débarrassé de son statut de réserviste, au moment où des trains furent affectés à Castillon, selon la mémoire labile du cousin Silvio : la France voulait que les Italiens regagnent leur pays, après le “coup de poignard” asséné par Mussolini.
Maria, ma grand-mère, se résigna sûrement à accepter qu’en effet son mari n’était plus tout à fait le même, comme en 1935, après la bagarre de voisinage dont on ne savait rien, mais qui aurait rendu Osvaldo “dépressionnaire” ; et que dire de la nuit où, avant de se rendre chez le médecin pour lui faire part de son inquiétude, elle avait été réveillée par l’absence à ses côtés, puis était descendue jusqu’à la grange pour découvrir, devant la paille, son mari vêtu d’un maillot de corps, une fourche à la main : le docteur P. avait rassemblé ces détails dans l’avis qui avait déclenché l’internement d’Osvaldo.
Lorsque la charrette s’était mise en route pour Guimbelet, il était aux alentours de 6 heures, selon le rapport d’expertise médico-légal. Ce furent les premiers claquements des fers sur l’asphalte creusé, et après une centaine de mètres, sur la gauche, mon aïeul avait trouvé les décombres de l’église, qui évoquait la Vénétie au lendemain de la Première Guerre ; en 1925, Osvaldo et sa femme avaient quitté un pays en ruine, en partie à cause des shrapnels, les obus autrichiens que mon grand-père entendait siffler encore, et davantage à mesure que le silence avait gagné sa métairie, au lendemain de la mise en place de la ligne de démarcation : les acouphènes en profitaient pour envahir ses nuits ; son corps devait alors revivre les explosions, quand retombait la terre, pleuvaient les ordres, montaient les cris et tremblaient tous ses membres.
En coupant cette fois par le chemin qui menait à l’autre église, sur la hauteur de Mouliets, Osvaldo avait tourné le dos à ces réminiscences, mais quand la charrette s’était trouvée au niveau de la maison du propriétaire, dont le fils n’avait pas donné signe de vie depuis que le tocsin l’avait éloigné du nid, il avait songé à tous ses camarades qui n’étaient pas revenus. Ce vallon morne du Castillonnais, ce coteau sans histoire se présentant à lui, n’avait-il pas les courbes et l’allure du Montello, là où ses frères d’armes étaient tombés l’un après l’autre sitôt le funeste rappel : “Tenir à tout prix” ? Voilà près d’une semaine que l’ancien caporal ne trouvait plus le sommeil, comme durant les jours qui avaient précédé l’assaut des Tedeschi, vingt-trois ans plus tôt.
À l’heure où la vache s’était arrêtée en bordure du maïs, Maria avait dit à Giovanni qu’il lui faudrait retourner à la métairie pour aider les plus jeunes – Alfredo, mon père, et Luigi – pour faire téter les veaux. Les pieds de maïs en ordre de bataille, rangs serrés, alignés, faisaient face à Osvaldo, à l’image de la brigade l’Aquila, jadis en position au bas de la ligne ferroviaire Nervesa-Montebelluna. Le cliquetis du bigot qu’il avait bientôt perçu – Maria et Giovanni s’étaient mis au travail – n’était pas éloigné du bruit des balles lorsqu’elles s’enterraient sous le gravier ; peut-être avait-il senti, dans cette confusion, une présence à ses côtés, mais dont les formes s’étaient brouillées ; près de lui, cependant, on s’agitait entre les rangs ; le métal de la bêche cognait entre terre et graviers, et comment ce bruit ne pouvait-il pas être amplifié par ses nerfs à fleur de peau depuis si longtemps ? Maria, elle, avait déjà revu l’homme de 1935, et dut saisir très vite qu’il était en train de craquer, qu’il allait à nouveau la lâcher, alors même si ce n’était pas le moment, elle s’était approchée de lui? »
(p. 210-213)
Un morceau d’Italie (p. 129-132)
Mon père (p. 164-168)
Extrait court


