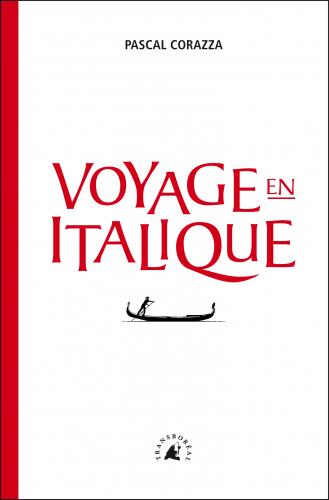
Mon père :
« De sa fratrie, mon père était le seul à avoir quitté les rives de la Dordogne. En Aquitaine, les familles originaires d’Italie étaient nombreuses, mais elles se réduisaient à la portion congrue en pays d’Aunis. Il était arrivé ici avec pour passé son léger accent du Sud, prononçait toutes les lettres de tabac, prenait la paume pour la pomme, se méfiait des “e” muets. Un homme en voie de disparition : chacun de ses muscles s’était formé à l’école du travail bien fait, dans les gestes de l’artisan consciencieux, et même s’il capitalisait un immense savoir, il le dédaignait, de n’être pas écrit. Sa profession n’avait pas obtenu sa juste reconnaissance, il se définissait en “travailleur de force et par force”, amer. Pour parer au manque d’argent, il avait renoué avec le troc, en créant plus qu’en achetant, en dialoguant avec les matériaux de récupération. Diplômé en ingénierie de la débrouille, chaussé de vieilles bottes transformées en sabots de caoutchouc et vêtu d’un bleu de travail délavé, il avançait encore à pas sûrs à 80 ans. Dans sa démarche, il mêlait la noblesse du gitan à l’assurance du paysan, de sorte qu’aucun costume ne l’aurait habillé davantage. Son honnêteté, c’était sa journée de travail, du lever au coucher du soleil. Il désherbait à la main, plantait, en saison, pommes de terre, salades ou carottes, et possédait même quelques pieds de vigne. Il traitait les arbres fruitiers à la bouillie bordelaise, faisait son propre humus. Comme son père. C’était dans son jardin qu’il en parlait le mieux. Il n’avait qu’un luxe, annexé à sa liberté : ses fleurs. Roses, hortensias, pensées, et des iris multicolores. Chez ses parents, il n’y en avait pas, parce que ça ne se mangeait pas.
Sa science, il ne la transmettait pas. Le savoir, pour lui, se trouvait dans les livres. La vie les lui avait refusés, son travail nous les avait offerts. Des études, je n’avais rien appris ; il continuait à penser qu’entre les pages dormaient les secrets des alchimistes. Pourtant de son père il tenait la mesure, lorsqu’il plantait ou taillait en saison. Le savoir qu’il avait dans le sang ne se cristallisait pas dans les mots, mais dans les actes : il savait greffer un citronnier, enrichir sa terre ; il sentait dans les frémissements du jour l’approche du gel, l’intensité du soleil ou de lune à venir, d’où viendrait le vent encore endormi ; il maniait le soufre, le cuivre, le fer, pour empêcher la maladie de s’emparer de la vie, comme le généticien, le météorologue, ou le chimiste.
Malgré tout, il portait le poids des étiquettes collées aux “péquenots”. Ces hommes bien que riches de leur science demeuraient frustes, épais, incultes, dans l’imagerie populaire. Il fallait sans cesse relever la tête de mon père, enclin à se déprécier tout seul. Son passage dans le camp des ouvriers ne l’avait pas aidé à se valoriser. Taiseux, certes, le paysan l’était, encore plus s’il avait fait la guerre. Mais de là à le juger rustre, ou même sans élégance ; croire que son mutisme révélait une pensée grossière (que savions-nous des formes de vie plus silencieuses, était-ce d’en avoir conscience que nous les détruisons ?), que le bon sens – peu commun – lui était étranger ! Mon père aujourd’hui perpétuait la même gestuelle, mais sans une once de fierté.
Agenouillé, sur une planche ligotée de chiffons, il libérait les scaroles des tentacules du pourpier. En équilibre. Le monde pouvait bien s’écrouler, la bourse partir en fumée – était-elle autre chose ? –, lui saurait s’en sortir. Grâce à la terre. Il ne s’en était jamais coupé. Du temps où il était actif, en sus des heures de travail hebdomadaire, il occupait ses fins de journée avec 3 000 mètres carrés de potager – les jardins ouvriers de Bongraine. Pour avoir “le ventre plein”, ne plus jamais revivre les privations. De ses racines il tirait encore sa survie, surtout depuis l’annonce de son cancer. Il n’était allé vers les rayons qu’à contrecœur. Il serait parti avec la tumeur plutôt que d’être irradié. Il savait que sa longévité – et ce confort gras qui s’étalait partout – n’annonçait rien de bon pour la terre, dont on comptait les jours. Il était conscient d’avoir vécu autant que son père et sa mère réunis. Plus que ses aïeux, la généalogie l’attestait. Les destins d’antan avaient été si brefs ! Et plus il vieillissait, moins il se sentait capable d’égorger ses vieilles poules ; plus son corps diminuait, moins il taillait les fleurs à l’agonie. Son jardin – sa terre – voyait s’épanouir une myriade de roses buissonnantes et pleureuses, dans un chaos de pétales. Du maçon de Fellini qui s’adressait au patron, dans Armacord, il savait la réplique : “Mon grand-père bâtissait des maisons, mon père bâtissait des maisons, je bâtis? Mais où elle est, ma maison ?” Mon père possédait la sienne, la première de l’arbre.
Il commençait à parler de sa mère : il ne l’avait jamais fait. Dès 3 ou 4 heures du matin, elle se tenait devant l’âtre, pour y jeter une brassée de bois, avant de se rendre au saloir et de préparer la soupe dans le pot de fonte. Puis elle se mettait à traire, à jeter le grain aux volailles avec un œil sur les couvées, s’occupait des enfants à peine levés avant de mener les vaches paître. Le lundi, elle descendait au marché, ses poules et ses canards à bout de bras. Avec l’argent, elle achetait de l’huile, du sucre, parfois des vêtements. Avant de retourner au foyer, pour ranger, lessiver, cuisiner. Le moment de la journée où elle s’autorisait à s’asseoir, c’était pour la veillée, quand elle raccommodait. Puis elle se couchait, exténuée.
Je profitais de la brèche qui s’ouvrait dans la mémoire paternelle pour aborder l’accident de ses parents. Je l’avais rejoint près des fraisiers, dans le fond du jardin. Il en taillait les gourmands. C’était le moment de lui annoncer :
— J’ai retrouvé sa trace, à Libourne.
Ce n’était pas facile à dire. J’avais la sensation de poser mon doigt sur l’œil d’un escargot. Il continua, stoïque, à couper les stolons. J’ajoutai :
— Elle est morte de ses blessures à l’hôpital, le jour de l’accident.
Il ne laissa rien paraître, comme à son habitude, mais je sentais le séisme majeur, dans son for intérieur. Alors je parlai un instant d’autre chose : du temps frais et humide, de ce vent qui grillait les feuilles du potager. Un étrange insecte piquait de son dard la terre qui entourait les poireaux. Les œufs deviendraient des larves, qui ne tarderaient pas à ronger leurs racines. Mais mon père releva la tête, il avait deviné que j’allais enfin trouver le courage de lui livrer la suite : le lieu où Osvaldo s’était rendu, après avoir suivi les gendarmes. Lorsque ce fut chose faite, j’ajoutai simplement :
— Il est mort quatre ans après Maria.
Mon père n’était pas prêt à perdre la face. Il me dit simplement, d’une voix malgré tout affectée :
— J’avais bien pensé à la prison?
Il baissa ensuite la tête, en répétant : “On ne nous disait rien?” »
Un morceau d’Italie (p. 129-132)
Halt ! Ausweis ! (p. 210-213)
Extrait court
« De sa fratrie, mon père était le seul à avoir quitté les rives de la Dordogne. En Aquitaine, les familles originaires d’Italie étaient nombreuses, mais elles se réduisaient à la portion congrue en pays d’Aunis. Il était arrivé ici avec pour passé son léger accent du Sud, prononçait toutes les lettres de tabac, prenait la paume pour la pomme, se méfiait des “e” muets. Un homme en voie de disparition : chacun de ses muscles s’était formé à l’école du travail bien fait, dans les gestes de l’artisan consciencieux, et même s’il capitalisait un immense savoir, il le dédaignait, de n’être pas écrit. Sa profession n’avait pas obtenu sa juste reconnaissance, il se définissait en “travailleur de force et par force”, amer. Pour parer au manque d’argent, il avait renoué avec le troc, en créant plus qu’en achetant, en dialoguant avec les matériaux de récupération. Diplômé en ingénierie de la débrouille, chaussé de vieilles bottes transformées en sabots de caoutchouc et vêtu d’un bleu de travail délavé, il avançait encore à pas sûrs à 80 ans. Dans sa démarche, il mêlait la noblesse du gitan à l’assurance du paysan, de sorte qu’aucun costume ne l’aurait habillé davantage. Son honnêteté, c’était sa journée de travail, du lever au coucher du soleil. Il désherbait à la main, plantait, en saison, pommes de terre, salades ou carottes, et possédait même quelques pieds de vigne. Il traitait les arbres fruitiers à la bouillie bordelaise, faisait son propre humus. Comme son père. C’était dans son jardin qu’il en parlait le mieux. Il n’avait qu’un luxe, annexé à sa liberté : ses fleurs. Roses, hortensias, pensées, et des iris multicolores. Chez ses parents, il n’y en avait pas, parce que ça ne se mangeait pas.
Sa science, il ne la transmettait pas. Le savoir, pour lui, se trouvait dans les livres. La vie les lui avait refusés, son travail nous les avait offerts. Des études, je n’avais rien appris ; il continuait à penser qu’entre les pages dormaient les secrets des alchimistes. Pourtant de son père il tenait la mesure, lorsqu’il plantait ou taillait en saison. Le savoir qu’il avait dans le sang ne se cristallisait pas dans les mots, mais dans les actes : il savait greffer un citronnier, enrichir sa terre ; il sentait dans les frémissements du jour l’approche du gel, l’intensité du soleil ou de lune à venir, d’où viendrait le vent encore endormi ; il maniait le soufre, le cuivre, le fer, pour empêcher la maladie de s’emparer de la vie, comme le généticien, le météorologue, ou le chimiste.
Malgré tout, il portait le poids des étiquettes collées aux “péquenots”. Ces hommes bien que riches de leur science demeuraient frustes, épais, incultes, dans l’imagerie populaire. Il fallait sans cesse relever la tête de mon père, enclin à se déprécier tout seul. Son passage dans le camp des ouvriers ne l’avait pas aidé à se valoriser. Taiseux, certes, le paysan l’était, encore plus s’il avait fait la guerre. Mais de là à le juger rustre, ou même sans élégance ; croire que son mutisme révélait une pensée grossière (que savions-nous des formes de vie plus silencieuses, était-ce d’en avoir conscience que nous les détruisons ?), que le bon sens – peu commun – lui était étranger ! Mon père aujourd’hui perpétuait la même gestuelle, mais sans une once de fierté.
Agenouillé, sur une planche ligotée de chiffons, il libérait les scaroles des tentacules du pourpier. En équilibre. Le monde pouvait bien s’écrouler, la bourse partir en fumée – était-elle autre chose ? –, lui saurait s’en sortir. Grâce à la terre. Il ne s’en était jamais coupé. Du temps où il était actif, en sus des heures de travail hebdomadaire, il occupait ses fins de journée avec 3 000 mètres carrés de potager – les jardins ouvriers de Bongraine. Pour avoir “le ventre plein”, ne plus jamais revivre les privations. De ses racines il tirait encore sa survie, surtout depuis l’annonce de son cancer. Il n’était allé vers les rayons qu’à contrecœur. Il serait parti avec la tumeur plutôt que d’être irradié. Il savait que sa longévité – et ce confort gras qui s’étalait partout – n’annonçait rien de bon pour la terre, dont on comptait les jours. Il était conscient d’avoir vécu autant que son père et sa mère réunis. Plus que ses aïeux, la généalogie l’attestait. Les destins d’antan avaient été si brefs ! Et plus il vieillissait, moins il se sentait capable d’égorger ses vieilles poules ; plus son corps diminuait, moins il taillait les fleurs à l’agonie. Son jardin – sa terre – voyait s’épanouir une myriade de roses buissonnantes et pleureuses, dans un chaos de pétales. Du maçon de Fellini qui s’adressait au patron, dans Armacord, il savait la réplique : “Mon grand-père bâtissait des maisons, mon père bâtissait des maisons, je bâtis? Mais où elle est, ma maison ?” Mon père possédait la sienne, la première de l’arbre.
Il commençait à parler de sa mère : il ne l’avait jamais fait. Dès 3 ou 4 heures du matin, elle se tenait devant l’âtre, pour y jeter une brassée de bois, avant de se rendre au saloir et de préparer la soupe dans le pot de fonte. Puis elle se mettait à traire, à jeter le grain aux volailles avec un œil sur les couvées, s’occupait des enfants à peine levés avant de mener les vaches paître. Le lundi, elle descendait au marché, ses poules et ses canards à bout de bras. Avec l’argent, elle achetait de l’huile, du sucre, parfois des vêtements. Avant de retourner au foyer, pour ranger, lessiver, cuisiner. Le moment de la journée où elle s’autorisait à s’asseoir, c’était pour la veillée, quand elle raccommodait. Puis elle se couchait, exténuée.
Je profitais de la brèche qui s’ouvrait dans la mémoire paternelle pour aborder l’accident de ses parents. Je l’avais rejoint près des fraisiers, dans le fond du jardin. Il en taillait les gourmands. C’était le moment de lui annoncer :
— J’ai retrouvé sa trace, à Libourne.
Ce n’était pas facile à dire. J’avais la sensation de poser mon doigt sur l’œil d’un escargot. Il continua, stoïque, à couper les stolons. J’ajoutai :
— Elle est morte de ses blessures à l’hôpital, le jour de l’accident.
Il ne laissa rien paraître, comme à son habitude, mais je sentais le séisme majeur, dans son for intérieur. Alors je parlai un instant d’autre chose : du temps frais et humide, de ce vent qui grillait les feuilles du potager. Un étrange insecte piquait de son dard la terre qui entourait les poireaux. Les œufs deviendraient des larves, qui ne tarderaient pas à ronger leurs racines. Mais mon père releva la tête, il avait deviné que j’allais enfin trouver le courage de lui livrer la suite : le lieu où Osvaldo s’était rendu, après avoir suivi les gendarmes. Lorsque ce fut chose faite, j’ajoutai simplement :
— Il est mort quatre ans après Maria.
Mon père n’était pas prêt à perdre la face. Il me dit simplement, d’une voix malgré tout affectée :
— J’avais bien pensé à la prison?
Il baissa ensuite la tête, en répétant : “On ne nous disait rien?” »
(p. 164-168)
Un morceau d’Italie (p. 129-132)
Halt ! Ausweis ! (p. 210-213)
Extrait court


