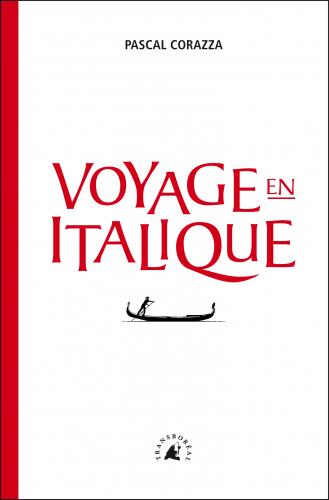
Un morceau d’Italie :
« Venise, dans sa pauvreté, ne me quittait plus. Sur les murs des ruelles étroites, je revoyais le visage de Roméo, la mémoire de Belfiore, mais aussi l’ombre du squelette voûté du général vénitien, ou encore le sourire d’Angelina, la mère si loyale. Je repensais à Rina et Anacleto, à jamais déracinés, tout comme j’enviais la force de Gianni et de Mario sur la hauteur des Alpes ; leurs mentalités semblaient si éloignées de la fourberie? Dans la Péninsule, on la justifiait par des siècles de soumission. Mais à la survie d’autrefois s’était substituée la plus moderne escroquerie, les boutures de la lagune en devenaient vigoureuses. Ma voisine maugréait Venezia ladrà à l’envi, et m’avait prévenu : l’étalage d’ostensibles panini sur le cours Garibaldi, ou les foccacie qui dégueulaient leurs ingrédients, tout cela empruntait au trompe-l’œil. Le restaurant ? Je repenserais ma méthode : j’ajouterais le montant du couvert et celui de l’eau. Le pire touchait d’ailleurs moins la table que l’hôtellerie : mars ou novembre étaient encore des mois de haute saison, le prix s’affichait à la tête du client. Sur la plage, dans les ruelles, au bar ou en soirée, il me faudrait toucher des yeux quand je croirais la peau accessible. Le bronzage, la nudité, il n’y aurait plus qu’à dévorer, tout deviendrait si facile ? Mais on ne faisait pas plus bigot, plus conservateur que les dames du Veneto. Les mâles attendaient l’arrivée des Nordiques, car à ces filles, ils ne promettaient rien. Un flirt avec les fleurs locales coûtait un patrimoine, il était plus malin de se le constituer : dans le taxi, l’étranger ferait deux fois le tour de la ville, et à l’épicerie il paierait une pomme pour le prix d’un kilo. S’il connaissait l’italien, s’il protestait ? Il ne restait plus qu’à se solidariser : la famille, les collègues, les voisins, se mettraient à parler plus fort que lui !
Plus au sud, néanmoins, les témoignages étaient formels pour affirmer l’honnêteté vénète, qualité, en plus d’un naturel généreux, qui définissait bien mon père. Dans sa bouche d’émigré, ça se traduisait par brave. Pour les Italiens, j’étais un bout du bravo parti, là-bas, un jour, de l’autre côté, revenu par hasard sur les seuils de la fierté de mes hôtes : la maison, dont l’étage marquait au moins le passage de deux générations. Ils m’avaient ouvert leurs portes avec méfiance, me régalant finalement de richesses que l’argent n’aurait pas pu m’offrir. Un frère de Roméo avait intégré la Légion, Donatella rêvait d’emmener sa mère en France, Rina y avait perdu son père, et Gianni, à l’heure de sa retraite, irait visiter cet oncle, parti vers l’Australie après la Seconde Guerre. Quant à moi, le Français, c’était sous le porche d’une ferme australienne que j’avais chiné mon premier morceau d’Italie. Là-bas, en 1967, le propriétaire des lieux, un vieux Calabrais, était devenu “aussie” contre un dollar symbolique. Il avait pris pour habitude de me donner des œufs, en douce, aux heures de la sieste ; il m’interdisait de fumer, dans son anglais roulé d’italien, qui me ramenait à ma tante Santina, à cet accent qui refuse d’abandonner sa terre. Sa femme, plus fragile que ma vieille tante, avait pourtant cédé au mal du pays. À sa mort, il s’était enchaîné aux cigarettes, chaque jour en maillons plus serrés. Puis la boisson, le diabète et la gangrène avaient emporté une autre moitié de son corps veuf. La prothèse qui grattait la poussière en témoignait. Une fois amputé, il s’était à nouveau laissé convaincre par la vie, pour élever Michael, Chris, Pepe, et bâtir à ses fils cet immense domaine. J’y travaillais. Douze dollars la caisse de 3 mètres cubes remplie en trois heures, pas un Australien sur les échelles à tâter les mamelles des orangers. À la fin de la journée, la bière faisait oublier qu’on ne gagnait rien ; on ne dépensait rien non plus. Autour, des fermes, à perte de vue. Il y avait bien le samedi soir pour aller s’abrutir de pintes au pub, et le dimanche, on allait se mêler aux courants de la rivière boueuse. Les berges avaient le goût des siestes insulaires, sur le tapis d’aiguilles, entre les fougères tièdes, où les pins bruissaient la mer. Là-bas, sous les grands eucalyptus, j’avais retrouvé le calme de cette image, celle d’un père expirant lentement une fatigue laborieuse, sa main estropiée reposant du côté de son cœur : l’index et le majeur emportés par la scie circulaire ; dans ses doigts tombés, prise au piège, son envie de fumer. Il ne touchait plus aux cigarettes dont je continuais à me délecter.
Pour le temps des vendanges, j’étais devenu un journalier sans visa, étranger et fauché, à traire les rangs pour 50 cents le baquet de cabernet. Et entre les fûts cartonnés de mauvais riesling, j’avais revu les visages de mon enfance : mes oncles Luigi, Giovanni, mes cousins Mario, Jean et Kaki, cheveux bruns et sourires charmeurs, réincarnés en ces fils d’immigrés venus des fermes alentour. Dès que j’apercevais le vieux Calabrais, sur son fauteuil en osier, je pensais à mon père : l’absence inscrite en ces corps meurtris avait cessé de les tourmenter ; mutilés, ils s’étaient réconciliés avec l’existence. Osvaldo, quant à lui, amputé de ses disparus – ses compagnons de guerre, puis ses parents décédés – n’avait fait qu’ajouter la perte d’un pays, l’absence d’un regard, sur sa douleur cachée. Il ne suffisait pas d’avoir survécu pour revenir à la vie : il y avait, comble du mystère et de l’injustice, une culpabilité, une honte, qui envahissait le survivant. Et ça n’était pas le moins lourd des fardeaux. Dans les champs de Gironde, il n’avait pas été possible à mon grand-père d’ouvrir une saignée, un canal libérateur. Juste des sillons creusés en silence, et des regards parfois hostiles comme ces épines d’oranger, qui n’avaient pas épargné les avant-bras de l’émigré clandestin dans la peau duquel je m’étais glissé. »
Mon père (p. 164-168)
Halt ! Ausweis ! (p. 210-213)
Extrait court
« Venise, dans sa pauvreté, ne me quittait plus. Sur les murs des ruelles étroites, je revoyais le visage de Roméo, la mémoire de Belfiore, mais aussi l’ombre du squelette voûté du général vénitien, ou encore le sourire d’Angelina, la mère si loyale. Je repensais à Rina et Anacleto, à jamais déracinés, tout comme j’enviais la force de Gianni et de Mario sur la hauteur des Alpes ; leurs mentalités semblaient si éloignées de la fourberie? Dans la Péninsule, on la justifiait par des siècles de soumission. Mais à la survie d’autrefois s’était substituée la plus moderne escroquerie, les boutures de la lagune en devenaient vigoureuses. Ma voisine maugréait Venezia ladrà à l’envi, et m’avait prévenu : l’étalage d’ostensibles panini sur le cours Garibaldi, ou les foccacie qui dégueulaient leurs ingrédients, tout cela empruntait au trompe-l’œil. Le restaurant ? Je repenserais ma méthode : j’ajouterais le montant du couvert et celui de l’eau. Le pire touchait d’ailleurs moins la table que l’hôtellerie : mars ou novembre étaient encore des mois de haute saison, le prix s’affichait à la tête du client. Sur la plage, dans les ruelles, au bar ou en soirée, il me faudrait toucher des yeux quand je croirais la peau accessible. Le bronzage, la nudité, il n’y aurait plus qu’à dévorer, tout deviendrait si facile ? Mais on ne faisait pas plus bigot, plus conservateur que les dames du Veneto. Les mâles attendaient l’arrivée des Nordiques, car à ces filles, ils ne promettaient rien. Un flirt avec les fleurs locales coûtait un patrimoine, il était plus malin de se le constituer : dans le taxi, l’étranger ferait deux fois le tour de la ville, et à l’épicerie il paierait une pomme pour le prix d’un kilo. S’il connaissait l’italien, s’il protestait ? Il ne restait plus qu’à se solidariser : la famille, les collègues, les voisins, se mettraient à parler plus fort que lui !
Plus au sud, néanmoins, les témoignages étaient formels pour affirmer l’honnêteté vénète, qualité, en plus d’un naturel généreux, qui définissait bien mon père. Dans sa bouche d’émigré, ça se traduisait par brave. Pour les Italiens, j’étais un bout du bravo parti, là-bas, un jour, de l’autre côté, revenu par hasard sur les seuils de la fierté de mes hôtes : la maison, dont l’étage marquait au moins le passage de deux générations. Ils m’avaient ouvert leurs portes avec méfiance, me régalant finalement de richesses que l’argent n’aurait pas pu m’offrir. Un frère de Roméo avait intégré la Légion, Donatella rêvait d’emmener sa mère en France, Rina y avait perdu son père, et Gianni, à l’heure de sa retraite, irait visiter cet oncle, parti vers l’Australie après la Seconde Guerre. Quant à moi, le Français, c’était sous le porche d’une ferme australienne que j’avais chiné mon premier morceau d’Italie. Là-bas, en 1967, le propriétaire des lieux, un vieux Calabrais, était devenu “aussie” contre un dollar symbolique. Il avait pris pour habitude de me donner des œufs, en douce, aux heures de la sieste ; il m’interdisait de fumer, dans son anglais roulé d’italien, qui me ramenait à ma tante Santina, à cet accent qui refuse d’abandonner sa terre. Sa femme, plus fragile que ma vieille tante, avait pourtant cédé au mal du pays. À sa mort, il s’était enchaîné aux cigarettes, chaque jour en maillons plus serrés. Puis la boisson, le diabète et la gangrène avaient emporté une autre moitié de son corps veuf. La prothèse qui grattait la poussière en témoignait. Une fois amputé, il s’était à nouveau laissé convaincre par la vie, pour élever Michael, Chris, Pepe, et bâtir à ses fils cet immense domaine. J’y travaillais. Douze dollars la caisse de 3 mètres cubes remplie en trois heures, pas un Australien sur les échelles à tâter les mamelles des orangers. À la fin de la journée, la bière faisait oublier qu’on ne gagnait rien ; on ne dépensait rien non plus. Autour, des fermes, à perte de vue. Il y avait bien le samedi soir pour aller s’abrutir de pintes au pub, et le dimanche, on allait se mêler aux courants de la rivière boueuse. Les berges avaient le goût des siestes insulaires, sur le tapis d’aiguilles, entre les fougères tièdes, où les pins bruissaient la mer. Là-bas, sous les grands eucalyptus, j’avais retrouvé le calme de cette image, celle d’un père expirant lentement une fatigue laborieuse, sa main estropiée reposant du côté de son cœur : l’index et le majeur emportés par la scie circulaire ; dans ses doigts tombés, prise au piège, son envie de fumer. Il ne touchait plus aux cigarettes dont je continuais à me délecter.
Pour le temps des vendanges, j’étais devenu un journalier sans visa, étranger et fauché, à traire les rangs pour 50 cents le baquet de cabernet. Et entre les fûts cartonnés de mauvais riesling, j’avais revu les visages de mon enfance : mes oncles Luigi, Giovanni, mes cousins Mario, Jean et Kaki, cheveux bruns et sourires charmeurs, réincarnés en ces fils d’immigrés venus des fermes alentour. Dès que j’apercevais le vieux Calabrais, sur son fauteuil en osier, je pensais à mon père : l’absence inscrite en ces corps meurtris avait cessé de les tourmenter ; mutilés, ils s’étaient réconciliés avec l’existence. Osvaldo, quant à lui, amputé de ses disparus – ses compagnons de guerre, puis ses parents décédés – n’avait fait qu’ajouter la perte d’un pays, l’absence d’un regard, sur sa douleur cachée. Il ne suffisait pas d’avoir survécu pour revenir à la vie : il y avait, comble du mystère et de l’injustice, une culpabilité, une honte, qui envahissait le survivant. Et ça n’était pas le moins lourd des fardeaux. Dans les champs de Gironde, il n’avait pas été possible à mon grand-père d’ouvrir une saignée, un canal libérateur. Juste des sillons creusés en silence, et des regards parfois hostiles comme ces épines d’oranger, qui n’avaient pas épargné les avant-bras de l’émigré clandestin dans la peau duquel je m’étais glissé. »
(p. 129-132)
Mon père (p. 164-168)
Halt ! Ausweis ! (p. 210-213)
Extrait court


