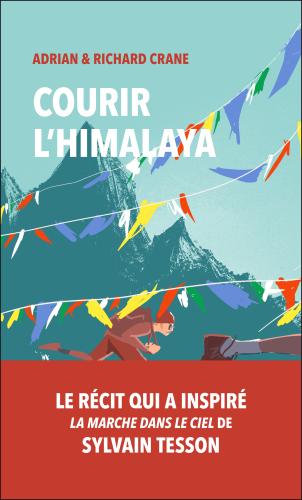
Courir l’Himalaya
Adrian Crane & Richard Crane
À moins de 30 ans, les frères Adrian et Richard Crane se sont lancé un défi : traverser l’Himalaya d’est en ouest, de Darjeeling en Inde à Rawalpindi au Pakistan, en cent jours. Deux décennies avant l’avènement du trail, ils vont courir plus de 3 000 kilomètres, cumulant 90 000 mètres de dénivelé, dont un aller-retour au camp de base de l’Everest. Avec leur allure de clochards célestes, les deux Britanniques doublent tous les 8 000, et marquent les esprits. Des jungles aux cols d’altitude du Népal, de l’agitation de Katmandou au silence des vallées du Zanskar, ils improvisent, et rien ne semble les arrêter. Les équipements techniques n’existaient pas et cela rend la traversée encore plus belle. La fatigue favorise les disputes, les tensions ne manquent pas, mais l’humour, toujours, les sauve. Une aventure sportive et fondatrice pour tous les traileurs.
Traduit de l’anglais par : Julien Gilleron
Avec une préface par : Sylvain Tesson
« À l’été 1983, les frères Crane, jeunes sujets de la reine d’Angleterre, Adrian et Richard de leurs prénoms, épris de grand air (ce sont des fidèles du mountaineering anglais), pas encore arrivés à la trentaine, traversent la chaîne himalayenne d’est en ouest à petites foulées, vêtus d’un anorak de pluie et chargés de 4 kilos de matériel. Leur seule arme : ce détachement moral, mélange de désinvolture d’esprit et de force d’âme qui, sous la pluie, semble toujours protéger le Britannique du désespoir métaphysique et de l’angine de poitrine. Autre qualité : habitués depuis leur enfance à la gastronomie et la météorologie anglaises, rien ne saurait les abattre sur le chemin.
Partis de Darjeeling, les deux Crane, maigres comme des clous et passablement hirsutes, arrivent à Rawalpindi trois mois plus tard. Frappant le soir à la porte des masures de bergers, se nourrissant de galettes d’orge récoltées çà et là ou monnayées aux paysans de rencontre, ils ont traversé tour à tour le Bengale de l’Ouest, le Népal (dans son intégralité), l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh, et les deux parties du Cachemire indien et pakistanais. Expédions les statistiques. Elles ne signifient rien. Une fois débarrassé des chiffres, on peut passer aux choses sérieuses. Ils trottèrent pendant 101 jours sur une distance de plus de 3 200 kilomètres et cumulèrent un dénivelé positif de quelque 91 kilomètres. Leur aventure constituait une première historique. Ils ont tiré de leur haute course un récit écrit à sauts et à gambades (hommage à Montaigne). Vous le tenez entre les mains. L’aventure des Crane marie à la fois l’esprit des commandos britanniques – infiltration rapide au cœur de territoires – et la mystique des yogis hindous – dissolution de l’être dans l’effort, le renoncement et l’épuisement. Les frères Crane semblent toujours prêts à affronter la promesse churchillienne à peine transformée (celle qui a conduit un peuple entier à supporter le pire – l’air de rien) : “des sangsues, de la sueur et des larmes”.
On peut lire Courir l’Himalaya comme le compte-rendu technique du plus haut marathon du monde. Mais il y a plus. Et d’abord une très belle histoire de transmission familiale. Voilà deux petits garçons emmenés en randonnée par leur père : ils s’éveillent à la montagne dans les rudes conditions des hills écossais, jusqu’aux incursions sur les sommets de l’île de Skye. Les Crane ne rêvent dès lors qu’à une seule chose : frapper un grand coup, réaliser un exploit qui laissera une trace dans l’histoire de l’exploration. Ils achèvent leurs études, et forgent l’idée de traverser l’Himalaya en courant. Ils iront au plus difficile. Ils seront les plus rapides. On se souviendra des frères Crane comme du slogan de Coubertin : plus haut, plus vite, plus fort.
Dans mon petit panthéon, j’ai toujours eu un faible pour les fratries. Dans les Arts et les Lettres, la collaboration entre membres d’une même portée humaine semble toujours multiplier les avantages. Les liens de l’enfance, du sang, du souvenir et de l’affection permettent d’aller au plus direct, de s’épargner bien des explications et de travailler efficacement. Jugez-en : il y a les sœurs Andrews pour le music-hall, Delphine et Marinette pour l’esprit d’enfance, les frères Coen pour le cinéma, les sœurs Brontë pour l’angoisse, les Grimm pour la littérature, les Humboldt pour la science, les Jünger pour la philosophie et les sœurs Labèque pour le piano. Voilà que mon énumération s’augmente d’une belle paire : pour l’aventure s’avancent les frères Crane. Je les appellerai par souci de concision et pour user de périphrases à destination des jeunes générations : les frères Karamazov de la cabriole.
Je m’étais juré quand j’ai écrit ma première préface, il y a trente ans, d’éviter de parler de moi. J’ai toujours tenu en horreur ces plumitifs qui, chargés de préfacer un livre, s’empressent de raconter leurs souvenirs. On lit des choses de ce genre : “Je me souviens du jour où je disais au professeur X, etc.” Les trissotins se servent du livre (qu’ils sont censés éclairer de leur préface) comme d’un piédestal pour jucher leur propre petite statue (de plâtre).
Hélas, je vais contrevenir à mon serment, verser dans le ridicule et raconter un souvenir. J’espère que les frères Crane me le pardonneront. J’ai découvert leur livre Running the Himalayas dans une librairie du Thamel, à Katmandou, où je me promenais avec Alexandre Poussin lors d’une randonnée à bicyclette à travers le Népal, il y a plus de trente ans. C’était l’édition anglaise illustrée de 1984 (à couverture rigide) de la New English Library. Elle coûtait 100 roupies et sur le rabat de couverture était inscrit UK only (expression protectionniste typiquement britannique). On voyait sur la jaquette deux spectres en haillons détalant comme des dératés au pied d’un sommet himalayen. Que fuyaient-ils ? Leur ombre ? Leur conscience ? Une manœuvre de l’armée française ? Tâchaient-ils d’être à l’heure au five o’clock tea ? J’eus beaucoup de mal à venir à bout de l’excellent récit car mon niveau d’anglais, malgré le renouvellement annuel de mes abonnements au magazine Mad, me permettait à peine de traduire “on” et “off” sur un interrupteur.
Nous fûmes proprement fascinés, Poussin et moi, par cette course éperdue qui tenait à la fois du pèlerinage de clochards célestes et de l’exploit initiatique de cœurs aventureux.
Les frères Crane nous inspirèrent notre propre itinéraire à pied à travers l’Himalaya, à Poussin et moi. Près de quinze ans après, nous reprîmes leurs traces et partîmes cavaler dans le plus simple appareil à travers les Himalayas, comme eux, pensant à eux, dans le même sens qu’eux : d’est en ouest. C’était la preuve que les récits d’aventure ont souvent pour fonction de déclencher des envies absurdes chez de gentils jeunes gens bien élevés qui n’auraient jamais éprouvé les secondes s’ils n’avaient pas lu les premiers.
Quelques années après, alors que je me rendais à Londres à bicyclette, je croisais un voyageur à vélo à bord du ferry-boat qui relie Dieppe à Brighton. Nous liâmes connaissance. Il me dit son nom : Richard Crane. “Comme le type qui a traversé l’Himalaya en courant ?” demandai-je. Il n’en revenait pas que je l’identifiasse. Nous partageâmes un fish & chips (sorte d’abomination en forme d’éponge trempée dans l’huile de moteur et l’encre de journal) sur les quais du port de Brighton et nous nous quittâmes, convaincus de l’idée que je viens d’énoncer plus haut : la longue chaîne de transmission de l’esprit d’aventure ne se rompra jamais, les uns inspirant les autres et ceux-là rendant hommage à ceux-ci en répétant leurs idées pionnières.
Des nombreuses joies que m’a procurées la lecture du récit des frères Crane, le fait que sir John Hunt ait préfacé l’ouvrage n’est pas la moindre. Non seulement parce qu’elle est amicalement élogieuse mais parce que le simple fait que ce soit lui, le grand manitou des affaires himalayennes anglaises, lui le tombeur de l’Everest en 1953, lui héros de la guerre et aristocrate lourdement décoré, lui qui se fende d’un compliment introductif, éclaire d’une manière significative la portée du livre des Crane brothers.
Il convient de se livrer à un court rappel pour replacer l’aventure des Karamazov à semelles de crêpe dans son contexte historique.
En 1953, sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers hommes à atteindre le sommet de l’Everest. Ils font partie de l’expédition du général Hunt. Les alpinistes de cette époque raisonnent en militaires. Ils voient leur activité à travers l’œil de Clausewitz : continuation de la guerre par d’autres moyens. Grâce à Maurice Herzog sur l’Annapurna trois ans avant l’Everest, les Français se sont revanchés de l’humiliation de mai 1940 en prouvant au monde qu’ils pouvaient être les premiers à faire tomber un sommet de 8 000 mètres. On grimpe à cette époque comme on mène l’assaut. Même l’organisation sportive emprunte à la tactique opérationnelle : camps avancés, colonnes de porteurs, reconnaissance d’éclaireurs, chaîne d’approvisionnement industriel, effort financier national et, pour finir, assaut final de la cordée de tête. Une fois là-haut, Tenzing Norgay et Edmund Hillary ne se préoccupent pas de leur “ressenti” personnel, hideuse tarte à la crème de notre époque. Ils offrent le sommet à la Couronne. Ils opèrent pour la grandeur de quelque chose qui n’est pas eux-mêmes.
Or, trente ans plus tard, voilà deux jeunes frères anglais qui se glissent au camp de base en chaussures de jogging munis d’un sac plus petit qu’une bouteille à oxygène. Ils parcourent l’Himalaya comme Perrette avec son pot au lait : légers et court vêtus. Il faut se représenter le fossé culturel, mental, moral, presque mythologique qui sépare ces deux aventures himalayennes. D’un côté l’armée en marche, avec son fourniment. De l’autre deux beatniks faisant les cabris dans la moraine. Dans son approche de la montagne, Hunt est plus proche d’Hannibal sur le mont Cenis que des frères Crane. Certes l’enjeu n’est pas le même. John Hunt visait l’Everest. Les Karamazov du collant de nylon se contentent de passer au pied des géants de 8 000 mètres. Mais la différence logistique exprime à elle seule l’évolution historique de l’alpinisme entre les années 1950 et 1980. Mieux ! elle reflète l’évolution globale de la société. Car depuis 1950, glorieuses ou pas, les années ont initié un mouvement général de la mentalité occidentale vers le léger, le rapide, le fluide. En 1950, on rêve encore de planter le drapeau de la conquête au sommet des monts inexplorés. En 1980, on essaie de ne pas laisser de trace en accélérant la cadence. “Vive la reine !” pense Hillary. “Vive moi !” dit l’alpiniste 2.0. La société du XXIe siècle croit en ce qui est rapide, fluctuant, mobile, transitoire, éphémère et fugace. Tout se meut, rien n’est fixe. Le conteneur, les idées et les hommes doivent circuler puisque la Terre est un rond-point et l’Histoire une métamorphose perpétuelle. En bref, notre époque tient davantage du jogging perpétuel que du long labeur sur la pente. L’aventure des Crane, dans le domaine très spécifique de l’aventure, illustre cette nouvelle orchestration du monde. Courir l’Himalaya est un symptôme parfait du Zeitgeist héraclitéen de notre temps : on passe, on coule, on s’efface. Sur la grand-place du marché global, qui se fixe meurt. En short dans la montagne, qui s’arrête gèle. Régis Debray a beaucoup médité sur la fin de l’Histoire et l’effacement des références temporelles devant le primat de la géographie. De livre en livre, il a montré que l’homme européen au bord de la dépression nerveuse ne veut plus s’inscrire dans la durée. Il préfère glisser sur les surfaces. Les Crane s’inscrivent dans ce triomphe du perpetuum mobile sur les humanités classiques.
En bref, les frères Crane à la course, c’est l’esprit de l’Histoire en marche.
Comme tout prophète en son pays ils se sont heurtés aux sarcasmes de leurs contemporains avant de réussir leur défi. Ils furent des précurseurs. Au départ, on donna leur projet pour perdu d’avance. Ils partirent, on ricana. Ils réussirent, on les célébra. Leur méthode a fait florès. Aujourd’hui les troupes de l’ultra trail ruissellent sur les pentes du mont Blanc et tout le monde fait de la course à pied à la ville comme aux champs. Kílian Jornet fait rêver les nouvelles générations et la statue de Maurice Herzog a été déboulonnée. On part en montagne les yeux sur le chronomètre et Frison-Roche est rangé au rang des antiquailleries.
Tout mouvement de société a toujours ses ambassadeurs.
Trente ans trop tôt, ils ouvrent une voie.
Un jour, leur prescience est devenue l’ordinaire. Voilà pourquoi Courir l’Himalaya est plus qu’un journal d’hommes pressés, d’Anglais fantasques et de sportifs inconscients. C’est un livre qui dit beaucoup de choses sur l’évolution de la psyché européenne à la fin du XXe siècle.
Et, cerise on the cake, c’est un sacré récit d’aventure, by Jove ! »
Avec une introduction par : sir John Hunt
« Ceci est le récit d’une prouesse d’audace et de ténacité accomplie par deux jeunes gens remarquables. Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils ont enduré durant leur course à travers la chaîne des plus hautes montagnes du monde – sur une distance de 3 200 kilomètres – en cent un jours. En m’appuyant sur mes nombreuses années de voyage dans l’Himalaya et ayant rencontré moi-même, à une moindre échelle, les épreuves qu’ils ont surmontées, je voudrais donner une idée de l’ampleur de leur réalisation. Il y a quarante-quatre ans, ma femme et moi avons effectué une “marche forcée” depuis un camp de base sous le Kangchenjunga jusqu’à Darjeeling (110 kilomètres en quarante-huit heures), après que j’ai reçu l’ordre urgent de me présenter pour servir en Europe au début de la dernière guerre. Nous sommes arrivés dans un état d’épuisement avancé, après avoir parcouru 55 kilomètres par jour sur une portion de terrain à peine représentative de ce qu’Adrian et Richard Crane ont traversé. L’idée de poursuivre notre voyage ne serait-ce qu’un jour de plus – sans évoquer la possibilité de faire quatre-vingt-dix-neuf autres étapes – aurait été aussi effroyable qu’inconcevable.
Si je préfère désormais profiter plus sereinement des cimes majestueuses de l’Himalaya, de leurs décors stupéfiants, de leurs peuples attachants et des défis qu’elles offrent, même aux personnes âgées, je tiens néanmoins à saluer les frères Crane pour leur ténacité et leur courage. Je conseille la lecture de leur livre, non seulement parce qu’il contient des descriptions évocatrices des réalités de la souffrance humaine, mais aussi parce que, malgré les douleurs et les peines, il parvient à saisir magnifiquement ces montagnes merveilleuses et les gens qui y vivent. Je le recommande d’autant plus que leur aventure exceptionnelle avait notamment pour objectif de réduire les lourds fardeaux et les handicaps qui font partie du quotidien dans les hautes terres de l’Himalaya. »
Avec une postface par : Adrian Crane
« Quarante ans se sont écoulés depuis notre dernière grande aventure. Ou plutôt, devrions-nous dire, notre première grande aventure, car nous en avons vécu l’un et l’autre beaucoup d’autres dans les années qui ont suivi. Assez étrangement, si nous avons chacun eu une vie bien remplie depuis lors, nos expéditions nous ont rarement réunis.
Je suis rapidement parti m’installer aux États-Unis pour épouser Karen, ma petite amie de l’époque, et élever nos deux garçons, Johnathan et Christopher. Richard a vécu avec Michèle et leurs trois enfants, Thomas, Ella et Mathilde, entre la France et l’Angleterre. Peut-être l’endurance requise pour venir à bout d’un si grand défi s’est-elle retrouvée dans les relations que nous avons construites, car nous avons traversé vents et marées, sans l’ombre d’un regret.
Au fil des années, mon frère et moi avons souvent discuté de l’impact que notre traversée de l’Himalaya avait eu sur nos vies. Loin d’être, comme nous l’avions imaginé au départ, l’aventure qui mettrait un point final à toutes les autres, elle a modelé nos existences dans les décennies qui ont suivi : si c’est possible, faisons-le, et si c’est impossible, essayons. Nous avions prévu que cette expédition nous pousse dans nos retranchements et nous anéantisse, en même temps qu’elle nous libère et nous apaise pour le restant de nos vies, conscients d’avoir atteint nos limites. Mais à la fin de la traversée, nous étions face à la même incertitude quant à la distance que nous étions capables de parcourir. Après quelque temps, des années sans doute, nous nous sommes rendu compte que notre épopée nous avait libérés autrement, en nous prouvant à tous deux que nous étions libres de tout tenter.
Grâce, entre autres, à nos efforts et à notre entraînement en altitude, Richard a remporté le premier Fosters’ Quadrathlon en 16 heures, 26 minutes et 49 secondes : 3,2 kilomètres de natation, 50 kilomètres de marche sportive/ultrafond, 160 kilomètres de vélo et un marathon complet de 42 kilomètres pour finir ! À la suite duquel il s’est fait adouber “l’homme le plus sportif du monde” (les Anglais n’ont jamais froid aux yeux quand il s’agit de revendiquer un titre). Pour ma part, j’ai couru des ultramarathons de 160 kilomètres et j’ai décroché un record pour avoir gravi tous les sommets de plus de 14 000 pieds du Colorado en marchant, courant et grimpant sans interruption pendant quinze jours.
Toutes ces prouesses, et bien d’autres encore, ont été rendues possibles par une ouverture d’esprit toujours tournée vers de nouvelles possibilités. Notre traversée de l’Himalaya nous a donné confiance en nous en même temps qu’elle nous a apporté la certitude que nous pouvions aller plus loin que ce que nous croyions au départ. Il se peut aussi qu’il soit plus facile, après une réussite, d’appréhender l’échec. C’est un risque qu’a en tête tout un chacun en se lançant à l’aventure et qui peut conduire à baisser les bras si on lui accorde trop d’importance.
Notre traversée de l’Himalaya semble avoir incité de nombreuses personnes à se lancer dans leurs propres défis. Peut-être même peut-elle être considérée comme un projet précurseur dans le mouvement du “fastpacking”, une forme de trekking innovante qui consiste à se déplacer rapidement avec un sac léger. Se plonger dans un défi physique en pleine nature est un chemin qui peut permettre de trouver la paix intérieure et un certain équilibre de vie lors du retour à la civilisation. Conscient des récompenses durement acquises qu’offrent les challenges sportifs de plein air, Richard (après quelques années de travail pour British Petroleum en tant que géologue d’exploration), pendant les années 1990, a créé la Mobile Expedition Unit (MOBEX) de Londres. Cette initiative, en partenariat avec le Sport’s Council, a initié un grand nombre de jeunes des quartiers défavorisés aux sports de pleine nature. J’ai participé aux premières courses en milieu naturel (Alaska Mountain, Wilderness Classic, Death Valley to Mount Whitney, etc.), et nous avons couru ensemble des raids de plusieurs jours (entre autres le Raid Gauloises et l’Eco Challenge) pour promouvoir la course d’aventure en tant que sport. Si nous avons pu en inciter certains à s’adonner aux activités de plein air, c’est que nous avons légué une véritable contribution.
Richard est parti trop jeune, à l’âge de 66 ans, à la suite d’un accident de vélo sur un sentier escarpé à un kilomètre de chez lui. Mais ce livre nous rappelle que la mort, comme l’écrivait J. M. Barrie au sujet de Peter Pan, est, elle aussi, une terriblement grande aventure. »


