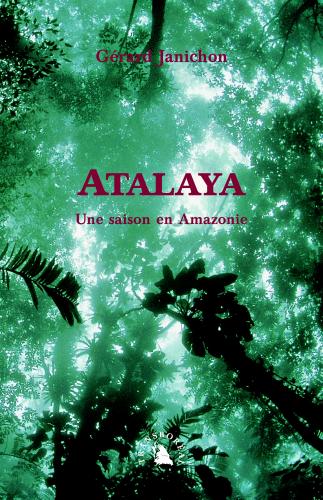
Francesca et l’œil du boto :
« Une demi-heure et quelques histoires terrifiantes de serpents plus tard, nous débouchons sur un étang que nous remontons lentement. Après la fraîcheur humide de la forêt, la chaleur nous accable et je suis immédiatement couvert de sueur. Grand-Père se rapproche silencieusement d’une berge en nous désignant certains oiseaux aquatiques et des échassiers, si figés qu’on peut se demander s’ils sont réels. Il s’agit de socós, de japuíras et d’anambés, au magnifique panache noir, à peine effrayés par notre venue.
Nous abandonnons la pirogue et, avant que nous ayons atteint la lisière de la forêt, des clameurs d’enfants nous parviennent. Grand-Père pousse son cri habituel de ralliement, auquel répondent de multiples échos enjoués. Ils nous guident jusqu’aux habitations où vit l’oncle de Francesca, avec ses deux femmes et sa famille d’une dizaine de personnes au total. Le sitío, propriété disposée à la manière d’une maloca indienne, est coquet. Notre arrivée est fêtée. Elle a été annoncée, aussi les enfants trépignent-ils autour de moi en criant “Doutor, Doutor?” Je leur distribue des friandises et une cuillerée du sirop dont ils raffolent. J’offre de menus cadeaux aux parents, quelques vêtements et des boîtes de lait. Après nous être désaltérés avec de l’eau fraîche, on nous propose de goûter au café local. Les femmes s’en retournent alors au travail, après avoir brièvement bavardé avec leur nièce.
À part la toux des enfants, rien de grave. Grand-Père me confirme que personne n’est malade ou ne sollicite de soins. Cette nouvelle me rassure car, à chaque visite, j’appréhende de tomber sur un cas. En revanche, dans un autre sitío à une heure de marche, un enfant se serait entaillé le bras sur une liane coupante. Nous ne pouvons nous attarder si nous voulons faire le détour et rentrer avant la nuit. Au moment de prendre congé, Francesca me dit que son oncle s’est permis de monter à bord de notre bateau hier, durant notre absence. Alors qu’il pêchait non loin de là, il a aperçu l’un de nos singes qui gagnait la forêt sur une touffe de roseaux et de nénuphars à la dérive. Il l’a attrapé et rapporté à bord. Il en a profité pour nous déposer un ananas en guise de salut. Je le remercie chaleureusement. À lui seul, il déjoue le pronostic de tous ceux qui nous prédisaient le pillage et les vols, sitôt que nous aurions le dos tourné. Le bateau n’est jamais fermé durant nos absences et je me sens plus en sécurité ici que dans n’importe quel port. Nous faisons nos adieux. Les enfants nous accompagnent dans la forêt durant une centaine de mètres puis s’en retournent en s’interpellant bruyamment. On croirait les clameurs lointaines d’une cour de récréation, n’importe où dans le monde. Mais c’est dans la selva, et ces cris, auxquels se mêlent les imitations spontanées des perroquets et des aras invisibles dans les hauts feuillages, paraissent plutôt incongrus !
Par endroits, la forêt est dense. Grand-Père ouvre le chemin à grands coups de machette et progresse d’un pas ferme. Je le suis de près, écartant autant que possible les branchages, les lianes et les fougères pour Francesca qui me suit. Tout à l’heure, nous crevions de chaud. À présent, la selva est si épaisse et si fraîche que nous frissonnons. L’humidité ruisselle de partout. Sur nos corps, elle a remplacé la sueur et nous glace les os. Par endroits, nous ne marchons plus sur de la terre mais sur un tapis spongieux, parfois si mou qu’on a l’impression qu’il va nous engloutir. Je n’ignore pas que ce riche humus grouille d’une vie microscopique et microbienne intense, avec des parasites plus dangereux que les onças, les jaguars réputés comme les fauves les plus cruels de la forêt et véritables maîtres des lieux. Les poux, les tiques, les vers, les mouches, les araignées, les scolopendres (ciens), les fourmis rouges ou les fourmis-tueuses, tous les carrapatos, baratas ou carapanás – comme les appelle Grand-Père –, visibles ou invisibles, pullulent dans ces zones où alternent marécages peu profonds et terre séchée. Toutes ces colonies d’insectes sont des vampires avides, prêts à piquer, à pénétrer la peau, à sucer le sang et, parfois, à donner la mort plus sûrement que les serpents, toujours pressés de fuir plutôt que d’attaquer.
Comme Grand-Père, je suis en short et pieds nus. Ni l’un ni l’autre nous ne possédons de tenue de brousse adaptée. Ma peau fragile d’Européen est lacérée par de petites coupures, griffures, écorchures. Mais je suis formidablement heureux. Je ne suis cependant pas stupide et ai désormais compris que l’Enfer vert n’a pas usurpé son nom. Il peut facilement se révéler atroce ou fatal. L’Amazonie coupe, pique, mord, déchiquette, ronge, envenime, infecte et pourrit celui qui se croit le plus fort. L’Amazonie est voluptueuse mais triomphante, l’Amazonie est prodigue mais sanguinaire, elle est la victoire végétale et la victoire animale de la nature sur l’homme. L’exubérante Amazone est l’avènement de l’eau et de l’infiniment vert, et leurs pouvoirs surpassent ceux des hommes. Grand-Père a raison, le monde que j’ai connu pèse peu face à ce monde-là. Il est évident que les hommes qui habitent cet univers ont développé un savoir en harmonie avec tous les esprits de leur nature. Sinon, ils auraient disparu depuis longtemps car l’eau et la selva, qui leur offrent si généreusement la vie, leur proposent aussi la mort à chaque pas. Un jour où j’évoquerai ce sujet avec Grand-Père Atalaya, celui-ci me dira :
— Les premiers hommes à vivre ici, tout au début, étaient les esprits eux-mêmes. Ils se multiplièrent car il importait qu’ils soient aussi nombreux que les animaux. Leurs premiers descendants avaient encore le feu originel des esprits qui vivait en eux. Seuls les plus faibles mouraient, ou bien un esprit mauvais les tuait. Mais au fil du temps et des descendances, certains ont oublié qui ils étaient. D’autres s’en sont souvenus assez pour survivre, transmettre les rites et le savoir, mais sans comprendre. Quelques-uns ont profité de l’ignorance pour inventer la duperie, la supercherie magique et se parer ainsi de faux pouvoirs. Comme l’harmonie était rompue, certaines tribus sont devenues très belliqueuses soit envers les autres, soit à l’intérieur d’elles-mêmes. Le meurtre et la vengeance sont devenus coutumiers de ces ethnies-là. Mais toujours, ce sont les esprits qui gagnent et survivent aux chamboulements et au chaos? »
Grand-Père Atalaya (p. 48-50)
Les petites vérités (p. 196-199)
Extrait court
« Une demi-heure et quelques histoires terrifiantes de serpents plus tard, nous débouchons sur un étang que nous remontons lentement. Après la fraîcheur humide de la forêt, la chaleur nous accable et je suis immédiatement couvert de sueur. Grand-Père se rapproche silencieusement d’une berge en nous désignant certains oiseaux aquatiques et des échassiers, si figés qu’on peut se demander s’ils sont réels. Il s’agit de socós, de japuíras et d’anambés, au magnifique panache noir, à peine effrayés par notre venue.
Nous abandonnons la pirogue et, avant que nous ayons atteint la lisière de la forêt, des clameurs d’enfants nous parviennent. Grand-Père pousse son cri habituel de ralliement, auquel répondent de multiples échos enjoués. Ils nous guident jusqu’aux habitations où vit l’oncle de Francesca, avec ses deux femmes et sa famille d’une dizaine de personnes au total. Le sitío, propriété disposée à la manière d’une maloca indienne, est coquet. Notre arrivée est fêtée. Elle a été annoncée, aussi les enfants trépignent-ils autour de moi en criant “Doutor, Doutor?” Je leur distribue des friandises et une cuillerée du sirop dont ils raffolent. J’offre de menus cadeaux aux parents, quelques vêtements et des boîtes de lait. Après nous être désaltérés avec de l’eau fraîche, on nous propose de goûter au café local. Les femmes s’en retournent alors au travail, après avoir brièvement bavardé avec leur nièce.
À part la toux des enfants, rien de grave. Grand-Père me confirme que personne n’est malade ou ne sollicite de soins. Cette nouvelle me rassure car, à chaque visite, j’appréhende de tomber sur un cas. En revanche, dans un autre sitío à une heure de marche, un enfant se serait entaillé le bras sur une liane coupante. Nous ne pouvons nous attarder si nous voulons faire le détour et rentrer avant la nuit. Au moment de prendre congé, Francesca me dit que son oncle s’est permis de monter à bord de notre bateau hier, durant notre absence. Alors qu’il pêchait non loin de là, il a aperçu l’un de nos singes qui gagnait la forêt sur une touffe de roseaux et de nénuphars à la dérive. Il l’a attrapé et rapporté à bord. Il en a profité pour nous déposer un ananas en guise de salut. Je le remercie chaleureusement. À lui seul, il déjoue le pronostic de tous ceux qui nous prédisaient le pillage et les vols, sitôt que nous aurions le dos tourné. Le bateau n’est jamais fermé durant nos absences et je me sens plus en sécurité ici que dans n’importe quel port. Nous faisons nos adieux. Les enfants nous accompagnent dans la forêt durant une centaine de mètres puis s’en retournent en s’interpellant bruyamment. On croirait les clameurs lointaines d’une cour de récréation, n’importe où dans le monde. Mais c’est dans la selva, et ces cris, auxquels se mêlent les imitations spontanées des perroquets et des aras invisibles dans les hauts feuillages, paraissent plutôt incongrus !
Par endroits, la forêt est dense. Grand-Père ouvre le chemin à grands coups de machette et progresse d’un pas ferme. Je le suis de près, écartant autant que possible les branchages, les lianes et les fougères pour Francesca qui me suit. Tout à l’heure, nous crevions de chaud. À présent, la selva est si épaisse et si fraîche que nous frissonnons. L’humidité ruisselle de partout. Sur nos corps, elle a remplacé la sueur et nous glace les os. Par endroits, nous ne marchons plus sur de la terre mais sur un tapis spongieux, parfois si mou qu’on a l’impression qu’il va nous engloutir. Je n’ignore pas que ce riche humus grouille d’une vie microscopique et microbienne intense, avec des parasites plus dangereux que les onças, les jaguars réputés comme les fauves les plus cruels de la forêt et véritables maîtres des lieux. Les poux, les tiques, les vers, les mouches, les araignées, les scolopendres (ciens), les fourmis rouges ou les fourmis-tueuses, tous les carrapatos, baratas ou carapanás – comme les appelle Grand-Père –, visibles ou invisibles, pullulent dans ces zones où alternent marécages peu profonds et terre séchée. Toutes ces colonies d’insectes sont des vampires avides, prêts à piquer, à pénétrer la peau, à sucer le sang et, parfois, à donner la mort plus sûrement que les serpents, toujours pressés de fuir plutôt que d’attaquer.
Comme Grand-Père, je suis en short et pieds nus. Ni l’un ni l’autre nous ne possédons de tenue de brousse adaptée. Ma peau fragile d’Européen est lacérée par de petites coupures, griffures, écorchures. Mais je suis formidablement heureux. Je ne suis cependant pas stupide et ai désormais compris que l’Enfer vert n’a pas usurpé son nom. Il peut facilement se révéler atroce ou fatal. L’Amazonie coupe, pique, mord, déchiquette, ronge, envenime, infecte et pourrit celui qui se croit le plus fort. L’Amazonie est voluptueuse mais triomphante, l’Amazonie est prodigue mais sanguinaire, elle est la victoire végétale et la victoire animale de la nature sur l’homme. L’exubérante Amazone est l’avènement de l’eau et de l’infiniment vert, et leurs pouvoirs surpassent ceux des hommes. Grand-Père a raison, le monde que j’ai connu pèse peu face à ce monde-là. Il est évident que les hommes qui habitent cet univers ont développé un savoir en harmonie avec tous les esprits de leur nature. Sinon, ils auraient disparu depuis longtemps car l’eau et la selva, qui leur offrent si généreusement la vie, leur proposent aussi la mort à chaque pas. Un jour où j’évoquerai ce sujet avec Grand-Père Atalaya, celui-ci me dira :
— Les premiers hommes à vivre ici, tout au début, étaient les esprits eux-mêmes. Ils se multiplièrent car il importait qu’ils soient aussi nombreux que les animaux. Leurs premiers descendants avaient encore le feu originel des esprits qui vivait en eux. Seuls les plus faibles mouraient, ou bien un esprit mauvais les tuait. Mais au fil du temps et des descendances, certains ont oublié qui ils étaient. D’autres s’en sont souvenus assez pour survivre, transmettre les rites et le savoir, mais sans comprendre. Quelques-uns ont profité de l’ignorance pour inventer la duperie, la supercherie magique et se parer ainsi de faux pouvoirs. Comme l’harmonie était rompue, certaines tribus sont devenues très belliqueuses soit envers les autres, soit à l’intérieur d’elles-mêmes. Le meurtre et la vengeance sont devenus coutumiers de ces ethnies-là. Mais toujours, ce sont les esprits qui gagnent et survivent aux chamboulements et au chaos? »
(p. 136-138)
Grand-Père Atalaya (p. 48-50)
Les petites vérités (p. 196-199)
Extrait court


