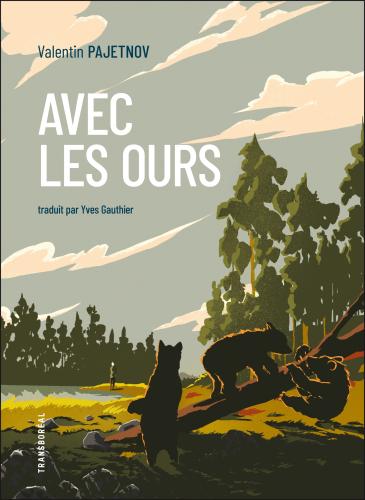
La tanière, ça compte ! :
« C’est la saison d’avant l’hiver où les “vrais” ours ne dorment pas encore mais ont déjà élu, voire aménagé, leur lieu d’hibernation. Il m’est arrivé, à la mi-novembre, de surprendre des plantigrades dans des tanières parfaitement installées, avec une belle litière. Quant à mes deux protégés, mis à part le fait qu’ils ont gratté la souche d’un sapin déraciné, ils ne se décident toujours pas. Je songe à les aider mais ne sais trop comment. Mes leçons leur serviront-elles et saurai-je leur donner le bon exemple, un exemple d’ours ? Rien n’est moins sûr. En même temps, rien ne m’autorise à douter de leur aptitude à construire d’eux-mêmes une tanière. N’ont-ils pas d’ores et déjà montré des réflexes de nidification ? C’est donc qu’ils possèdent des rudiments d’architecture, ce qui n’a d’ailleurs rien de sorcier. Simplement, les conditions ne sont pas encore assez rudes pour qu’ils soient acculés à l’acte. Je choisis d’attendre.
Nous en sommes là : moi sous ma tente, et les oursons sous leur sapin, contorsionnés dans les positions les plus abracadabrantes, le plus souvent sur le ventre, la tête posée sur une patte pliée. Le gel arrive subrepticement dans la soirée. Une flaque se recouvre d’une fine pellicule de glace. Elle brille comme une assiette. Les feuilles mortes se recroquevillent dans leur écorce de givre. Le crépuscule fait mine de s’empourprer mais capitule aussitôt face à de gros nuages. Le vent tombe. La forêt se plonge dans le silence et l’obscurité. Mes oursons se lèvent, s’approchent de la tente, vont et viennent en faisant croustiller la mousse givrée. Ils éventent bruyamment. Puis ils se rendent à leur souche et se mettent à creuser la terre, à ronger les racines. Dans le noir, je ne vois que deux taches sombres qui s’agitent sur un fond obscur. Je jubile ! Mes oursons construisent une tanière ! Ils y travaillent deux heures durant, puis vont se coucher. Je n’arrive pas à trouver le sommeil, et j’ai tout le temps d’analyser les événements de ces dernières journées.
D’abord, j’ai eu tort de promener les oursons tous les jours. Nous aurions dû ne pas bouger, car les déplacements les ont gênés dans leur instinct de nidification. Ensuite, je n’ai pas compris d’entrée que, l’ours étant très vulnérable dans ses quartiers d’hiver, il cherche à les cacher le plus efficacement possible pour garder la vie sauve et assurer la continuité de l’espèce ; l’animal doit donc faire preuve de la plus grande circonspection. Voilà pourquoi il éprouve le besoin de séjourner si longtemps dans la région de sa future tanière. Il s’assure de la sécurité du site. Comme la dentelle de ses empreintes le trahit sur la neige, il fait tout pour se cacher à temps. Mes apparitions répétées sur le chantier ont pu perturber mes ours, quand bien même ils me prendraient pour l’un des leurs ; or, l’instinct de défense l’emporte sur celui de nidification.
Les oursons reviennent au point du jour. Je prends mes aises à la lucarne – mon poste d’observation – d’où le chantier s’offre à moi comme sur un plateau, à 7 mètres de là. Les racines sont déjà bien rongées sous le tronc, et un tapis de rognures blanches jonche le sol. L’entrée se profile déjà : la terre desséchée a été grattée, qui bouchait l’espace entre les racines. Katia s’avance la première. Elle gratte les racines avec ses griffes, rogne quelques bouts et s’écarte. Yachka s’approche à son tour sans se presser, inspecte et flaire les lieux avec soin, jauge le travail et se lance : il griffe la terre, attaque les racines à l’aide de ses incisives, les arrache avec toute la force de son corps. Il y a maintenant une ouverture bien dessinée dans laquelle il glisse la patte pour creuser, mais il ne peut y entrer sans rogner encore quelques racines.
Les oursons travaillent à tour de rôle. Quand l’un est à l’ouvrage, l’autre l’observe d’un œil vigilant sans le déranger, mais prend la relève dès que la place se libère. Bientôt le trou s’agrandit. Quand vient le tour de Yachka, il y glisse la tête et passe beaucoup de temps à flairer la cavité. Une fois dehors, il racle le relief argileux près de l’entrée, regarde Katia, remet le nez au trou, se balance sur ses quatre pattes bien tendues et lentement, par un mouvement ponctué de pauses, se faufile à l’intérieur. Yachka descendu, Katia s’approche et baisse la tête, les yeux rivés sur le trou noir, pétrifiée. Seules bougent ses oreilles, signe d’excitation et d’intérêt pour tout ce qui se passe au fond de la tanière. Il y a dedans quelque chose qui bruit, renâcle, gémit, claque, craque.
Cinq longues minutes passent. Soudain, une gerbe d’argile jaillit de terre. Katia fait un bond de ressort mais se campe à nouveau dans la même position tendue, à demi assise sur son train arrière. Mottes et rognures continuent de voler hors de terre. Yachka travaille avec force râles et gémissements qui semblent monter du tréfonds de ses entrailles. Puis, plus rien. Sa tête émerge barbouillée d’argile. L’ourson tend le cou, l’oreille aux aguets, et d’un coup s’extirpe. Il s’ébroue – si fort qu’un nuage de saletés tourbillonne – et s’éloigne par bonds. Katia s’élance après lui. Je ne vois pas ce qu’ils font mais, d’après les sons rauques et sifflants que j’entends, je comprends qu’ils sont en train de jouer.
À midi, les oursons reprennent du service au chantier. Cette fois, c’est Katia qui se décide à descendre. Elle glisse la tête dans l’interstice, reste longtemps immobile, puis tente d’aller plus loin avec une drôle de façon de lever la patte postérieure. Soudain effrayée, elle s’arrache en arrière du goulot trop étroit, non sans y laisser quelques touffes de poil accrochées aux moignons des racines. Elle s’applique alors à rogner la terminaison de la souche qui a gêné son passage. Ronger par morceaux la fibre dure du bois lui prend beaucoup de temps. Puis, tatillonne, elle inspecte son travail – l’ouverture élargie – et paraît satisfaite. Revenue au bord de son antre, elle s’y engouffre en un clin d’œil. Deux minutes plus tard, elle en ressort et s’ébroue comme Yachka, qu’elle va rejoindre. L’autre affiche une parfaite indifférence, couché sous un coudrier à une vingtaine de mètres.
Dans la soirée, les oursons s’affairent longtemps près de leur trou. La nuit vient vite en novembre. La forêt n’est pas plus tôt touchée par la pénombre qu’elle plonge déjà dans les ténèbres. Comme on n’y voit goutte, je m’enfonce dans mon sac de couchage, heureux de dérouler mes jambes engourdies par tant d’immobilité. Dehors, l’agitation dure un temps, puis retombe. Je sommeille déjà, persuadé que mes oursons ont regagné leur reposée sous le sapin, quand un bruit étrange parvient à mes oreilles. Je mets du temps à comprendre qu’ils sont en train de ronfler… Ils se sont couchés dans leur tanière, et c’est la première fois que je les entends ronfler à ce point. On dirait un homme, de ceux qui vous font passer des nuits blanches quand ils partagent votre chambre d’hôtel. Mais, à ce moment précis, il n’est pour moi de musique plus agréable, et qui m’inspire plus de bonheur, de confiance, de quiétude… Sur quoi je m’endors à mon tour sans m’en rendre compte.
Je ne tarde pas à me réveiller. Les oursons ne ronflent plus, mais l’air est empli d’un étrange chuintement. Ce sont des flocons de neige qui bruissent sur la toile de ma tente en absorbant tous les autres sons nocturnes de la forêt. Cette nuit est la première que mes oursons passent à la tanière. »
La première expédition (p. 62-66)
Dans les champs d’avoine (p. 142-147)
Extrait court
« C’est la saison d’avant l’hiver où les “vrais” ours ne dorment pas encore mais ont déjà élu, voire aménagé, leur lieu d’hibernation. Il m’est arrivé, à la mi-novembre, de surprendre des plantigrades dans des tanières parfaitement installées, avec une belle litière. Quant à mes deux protégés, mis à part le fait qu’ils ont gratté la souche d’un sapin déraciné, ils ne se décident toujours pas. Je songe à les aider mais ne sais trop comment. Mes leçons leur serviront-elles et saurai-je leur donner le bon exemple, un exemple d’ours ? Rien n’est moins sûr. En même temps, rien ne m’autorise à douter de leur aptitude à construire d’eux-mêmes une tanière. N’ont-ils pas d’ores et déjà montré des réflexes de nidification ? C’est donc qu’ils possèdent des rudiments d’architecture, ce qui n’a d’ailleurs rien de sorcier. Simplement, les conditions ne sont pas encore assez rudes pour qu’ils soient acculés à l’acte. Je choisis d’attendre.
Nous en sommes là : moi sous ma tente, et les oursons sous leur sapin, contorsionnés dans les positions les plus abracadabrantes, le plus souvent sur le ventre, la tête posée sur une patte pliée. Le gel arrive subrepticement dans la soirée. Une flaque se recouvre d’une fine pellicule de glace. Elle brille comme une assiette. Les feuilles mortes se recroquevillent dans leur écorce de givre. Le crépuscule fait mine de s’empourprer mais capitule aussitôt face à de gros nuages. Le vent tombe. La forêt se plonge dans le silence et l’obscurité. Mes oursons se lèvent, s’approchent de la tente, vont et viennent en faisant croustiller la mousse givrée. Ils éventent bruyamment. Puis ils se rendent à leur souche et se mettent à creuser la terre, à ronger les racines. Dans le noir, je ne vois que deux taches sombres qui s’agitent sur un fond obscur. Je jubile ! Mes oursons construisent une tanière ! Ils y travaillent deux heures durant, puis vont se coucher. Je n’arrive pas à trouver le sommeil, et j’ai tout le temps d’analyser les événements de ces dernières journées.
D’abord, j’ai eu tort de promener les oursons tous les jours. Nous aurions dû ne pas bouger, car les déplacements les ont gênés dans leur instinct de nidification. Ensuite, je n’ai pas compris d’entrée que, l’ours étant très vulnérable dans ses quartiers d’hiver, il cherche à les cacher le plus efficacement possible pour garder la vie sauve et assurer la continuité de l’espèce ; l’animal doit donc faire preuve de la plus grande circonspection. Voilà pourquoi il éprouve le besoin de séjourner si longtemps dans la région de sa future tanière. Il s’assure de la sécurité du site. Comme la dentelle de ses empreintes le trahit sur la neige, il fait tout pour se cacher à temps. Mes apparitions répétées sur le chantier ont pu perturber mes ours, quand bien même ils me prendraient pour l’un des leurs ; or, l’instinct de défense l’emporte sur celui de nidification.
Les oursons reviennent au point du jour. Je prends mes aises à la lucarne – mon poste d’observation – d’où le chantier s’offre à moi comme sur un plateau, à 7 mètres de là. Les racines sont déjà bien rongées sous le tronc, et un tapis de rognures blanches jonche le sol. L’entrée se profile déjà : la terre desséchée a été grattée, qui bouchait l’espace entre les racines. Katia s’avance la première. Elle gratte les racines avec ses griffes, rogne quelques bouts et s’écarte. Yachka s’approche à son tour sans se presser, inspecte et flaire les lieux avec soin, jauge le travail et se lance : il griffe la terre, attaque les racines à l’aide de ses incisives, les arrache avec toute la force de son corps. Il y a maintenant une ouverture bien dessinée dans laquelle il glisse la patte pour creuser, mais il ne peut y entrer sans rogner encore quelques racines.
Les oursons travaillent à tour de rôle. Quand l’un est à l’ouvrage, l’autre l’observe d’un œil vigilant sans le déranger, mais prend la relève dès que la place se libère. Bientôt le trou s’agrandit. Quand vient le tour de Yachka, il y glisse la tête et passe beaucoup de temps à flairer la cavité. Une fois dehors, il racle le relief argileux près de l’entrée, regarde Katia, remet le nez au trou, se balance sur ses quatre pattes bien tendues et lentement, par un mouvement ponctué de pauses, se faufile à l’intérieur. Yachka descendu, Katia s’approche et baisse la tête, les yeux rivés sur le trou noir, pétrifiée. Seules bougent ses oreilles, signe d’excitation et d’intérêt pour tout ce qui se passe au fond de la tanière. Il y a dedans quelque chose qui bruit, renâcle, gémit, claque, craque.
Cinq longues minutes passent. Soudain, une gerbe d’argile jaillit de terre. Katia fait un bond de ressort mais se campe à nouveau dans la même position tendue, à demi assise sur son train arrière. Mottes et rognures continuent de voler hors de terre. Yachka travaille avec force râles et gémissements qui semblent monter du tréfonds de ses entrailles. Puis, plus rien. Sa tête émerge barbouillée d’argile. L’ourson tend le cou, l’oreille aux aguets, et d’un coup s’extirpe. Il s’ébroue – si fort qu’un nuage de saletés tourbillonne – et s’éloigne par bonds. Katia s’élance après lui. Je ne vois pas ce qu’ils font mais, d’après les sons rauques et sifflants que j’entends, je comprends qu’ils sont en train de jouer.
À midi, les oursons reprennent du service au chantier. Cette fois, c’est Katia qui se décide à descendre. Elle glisse la tête dans l’interstice, reste longtemps immobile, puis tente d’aller plus loin avec une drôle de façon de lever la patte postérieure. Soudain effrayée, elle s’arrache en arrière du goulot trop étroit, non sans y laisser quelques touffes de poil accrochées aux moignons des racines. Elle s’applique alors à rogner la terminaison de la souche qui a gêné son passage. Ronger par morceaux la fibre dure du bois lui prend beaucoup de temps. Puis, tatillonne, elle inspecte son travail – l’ouverture élargie – et paraît satisfaite. Revenue au bord de son antre, elle s’y engouffre en un clin d’œil. Deux minutes plus tard, elle en ressort et s’ébroue comme Yachka, qu’elle va rejoindre. L’autre affiche une parfaite indifférence, couché sous un coudrier à une vingtaine de mètres.
Dans la soirée, les oursons s’affairent longtemps près de leur trou. La nuit vient vite en novembre. La forêt n’est pas plus tôt touchée par la pénombre qu’elle plonge déjà dans les ténèbres. Comme on n’y voit goutte, je m’enfonce dans mon sac de couchage, heureux de dérouler mes jambes engourdies par tant d’immobilité. Dehors, l’agitation dure un temps, puis retombe. Je sommeille déjà, persuadé que mes oursons ont regagné leur reposée sous le sapin, quand un bruit étrange parvient à mes oreilles. Je mets du temps à comprendre qu’ils sont en train de ronfler… Ils se sont couchés dans leur tanière, et c’est la première fois que je les entends ronfler à ce point. On dirait un homme, de ceux qui vous font passer des nuits blanches quand ils partagent votre chambre d’hôtel. Mais, à ce moment précis, il n’est pour moi de musique plus agréable, et qui m’inspire plus de bonheur, de confiance, de quiétude… Sur quoi je m’endors à mon tour sans m’en rendre compte.
Je ne tarde pas à me réveiller. Les oursons ne ronflent plus, mais l’air est empli d’un étrange chuintement. Ce sont des flocons de neige qui bruissent sur la toile de ma tente en absorbant tous les autres sons nocturnes de la forêt. Cette nuit est la première que mes oursons passent à la tanière. »
(p. 180-185)
La première expédition (p. 62-66)
Dans les champs d’avoine (p. 142-147)
Extrait court


