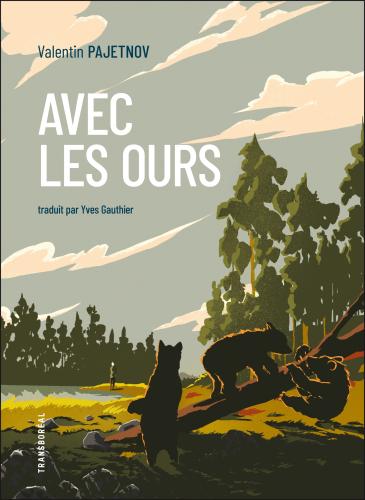
Dans les champs d’avoine :
« Au mois d’août, les nuits en forêt sont si noires qu’on ne pourrait y voir sa propre main. Comme par un fait exprès, je n’ai pas de lampe de poche. J’essaie tout de même à tâtons de trouver l’arbre où se cachent mes oursons, pour les emmener avec moi. Je me porte dans leur direction (supposée) en émettant un signal discret. Il me semble que l’un d’eux vient de renâcler à une quinzaine de mètres. J’y oriente mes pas. Je clappe encore. Silence. Je décris un cercle et perds complètement mes derniers repères – le champ d’avoine, la route, le hameau… Un ciel sans étoiles. Une nuit d’encre, épaisse, plongée dans le silence originel. Je fais au couteau des entailles sur les troncs des arbres et, les bras tendus devant moi, me dirige vers le chemin présumé du champ. À chaque instant, je me pique à des arbustes épineux, trébuche entre deux racines, me heurte à des monticules dont je n’ai pas le souvenir, me cogne à des arbres d’au moins 2 brassées que je pense n’avoir jamais vus par là. Tendu, j’ai l’impression d’entendre un son, quelque chose comme un aboiement de chien, que sais-je encore ? J’ai beau savoir que c’est une illusion, je m’arrête et tends l’oreille. Dans le silence, le son me vrille les oreilles. Il me faut une éternité pour retrouver le champ. Enfin, à travers des barreaux de branches, je devine un trou noir et mat. Je suis au pied de ma tour. Je me laisse choir sur un rondin. J’essuie une toile d’araignée qui colle à mon visage écorché. De ma manche et de mon col, j’extrais des branchettes, des ramuscules d’aiguilles, des bouts de bois. Il est 1 heure et demie quand j’arrive à Tokovié. Je peste contre moi-même (sortir sans une allumette, franchement…) et me jette sur ma couche.
Au matin, je retrouve mes entailles et refais le chemin de la nuit. Cent vingt mètres à tout casser ! Je pousse un rire amer en découvre le seul fourré du coin – un coudrier dans lequel je me suis frayé un passage, conséquence de ma rigoureuse “méthode d’orientation”. Mes oursons répondent tout de suite à mon appel. Nous allons à la pâture du matin. La faim les tenaille, je le vois bien. Hier, ils n’ont pas pu manger comme il faut, et puis ils ont passé la nuit dans la ramure d’un sapin. Dès qu’ils arrivent au champ, ils font croustiller le grain. Mais la méfiance demeure. Katia et Yachka se dressent tour à tour sur leurs pattes arrière, cessent de mâcher et tendent l’oreille. Il suffit qu’un le fasse pour que l’autre l’imite. Ils n’ont pas l’air de faire grand cas de ma présence mais, dès que je m’éclipse, ils me rejoignent. Le visiteur du soir les a effrayés, c’est clair.
Ils broutent depuis une heure. Je fais le tour du champ par des pistes d’ours et de sangliers, histoire de voir un peu qui fréquente cette pâture. Les petits me suivent. D’abord ils marchent à mes côtés, puis ils s’enhardissent à prendre le large. Ils vont même jusqu’à s’enfoncer dans les bois pendant dix ou quinze minutes. Nous tombons en chemin sur une vieille semeuse cassée. Peinte en orange, elle contraste avec le fond vert de la forêt. Les oursons l’aperçoivent à quelque 70 mètres. Katia, aussitôt imitée par Yachka, se lève sur ses pattes postérieures, le souffle inquiet, les lèvres en trompette. Ils s’en approchent après mille précautions. Une fois fait le tour, ils s’en désintéressent et s’éloignent. Passé la semeuse, nous entrons dans la zone fourragère d’un ours, qui fait une centaine de mètres carrés. C’est un tapis de tiges couchées. Quelques grains oubliés s’accrochent encore aux épis comme autant de gouttelettes jaunes. Je ramasse une poignée au hasard. L’avoine est bien “peignée” : l’ours aura pris son temps, sûr de ne pas être dérangé. Il y a aussi des excréments frais.
En territoire étranger, Katia et Yachka se tiennent sur leurs gardes. Ils ne touchent pas aux déjections, qu’ils se contentent de flairer à un demi-mètre de distance, le nez tendu. À plusieurs reprises ils se dressent sur leurs pattes postérieures, l’oreille aux aguets. De là partent deux pistes bien dessinées. Nous les empruntons, les oursons marchent devant, et moi derrière. Les voilà qui s’arrêtent. Les pistes se rejoignent, puis divergent à nouveau, en croisent d’autres et finissent par s’estomper dans les bois : c’est que l’ours vient au champ par différents chemins, qui convergent en fin de course. Souvent, les pistes d’ours qui mènent à l’avoine peuvent serpenter sur plusieurs kilomètres.
L’exploration olfactive des pistes dure encore sept heures. Nous visitons trois autres territoires fourragers d’ours, rencontrons toutes sortes de marques excrémentielles anciennes ou fraîches, et marchons sur des traces de sangliers. Les oursons réagissent sans curiosité aux empreintes et aux déjections des sangliers. Peut-être sont-ils troublés par la proximité des odeurs d’ours. Nous tombons aussi sur une trace de blaireau. L’ayant flairée, ils promènent des yeux étonnés tout autour d’eux. Moi-même suis tenté d’en faire autant, bien qu’il n’y ait personne à la ronde. Puis je ris de moi, en silence : le blaireau ne vient ici que la nuit, mais son odeur est si forte qu’elle confond les oursons. En chemin, nous effrayons quelques gélinottes qui s’envolent à grand bruit d’ailes. Mais ils daignent à peine leur accorder un regard.
Peu à peu les oursons cessent de se coller à moi. Leur crispation s’efface. Pourtant, tout en eux montre combien l’odeur est quelque chose d’important : à aucun moment ils ne se sont livrés à des jeux au cours de la promenade. Même les souches vermoulues rencontrées en chemin n’ont pas attiré leur attention, à mon plus grand étonnement.
Depuis qu’ils se nourrissent d’avoine, les oursons boivent beaucoup. Mais nulle part en chemin nous n’avons rencontré d’eau. Accablés par la chaleur, ils ont maintenant la respiration haletante. Je les conduis donc à un petit étang envahi d’algues et de laîche, où jadis le bétail venait s’abreuver. À la vue de l’eau, ils s’y sont jetés en soulevant des cascades de gouttelettes. Une joie infinie. Ils nagent, plongent, se livrent à de vrais tournois et brassent tant d’eau qu’on ne les voit plus au travers de ce festoiement mouillé. Le pelage étincelant, chamarré d’algues et constellé de lentilles d’eau, ils sortent fourbus au bout d’une demi-heure et prennent le chemin de la grange pour s’y reposer. J’en profite pour cuisiner, recharger mon appareil photo et manger un morceau. Sur quoi, je m’endors sans m’en apercevoir. Quelque chose grince et me réveille. Je n’ai pas recouvré mes esprits qu’éclate un bruit de verre brisé. Levé d’un bond, je cours à la fenêtre et vois Katia filer à fond de train. Je suppose qu’une fois reposée, elle s’est mise à ma recherche. Montée sur le rebord, elle a dû mettre la patte au carreau. Le tintement du verre (ou la peur d’un sermon ?) lui a fait prendre la fuite. Il me faut d’urgence colmater la brèche avec un bout de cellophane pour me défendre de l’invasion des moustiques.
À 6 heures du soir, comme d’habitude, nous sommes au champ d’avoine. Les michkas s’y plongent de bon appétit, cependant que je remonte à mon perchoir. La vie va son train. Les oursons paissent. Par un mouvement bien rodé de la patte, ils tirent une brassée d’épis et mâchent avec un bruit voluptueux de la bouche. Juché sur ma tour, je les observe, scrute le champ, chasse prudemment ces saletés de moustiques, fais courir mon crayon sur les pages de mon carnet. Et j’écoute le silence. Dans la pénombre qui s’épaissit, des merles entonnent un chant pour la nuit, un tracteur gronde au loin, poussif, du côté du village, et l’écho d’un avion traverse le ciel.
Une journée chaude a cédé la place à la nuit fraîche. Une langue de brume sortie des bois s’allonge dans le bas du champ. Au pied de ma tour, dans l’humus, des mulots frétillent et chicotent. Une chouette se meut sans bruit dans l’air, à 3 mètres de moi. Le grognement d’un sanglier monte d’une clairière : les bêtes vont pâturer. Un bruissement parvient confusément à mes oreilles, si léger que j’en doute. Mes oursons, après un bref repos pris sur le bouleau voisin, s’en retournent à l’avoine, et leurs deux petites silhouettes se détachent sur le fond encore clair du champ de céréales. Encore quelque chose qui craque. Ils se dressent ensemble, station debout sur deux pattes. Une seconde plus tard, après une expiration chuintante (f-ch-ch-chi), ils détalent dans le bois. Je les entends grimper à un arbre. Le silence règne pour un temps. Enfin, à l’endroit où la piste d’ours s’abouche au champ (à 50 mètres de notre coin de pâturage) apparaît une tache sombre. C’est lui. Un moment debout, il se vautre à terre et, avec un grognement sourd, commence à se rouler. Il se roule encore, puis se lève, s’ébroue bruyamment, longe le bord du champ et se dissout bientôt sur le fond noir des fourrés.
Je garde mon poste jusqu’à la nuit mais n’observe plus rien d’intéressant. Refroidi par l’expérience de la veille, je ne vais pas chercher mes oursons – ils n’auront qu’à dormir sur leur sapin. Je regagne mon isba… En chemin je tombe sur un troupeau de sangliers qui traversent le champ d’avoine à grand bruit de narines et de langue. J’entends le cliquetis sec des crocs d’un verrat qui mâchonne une botte d’épis. Soudain, le troupeau se change en glace. La brise lui a renvoyé mon odeur. Pendant une trentaine de secondes, c’est le silence complet. Puis le verrat pousse un sifflement brutal accompagné d’un han ! sourd. Le troupeau se met en marche, son bruissement s’étire à travers le champ. Il s’engouffre bientôt dans la forêt, et c’est le silence. »
La première expédition (p. 62-66)
La tanière, ça compte ! (p. 180-185)
Extrait court
« Au mois d’août, les nuits en forêt sont si noires qu’on ne pourrait y voir sa propre main. Comme par un fait exprès, je n’ai pas de lampe de poche. J’essaie tout de même à tâtons de trouver l’arbre où se cachent mes oursons, pour les emmener avec moi. Je me porte dans leur direction (supposée) en émettant un signal discret. Il me semble que l’un d’eux vient de renâcler à une quinzaine de mètres. J’y oriente mes pas. Je clappe encore. Silence. Je décris un cercle et perds complètement mes derniers repères – le champ d’avoine, la route, le hameau… Un ciel sans étoiles. Une nuit d’encre, épaisse, plongée dans le silence originel. Je fais au couteau des entailles sur les troncs des arbres et, les bras tendus devant moi, me dirige vers le chemin présumé du champ. À chaque instant, je me pique à des arbustes épineux, trébuche entre deux racines, me heurte à des monticules dont je n’ai pas le souvenir, me cogne à des arbres d’au moins 2 brassées que je pense n’avoir jamais vus par là. Tendu, j’ai l’impression d’entendre un son, quelque chose comme un aboiement de chien, que sais-je encore ? J’ai beau savoir que c’est une illusion, je m’arrête et tends l’oreille. Dans le silence, le son me vrille les oreilles. Il me faut une éternité pour retrouver le champ. Enfin, à travers des barreaux de branches, je devine un trou noir et mat. Je suis au pied de ma tour. Je me laisse choir sur un rondin. J’essuie une toile d’araignée qui colle à mon visage écorché. De ma manche et de mon col, j’extrais des branchettes, des ramuscules d’aiguilles, des bouts de bois. Il est 1 heure et demie quand j’arrive à Tokovié. Je peste contre moi-même (sortir sans une allumette, franchement…) et me jette sur ma couche.
Au matin, je retrouve mes entailles et refais le chemin de la nuit. Cent vingt mètres à tout casser ! Je pousse un rire amer en découvre le seul fourré du coin – un coudrier dans lequel je me suis frayé un passage, conséquence de ma rigoureuse “méthode d’orientation”. Mes oursons répondent tout de suite à mon appel. Nous allons à la pâture du matin. La faim les tenaille, je le vois bien. Hier, ils n’ont pas pu manger comme il faut, et puis ils ont passé la nuit dans la ramure d’un sapin. Dès qu’ils arrivent au champ, ils font croustiller le grain. Mais la méfiance demeure. Katia et Yachka se dressent tour à tour sur leurs pattes arrière, cessent de mâcher et tendent l’oreille. Il suffit qu’un le fasse pour que l’autre l’imite. Ils n’ont pas l’air de faire grand cas de ma présence mais, dès que je m’éclipse, ils me rejoignent. Le visiteur du soir les a effrayés, c’est clair.
Ils broutent depuis une heure. Je fais le tour du champ par des pistes d’ours et de sangliers, histoire de voir un peu qui fréquente cette pâture. Les petits me suivent. D’abord ils marchent à mes côtés, puis ils s’enhardissent à prendre le large. Ils vont même jusqu’à s’enfoncer dans les bois pendant dix ou quinze minutes. Nous tombons en chemin sur une vieille semeuse cassée. Peinte en orange, elle contraste avec le fond vert de la forêt. Les oursons l’aperçoivent à quelque 70 mètres. Katia, aussitôt imitée par Yachka, se lève sur ses pattes postérieures, le souffle inquiet, les lèvres en trompette. Ils s’en approchent après mille précautions. Une fois fait le tour, ils s’en désintéressent et s’éloignent. Passé la semeuse, nous entrons dans la zone fourragère d’un ours, qui fait une centaine de mètres carrés. C’est un tapis de tiges couchées. Quelques grains oubliés s’accrochent encore aux épis comme autant de gouttelettes jaunes. Je ramasse une poignée au hasard. L’avoine est bien “peignée” : l’ours aura pris son temps, sûr de ne pas être dérangé. Il y a aussi des excréments frais.
En territoire étranger, Katia et Yachka se tiennent sur leurs gardes. Ils ne touchent pas aux déjections, qu’ils se contentent de flairer à un demi-mètre de distance, le nez tendu. À plusieurs reprises ils se dressent sur leurs pattes postérieures, l’oreille aux aguets. De là partent deux pistes bien dessinées. Nous les empruntons, les oursons marchent devant, et moi derrière. Les voilà qui s’arrêtent. Les pistes se rejoignent, puis divergent à nouveau, en croisent d’autres et finissent par s’estomper dans les bois : c’est que l’ours vient au champ par différents chemins, qui convergent en fin de course. Souvent, les pistes d’ours qui mènent à l’avoine peuvent serpenter sur plusieurs kilomètres.
L’exploration olfactive des pistes dure encore sept heures. Nous visitons trois autres territoires fourragers d’ours, rencontrons toutes sortes de marques excrémentielles anciennes ou fraîches, et marchons sur des traces de sangliers. Les oursons réagissent sans curiosité aux empreintes et aux déjections des sangliers. Peut-être sont-ils troublés par la proximité des odeurs d’ours. Nous tombons aussi sur une trace de blaireau. L’ayant flairée, ils promènent des yeux étonnés tout autour d’eux. Moi-même suis tenté d’en faire autant, bien qu’il n’y ait personne à la ronde. Puis je ris de moi, en silence : le blaireau ne vient ici que la nuit, mais son odeur est si forte qu’elle confond les oursons. En chemin, nous effrayons quelques gélinottes qui s’envolent à grand bruit d’ailes. Mais ils daignent à peine leur accorder un regard.
Peu à peu les oursons cessent de se coller à moi. Leur crispation s’efface. Pourtant, tout en eux montre combien l’odeur est quelque chose d’important : à aucun moment ils ne se sont livrés à des jeux au cours de la promenade. Même les souches vermoulues rencontrées en chemin n’ont pas attiré leur attention, à mon plus grand étonnement.
Depuis qu’ils se nourrissent d’avoine, les oursons boivent beaucoup. Mais nulle part en chemin nous n’avons rencontré d’eau. Accablés par la chaleur, ils ont maintenant la respiration haletante. Je les conduis donc à un petit étang envahi d’algues et de laîche, où jadis le bétail venait s’abreuver. À la vue de l’eau, ils s’y sont jetés en soulevant des cascades de gouttelettes. Une joie infinie. Ils nagent, plongent, se livrent à de vrais tournois et brassent tant d’eau qu’on ne les voit plus au travers de ce festoiement mouillé. Le pelage étincelant, chamarré d’algues et constellé de lentilles d’eau, ils sortent fourbus au bout d’une demi-heure et prennent le chemin de la grange pour s’y reposer. J’en profite pour cuisiner, recharger mon appareil photo et manger un morceau. Sur quoi, je m’endors sans m’en apercevoir. Quelque chose grince et me réveille. Je n’ai pas recouvré mes esprits qu’éclate un bruit de verre brisé. Levé d’un bond, je cours à la fenêtre et vois Katia filer à fond de train. Je suppose qu’une fois reposée, elle s’est mise à ma recherche. Montée sur le rebord, elle a dû mettre la patte au carreau. Le tintement du verre (ou la peur d’un sermon ?) lui a fait prendre la fuite. Il me faut d’urgence colmater la brèche avec un bout de cellophane pour me défendre de l’invasion des moustiques.
À 6 heures du soir, comme d’habitude, nous sommes au champ d’avoine. Les michkas s’y plongent de bon appétit, cependant que je remonte à mon perchoir. La vie va son train. Les oursons paissent. Par un mouvement bien rodé de la patte, ils tirent une brassée d’épis et mâchent avec un bruit voluptueux de la bouche. Juché sur ma tour, je les observe, scrute le champ, chasse prudemment ces saletés de moustiques, fais courir mon crayon sur les pages de mon carnet. Et j’écoute le silence. Dans la pénombre qui s’épaissit, des merles entonnent un chant pour la nuit, un tracteur gronde au loin, poussif, du côté du village, et l’écho d’un avion traverse le ciel.
Une journée chaude a cédé la place à la nuit fraîche. Une langue de brume sortie des bois s’allonge dans le bas du champ. Au pied de ma tour, dans l’humus, des mulots frétillent et chicotent. Une chouette se meut sans bruit dans l’air, à 3 mètres de moi. Le grognement d’un sanglier monte d’une clairière : les bêtes vont pâturer. Un bruissement parvient confusément à mes oreilles, si léger que j’en doute. Mes oursons, après un bref repos pris sur le bouleau voisin, s’en retournent à l’avoine, et leurs deux petites silhouettes se détachent sur le fond encore clair du champ de céréales. Encore quelque chose qui craque. Ils se dressent ensemble, station debout sur deux pattes. Une seconde plus tard, après une expiration chuintante (f-ch-ch-chi), ils détalent dans le bois. Je les entends grimper à un arbre. Le silence règne pour un temps. Enfin, à l’endroit où la piste d’ours s’abouche au champ (à 50 mètres de notre coin de pâturage) apparaît une tache sombre. C’est lui. Un moment debout, il se vautre à terre et, avec un grognement sourd, commence à se rouler. Il se roule encore, puis se lève, s’ébroue bruyamment, longe le bord du champ et se dissout bientôt sur le fond noir des fourrés.
Je garde mon poste jusqu’à la nuit mais n’observe plus rien d’intéressant. Refroidi par l’expérience de la veille, je ne vais pas chercher mes oursons – ils n’auront qu’à dormir sur leur sapin. Je regagne mon isba… En chemin je tombe sur un troupeau de sangliers qui traversent le champ d’avoine à grand bruit de narines et de langue. J’entends le cliquetis sec des crocs d’un verrat qui mâchonne une botte d’épis. Soudain, le troupeau se change en glace. La brise lui a renvoyé mon odeur. Pendant une trentaine de secondes, c’est le silence complet. Puis le verrat pousse un sifflement brutal accompagné d’un han ! sourd. Le troupeau se met en marche, son bruissement s’étire à travers le champ. Il s’engouffre bientôt dans la forêt, et c’est le silence. »
(p. 142-147)
La première expédition (p. 62-66)
La tanière, ça compte ! (p. 180-185)
Extrait court


