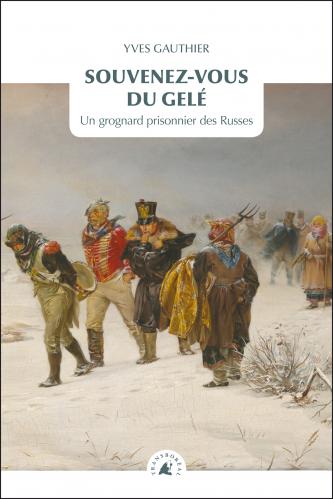
Sous escorte :
« Surtout, ne pas tomber de traîneau. Car aussitôt le gel frappe, somnifère et mortel. Et quand le gel ne frappe pas le premier, ce sont les convoyeurs, rapaces et cupides, qui ratissent les arrières de la colonne, dépouillant, dépeçant, égorgeant. Si rapide que soit la mort des traînards, leur cri, lui, est sans fin. Il poursuit les survivants comme un reproche à leur conscience, si tant est qu’ils en aient encore une, de conscience, parce que c’est affreux à dire mais chacun ne voit plus en son camarade – tout camarade qu’il soit – qu’une proie à déshabiller. “Une gaieté inouïe” ? Si l’on rit encore dans les colonnes, c’est de pareilles illusions.
Les convoyeurs. Passe encore qu’ils soient cruels, mais bêtes à ce point… On ne compte plus les fois où ils se perdent, piètres guides, piètres en tout, tourmente-chrétiens. Oui, les cosaques se perdent dans leurs propres neiges ! Et les moujiks qu’ils réquisitionnent avec traîneaux et chevaux sont impénétrables d’indifférence derrière leurs faces immobiles et leurs yeux clairs d’une noire tristesse qui n’expriment rien qu’on puisse deviner de près ou de loin. Eux connaissent le pays mais n’ont cure du chemin qu’on doit prendre. Pour eux, le sens (de la marche) n’a pas de sens (qui parle à la raison). Savin reverra ces visages en pensée quand, plus de soixante ans plus tard, il tombera sur le tableau de Prianichnikov-dit-Pain-d’Épice, Épisode de la guerre de 1812, ces dignes silhouettes paysannes empreintes de fierté nationale. Tu parles ! Entre les moujiks et la masse claudicante des prisonniers, qu’ils soient de France, de Prusse, de Suisse, d’Italie, de Pologne… il y a un mur de Chine, et les conducteurs, tous gradés russes, ne paraissent pas mieux les comprendre. Qu’un moujik regarde un cosaque ou un Français, en effet, rien ne change dans ses yeux. Même le mot regarder est étrange pour traduire ce qui n’est qu’un muet glissement de prunelles.
Donc, on se perd souvent, laissant échapper dans la course tel “village” (un ramas de cabanes en vérité) que la feuille de route des conducteurs présente comme l’étape du jour, parce qu’on dit jour pour désigner cette vague clarté laiteuse qui descend d’un ciel bas de 10 heures du matin à 3 heures de l’après-midi… Un soir que le chef de colonne égare son convoi au fond d’un bois et le ramène à force de détours hasardeux sur le chemin même qu’on venait d’emprunter, il coupe au sabre un bouleau par le milieu puis, examinant de près la coupure, fait ce commentaire qu’un compagnon de Savin, officier polonais, lui traduira à l’oreille : “Voilà la direction que nous devons prendre ! L’écorce de l’arbre, du côté nord, est un peu rousse et gâtée, tandis que, de l’autre côté, qui est celui du midi, elle est blanche et bien conservée. Marchons au midi !” Il faut alors rétrograder, et commence une rude contremarche jalonnée des cadavres qu’on a laissés là, détroussés par des cosaques ayant fermé la marche exprès, les charognards. Certains des corps vivent encore, lesquels moribonds s’accrochent aux traîneaux en suppliant qu’on les embarque, et rares sont les prisonniers qui, pour défendre leur place assise, d’un méchant coup sur les doigts, ne les ont pas “aidés” à lâcher les attelages pour en alléger la course. “Quand mémère tombe du chariot, le dada repart au trot”, dit le proverbe russe proféré par les gorges hilares des convoyeurs qui sont seuls à rire car rire de ses bourreaux aide à survivre, mais rire avec eux c’est se tuer soi-même en faisant perdre un peu de son âme au genre humain, tout le monde sait cela.
Il n’est pas rare que, faute de toit, la colonne bivouaque à l’air libre. Souvent, quand un homme se sent près de mourir, il se relève avec horreur dans la nuit pour lutter debout contre l’agonie ; et aussitôt le froid le fige, raide et gelé, dans les contorsions de la mort, sa dernière sueur glacée sur ses membres décharnés, les yeux ouverts pour toujours, le corps pétrifié dans une attitude convulsive. Les autres se réveillent à l’aube encerclés de statues blanches pareilles à des sentinelles avancées de l’autre monde. Il faut alors les mettre en tas, leurs chevilles se détachant du pied plus facilement que leurs semelles ne se dessoudent du sol enneigé. Le règlement stipule qu’il faut les brûler. De fait, on ne peut songer à creuser une fosse tant la neige est dure. Il n’est pas rare alors qu’on entende des cris de revenants jaillir du bûcher : un temps ressuscités par la chaleur des flammes, les suppliciés trépassent dans des tourments accrus.
Il arrive que la colonne trouve en chemin un bâtiment vide, surtout à l’entrée des villes. On l’investit aussitôt. On s’y entasse à tous les étages. Mais, en l’absence de chauffage, le froid n’est pas moins mordant au-dedans qu’au-dehors, or l’on ne fait pas un feu n’importe où dans un gîte. Au petit matin, c’est donc le même spectacle morbide qu’au bivouac, le même étalage de cadavres raidis dans la contorsion de leur passage à trépas. Les soldats russes les traînent alors par les pieds au moyen de cordes, dévalant les escaliers, et les têtes rebondissent sinistrement de marche en marche. On se souvient aussi de moribonds achevés de la sorte. Comme on ne peut être témoin de tout cela sans avoir la conscience meurtrie, chacun se justifie en pensant “bientôt mon tour”, ou “ils ne souffrent plus”. François Mercier, camarade de captivité de Nicolas Savin, dans le journal du miraculé qu’il sera : “Voilà ce que j’ai vu, ce que mes compagnons voyaient journellement, et pas un de nous n’avait le courage de réclamer : tant la misère abrutit les hommes ! La même chose, nous disions-nous, nous arrivera demain ; et cette communauté de périls mettait notre conscience en repos et favorisait notre inertie.”
Depuis quand Savin n’a-t-il pas ôté le bandage dont il s’était pansé le pied gauche ? Depuis Moscou, peut-être bien. Les “Moscovites” (les asticots, quoi, puisque la troupe les nomme ainsi) ont eu tout le temps de proliférer. Le froid tue tout sauf la vermine. Un certain soir, au bout d’une énième étape, l’isba où l’escorteur le place est si petite qu’on n’y loge que cinq prisonniers. Bancs ou couchettes, des planches courent le long des murs, sur lesquelles ils se jettent aussitôt, transis et fourbus. Ça sent le chou rance, le fumier, la misère et la peur. La famille s’est réfugiée sur le poêle qui ressemble à un grand four à pain surmonté d’une plateforme en brique ou moellon, et qui, par son volume, mange un bon tiers de l’espace intérieur. De cette famille paysanne, tremblante et chuintante, fagotée dans de la toile à sac, on ne voit que des yeux farouches et curieux. Pour elle, ce sont là ses premiers Français. Un sergent du 3e de ligne, qui fait partie de la chambrée, s’amuse alors à pousser un cri sauvage. Un “barrit”, qu’il dit. Gamin, ce fils d’un meunier de Montmartre avait entendu barrir Hans, l’éléphant du Jardin des Plantes. Maintenant, par la voix du sergent, c’est dans une isba du village de Klouchino que le pachyderme se met à trompeter. Sur le poêle, les visages se peignent de frayeur à la lueur dansante d’un lumignon résineux qui, fixé sur un pied, crache une longue flamme étirée en fumée grasse. Dans la pièce étroite et basse, le cri provoque un tintamarre étourdissant. Les poules caquettent et soulèvent un tourbillon de plumes et de paille. La flamme s’affole et fait tourner les ombres. Chose rare, on entend deux lapins clapir. La vieille jument décrépite, chétive et courte sur pattes, trouve la force de lancer une ruade en faisant tomber d’un coup trois pots d’écorce posés sur une grossière planche transversale (s’en échappent des graines d’airelle séchée). Un mouton pelé bêle, ce qui tranche un peu avec ses airs impassibles. Savin calcule bientôt qu’en comptant la ménagerie, on sera vingt-six à dormir dans la cabane. Touche comique au tableau, un chat déboule de sa cachette (vingt-sept !) en faisant voler une longue louche en bois plongée dans une étrange barrique (celle-ci, creusée à l’herminette dans la souche d’un tilleul, doit servir d’abreuvoir aux hommes et aux bêtes) ; alors la louche retombe sur le nez du sergent qui l’embouche, goguenard, à la manière d’une trompe d’éléphant.
Mais assez ri, on n’en peut plus. On retourne ses poches pour compter ses derniers kopecks et acheter de quoi manger aux paysans. On lâche d’amers jurons en déplorant le peu qui reste. On peste contre l’officier conducteur, ce roué de Russe qui garde pour lui la solde des hommes et peut-être aussi leur fourniment. Où diable sont-elles, ces touloupes annoncées par oukase, sinon dans sa cassette, en pièces sonnantes et trébuchantes ? L’or les rend tous fous. Pas la gloire ni l’amour, qui restent l’apanage des soldats de l’Empire, mais l’or. À tel point que Savin avait dû cacher les dix-huit napoléons or qu’il tenait de la grande foire de Moscou en les avalant précipitamment au moment même où les cosaques de Platov le capturaient en lui “faisant un jambon” (c’est-à-dire en lui cassant son fusil). Et maintenant, trois semaines plus tard, contrairement aux lois de la nature, elles ne sont toujours pas reparues de l’autre côté malgré les remous insupportables qui lui torturent le fondement par d’affreuses coliques : jusqu’à quinze fois par jour, un flot fétide se verse dans sa culotte qu’il ne dégrafe plus depuis bien longtemps. Hier, il empestait tant que ses camarades l’ont chassé de la masure où l’on couchait, et n’a dû son salut qu’à une miraculeuse botte de paille sèche trouvée dans un hangar, au creux de laquelle il a pu se nicher. Mais toujours pas de napoléons or ! Ce ne sont pas ses 50 kopecks de solde journalière qui le feront manger. D’ailleurs, on vient de le dire, ce paiement n’existe vraiment et pleinement que sur les tablettes du conducteur. Des camarades meurent chaque jour par dizaines, dont les paies vont à son seul crédit. Les âmes mortes, qu’ils appellent ça.
En étalant les 2 roubles cuivre qu’on vient de grappiller, on fait entendre par gestes qu’on veut manger. Mais rien n’indique qu’on a été compris. Alors un sous-lieutenant suggère qu’on a peut-être interprété une pantomime trop civilisée, puisqu’on y jouait de la fourchette et du couteau. Pour plus de clarté, on mime à présent un homme des cavernes qui mordrait dans un quartier d’aurochs. Là-haut, sur le poêle, les paysans s’agitent en proférant plusieurs fois le même mot : “Couché !”, “Couché !”. Les autres s’énervent et disent qu’avant de se coucher, c’est manger qu’on veut. Le ton monte. Plus leste qu’on ne l’aurait cru, le vieux moujik saute alors de son perchoir et s’empare d’une espèce de marmite posée sur une saillie du four. On ne tarde pas à y reconnaître un gruau pâteux de sarrasin. Fiévreusement, les prisonniers se passent le pot de la main à la main, dans lequel ils puisent avec une seule et même cuillère en bois de tremble. Heureuse surprise, cette bouillie noire est relevée par un sel qui tranche avantageusement avec la poudre à cartouche dont les troupes, depuis tant de semaines, accommodent leur bouillie de son. On monte encore d’un cran dans la jouissance quand la femme du moujik, descendue prestement à son tour (fichtre, quelle agilité à cet âge ! ou c’est au contraire qu’ils sont jeunes mais font vieux ?) extrait d’un coin du four un bouillon de chou que les Français jugent à la fois infâme et délectable. Après la marmitée de sarrasin, c’est bientôt la potée aux choux qui finit dans les gosiers des cinq naufragés. Ça ne vaut pas, dit le sergent, un morceau de boudin de la Mère aux bouts comme on mangeait à la caserne de Courbevoie avec une bouteille de vin de Suresnes, mais c’est assez pour la nuit (faux augure, on le verra). Enfin, le moujik fait circuler une chope en bois remplie de kvas. Ce n’est pas la première fois qu’on en boit, mais ce kvas-là leur paraît meilleur que les autres. Soit qu’on l’ait mieux préparé, soit que le goût des prisonniers ait tourné. Si la peau prend la couleur blanc cendré du pays de leurs souffrances, pourquoi le goût ne s’accoutumerait-il pas à ce vineux breuvage ? On dit qu’il provient de la fermentation d’orge et de fruits, telle cette airelle séchée que la jument a fait tomber de l’étagère en regimbant contre le cri de l’éléphant. Le kvas dégage un étrange bouquet de levain mêlé d’hydromel et, surtout, envoie partout (à la tête, aux jambes, au ventre et même aux parties honteuses) des vagues chaudes et grisantes à vous réconcilier avec le sort. »
Douce isba (p. 117-120)
Rue des Petits-Sous (p. 263-266)
Extrait court
« Surtout, ne pas tomber de traîneau. Car aussitôt le gel frappe, somnifère et mortel. Et quand le gel ne frappe pas le premier, ce sont les convoyeurs, rapaces et cupides, qui ratissent les arrières de la colonne, dépouillant, dépeçant, égorgeant. Si rapide que soit la mort des traînards, leur cri, lui, est sans fin. Il poursuit les survivants comme un reproche à leur conscience, si tant est qu’ils en aient encore une, de conscience, parce que c’est affreux à dire mais chacun ne voit plus en son camarade – tout camarade qu’il soit – qu’une proie à déshabiller. “Une gaieté inouïe” ? Si l’on rit encore dans les colonnes, c’est de pareilles illusions.
Les convoyeurs. Passe encore qu’ils soient cruels, mais bêtes à ce point… On ne compte plus les fois où ils se perdent, piètres guides, piètres en tout, tourmente-chrétiens. Oui, les cosaques se perdent dans leurs propres neiges ! Et les moujiks qu’ils réquisitionnent avec traîneaux et chevaux sont impénétrables d’indifférence derrière leurs faces immobiles et leurs yeux clairs d’une noire tristesse qui n’expriment rien qu’on puisse deviner de près ou de loin. Eux connaissent le pays mais n’ont cure du chemin qu’on doit prendre. Pour eux, le sens (de la marche) n’a pas de sens (qui parle à la raison). Savin reverra ces visages en pensée quand, plus de soixante ans plus tard, il tombera sur le tableau de Prianichnikov-dit-Pain-d’Épice, Épisode de la guerre de 1812, ces dignes silhouettes paysannes empreintes de fierté nationale. Tu parles ! Entre les moujiks et la masse claudicante des prisonniers, qu’ils soient de France, de Prusse, de Suisse, d’Italie, de Pologne… il y a un mur de Chine, et les conducteurs, tous gradés russes, ne paraissent pas mieux les comprendre. Qu’un moujik regarde un cosaque ou un Français, en effet, rien ne change dans ses yeux. Même le mot regarder est étrange pour traduire ce qui n’est qu’un muet glissement de prunelles.
Donc, on se perd souvent, laissant échapper dans la course tel “village” (un ramas de cabanes en vérité) que la feuille de route des conducteurs présente comme l’étape du jour, parce qu’on dit jour pour désigner cette vague clarté laiteuse qui descend d’un ciel bas de 10 heures du matin à 3 heures de l’après-midi… Un soir que le chef de colonne égare son convoi au fond d’un bois et le ramène à force de détours hasardeux sur le chemin même qu’on venait d’emprunter, il coupe au sabre un bouleau par le milieu puis, examinant de près la coupure, fait ce commentaire qu’un compagnon de Savin, officier polonais, lui traduira à l’oreille : “Voilà la direction que nous devons prendre ! L’écorce de l’arbre, du côté nord, est un peu rousse et gâtée, tandis que, de l’autre côté, qui est celui du midi, elle est blanche et bien conservée. Marchons au midi !” Il faut alors rétrograder, et commence une rude contremarche jalonnée des cadavres qu’on a laissés là, détroussés par des cosaques ayant fermé la marche exprès, les charognards. Certains des corps vivent encore, lesquels moribonds s’accrochent aux traîneaux en suppliant qu’on les embarque, et rares sont les prisonniers qui, pour défendre leur place assise, d’un méchant coup sur les doigts, ne les ont pas “aidés” à lâcher les attelages pour en alléger la course. “Quand mémère tombe du chariot, le dada repart au trot”, dit le proverbe russe proféré par les gorges hilares des convoyeurs qui sont seuls à rire car rire de ses bourreaux aide à survivre, mais rire avec eux c’est se tuer soi-même en faisant perdre un peu de son âme au genre humain, tout le monde sait cela.
Il n’est pas rare que, faute de toit, la colonne bivouaque à l’air libre. Souvent, quand un homme se sent près de mourir, il se relève avec horreur dans la nuit pour lutter debout contre l’agonie ; et aussitôt le froid le fige, raide et gelé, dans les contorsions de la mort, sa dernière sueur glacée sur ses membres décharnés, les yeux ouverts pour toujours, le corps pétrifié dans une attitude convulsive. Les autres se réveillent à l’aube encerclés de statues blanches pareilles à des sentinelles avancées de l’autre monde. Il faut alors les mettre en tas, leurs chevilles se détachant du pied plus facilement que leurs semelles ne se dessoudent du sol enneigé. Le règlement stipule qu’il faut les brûler. De fait, on ne peut songer à creuser une fosse tant la neige est dure. Il n’est pas rare alors qu’on entende des cris de revenants jaillir du bûcher : un temps ressuscités par la chaleur des flammes, les suppliciés trépassent dans des tourments accrus.
Il arrive que la colonne trouve en chemin un bâtiment vide, surtout à l’entrée des villes. On l’investit aussitôt. On s’y entasse à tous les étages. Mais, en l’absence de chauffage, le froid n’est pas moins mordant au-dedans qu’au-dehors, or l’on ne fait pas un feu n’importe où dans un gîte. Au petit matin, c’est donc le même spectacle morbide qu’au bivouac, le même étalage de cadavres raidis dans la contorsion de leur passage à trépas. Les soldats russes les traînent alors par les pieds au moyen de cordes, dévalant les escaliers, et les têtes rebondissent sinistrement de marche en marche. On se souvient aussi de moribonds achevés de la sorte. Comme on ne peut être témoin de tout cela sans avoir la conscience meurtrie, chacun se justifie en pensant “bientôt mon tour”, ou “ils ne souffrent plus”. François Mercier, camarade de captivité de Nicolas Savin, dans le journal du miraculé qu’il sera : “Voilà ce que j’ai vu, ce que mes compagnons voyaient journellement, et pas un de nous n’avait le courage de réclamer : tant la misère abrutit les hommes ! La même chose, nous disions-nous, nous arrivera demain ; et cette communauté de périls mettait notre conscience en repos et favorisait notre inertie.”
Depuis quand Savin n’a-t-il pas ôté le bandage dont il s’était pansé le pied gauche ? Depuis Moscou, peut-être bien. Les “Moscovites” (les asticots, quoi, puisque la troupe les nomme ainsi) ont eu tout le temps de proliférer. Le froid tue tout sauf la vermine. Un certain soir, au bout d’une énième étape, l’isba où l’escorteur le place est si petite qu’on n’y loge que cinq prisonniers. Bancs ou couchettes, des planches courent le long des murs, sur lesquelles ils se jettent aussitôt, transis et fourbus. Ça sent le chou rance, le fumier, la misère et la peur. La famille s’est réfugiée sur le poêle qui ressemble à un grand four à pain surmonté d’une plateforme en brique ou moellon, et qui, par son volume, mange un bon tiers de l’espace intérieur. De cette famille paysanne, tremblante et chuintante, fagotée dans de la toile à sac, on ne voit que des yeux farouches et curieux. Pour elle, ce sont là ses premiers Français. Un sergent du 3e de ligne, qui fait partie de la chambrée, s’amuse alors à pousser un cri sauvage. Un “barrit”, qu’il dit. Gamin, ce fils d’un meunier de Montmartre avait entendu barrir Hans, l’éléphant du Jardin des Plantes. Maintenant, par la voix du sergent, c’est dans une isba du village de Klouchino que le pachyderme se met à trompeter. Sur le poêle, les visages se peignent de frayeur à la lueur dansante d’un lumignon résineux qui, fixé sur un pied, crache une longue flamme étirée en fumée grasse. Dans la pièce étroite et basse, le cri provoque un tintamarre étourdissant. Les poules caquettent et soulèvent un tourbillon de plumes et de paille. La flamme s’affole et fait tourner les ombres. Chose rare, on entend deux lapins clapir. La vieille jument décrépite, chétive et courte sur pattes, trouve la force de lancer une ruade en faisant tomber d’un coup trois pots d’écorce posés sur une grossière planche transversale (s’en échappent des graines d’airelle séchée). Un mouton pelé bêle, ce qui tranche un peu avec ses airs impassibles. Savin calcule bientôt qu’en comptant la ménagerie, on sera vingt-six à dormir dans la cabane. Touche comique au tableau, un chat déboule de sa cachette (vingt-sept !) en faisant voler une longue louche en bois plongée dans une étrange barrique (celle-ci, creusée à l’herminette dans la souche d’un tilleul, doit servir d’abreuvoir aux hommes et aux bêtes) ; alors la louche retombe sur le nez du sergent qui l’embouche, goguenard, à la manière d’une trompe d’éléphant.
Mais assez ri, on n’en peut plus. On retourne ses poches pour compter ses derniers kopecks et acheter de quoi manger aux paysans. On lâche d’amers jurons en déplorant le peu qui reste. On peste contre l’officier conducteur, ce roué de Russe qui garde pour lui la solde des hommes et peut-être aussi leur fourniment. Où diable sont-elles, ces touloupes annoncées par oukase, sinon dans sa cassette, en pièces sonnantes et trébuchantes ? L’or les rend tous fous. Pas la gloire ni l’amour, qui restent l’apanage des soldats de l’Empire, mais l’or. À tel point que Savin avait dû cacher les dix-huit napoléons or qu’il tenait de la grande foire de Moscou en les avalant précipitamment au moment même où les cosaques de Platov le capturaient en lui “faisant un jambon” (c’est-à-dire en lui cassant son fusil). Et maintenant, trois semaines plus tard, contrairement aux lois de la nature, elles ne sont toujours pas reparues de l’autre côté malgré les remous insupportables qui lui torturent le fondement par d’affreuses coliques : jusqu’à quinze fois par jour, un flot fétide se verse dans sa culotte qu’il ne dégrafe plus depuis bien longtemps. Hier, il empestait tant que ses camarades l’ont chassé de la masure où l’on couchait, et n’a dû son salut qu’à une miraculeuse botte de paille sèche trouvée dans un hangar, au creux de laquelle il a pu se nicher. Mais toujours pas de napoléons or ! Ce ne sont pas ses 50 kopecks de solde journalière qui le feront manger. D’ailleurs, on vient de le dire, ce paiement n’existe vraiment et pleinement que sur les tablettes du conducteur. Des camarades meurent chaque jour par dizaines, dont les paies vont à son seul crédit. Les âmes mortes, qu’ils appellent ça.
En étalant les 2 roubles cuivre qu’on vient de grappiller, on fait entendre par gestes qu’on veut manger. Mais rien n’indique qu’on a été compris. Alors un sous-lieutenant suggère qu’on a peut-être interprété une pantomime trop civilisée, puisqu’on y jouait de la fourchette et du couteau. Pour plus de clarté, on mime à présent un homme des cavernes qui mordrait dans un quartier d’aurochs. Là-haut, sur le poêle, les paysans s’agitent en proférant plusieurs fois le même mot : “Couché !”, “Couché !”. Les autres s’énervent et disent qu’avant de se coucher, c’est manger qu’on veut. Le ton monte. Plus leste qu’on ne l’aurait cru, le vieux moujik saute alors de son perchoir et s’empare d’une espèce de marmite posée sur une saillie du four. On ne tarde pas à y reconnaître un gruau pâteux de sarrasin. Fiévreusement, les prisonniers se passent le pot de la main à la main, dans lequel ils puisent avec une seule et même cuillère en bois de tremble. Heureuse surprise, cette bouillie noire est relevée par un sel qui tranche avantageusement avec la poudre à cartouche dont les troupes, depuis tant de semaines, accommodent leur bouillie de son. On monte encore d’un cran dans la jouissance quand la femme du moujik, descendue prestement à son tour (fichtre, quelle agilité à cet âge ! ou c’est au contraire qu’ils sont jeunes mais font vieux ?) extrait d’un coin du four un bouillon de chou que les Français jugent à la fois infâme et délectable. Après la marmitée de sarrasin, c’est bientôt la potée aux choux qui finit dans les gosiers des cinq naufragés. Ça ne vaut pas, dit le sergent, un morceau de boudin de la Mère aux bouts comme on mangeait à la caserne de Courbevoie avec une bouteille de vin de Suresnes, mais c’est assez pour la nuit (faux augure, on le verra). Enfin, le moujik fait circuler une chope en bois remplie de kvas. Ce n’est pas la première fois qu’on en boit, mais ce kvas-là leur paraît meilleur que les autres. Soit qu’on l’ait mieux préparé, soit que le goût des prisonniers ait tourné. Si la peau prend la couleur blanc cendré du pays de leurs souffrances, pourquoi le goût ne s’accoutumerait-il pas à ce vineux breuvage ? On dit qu’il provient de la fermentation d’orge et de fruits, telle cette airelle séchée que la jument a fait tomber de l’étagère en regimbant contre le cri de l’éléphant. Le kvas dégage un étrange bouquet de levain mêlé d’hydromel et, surtout, envoie partout (à la tête, aux jambes, au ventre et même aux parties honteuses) des vagues chaudes et grisantes à vous réconcilier avec le sort. »
(p. 72-79)
Douce isba (p. 117-120)
Rue des Petits-Sous (p. 263-266)
Extrait court


